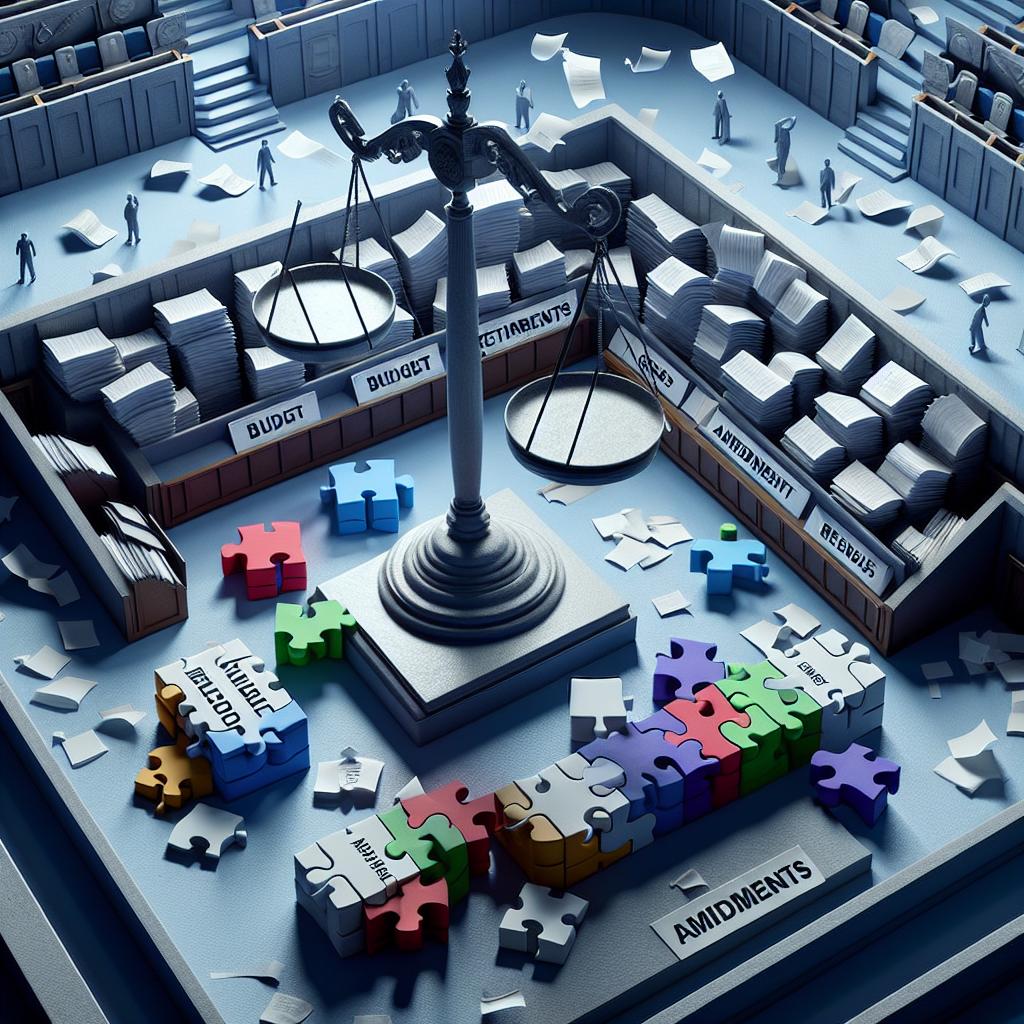Le 8 septembre, après la démission de François Bayrou, le président de la République a nommé Sébastien Lecornu Premier ministre. Il lui a confié la mission de « consulter les forces politiques en vue d’adopter un budget et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois ».
Des négociations longues et quelques rebondissements
Après plusieurs semaines de négociations marquées par des moments de tension, les discussions se sont soldées par un arrangement politique d’apparence fragile. Le lancement du gouvernement Lecornu a connu un épisode spectaculaire : la première composition n’a vécu que quatorze heures avant d’être remaniée ou retirée, selon les éléments rapportés.
L’accord — présenté comme une forme de non-censure — implique le « socle commun », rassemblant Renaissance, le MoDem, Horizons et Les Républicains, et le Parti socialiste. Ce dernier avait posé deux conditions considérées comme non négociables : l’abandon de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, et la suspension de la réforme des retraites.
Sébastien Lecornu a donné un engagement solennel sur ces deux points. Toutefois, cet engagement gouvernemental ne garantit pas à lui seul l’effet juridique recherché. La décision finale appartient au Parlement, où députés et sénateurs conservent la prérogative de voter ou de rejeter les lois.
Pourquoi l’accord reste précaire face au Parlement
Sur la suspension de la réforme des retraites, l’accord politique signifie qu’une majorité des partis signataires se disent favorables à l’idée. Mais la mise en œuvre passe par la loi et par un vote des assemblées. Les députés et les sénateurs, individuellement et par groupes, peuvent décider autrement. En l’absence d’une majorité parlementaire claire et durable, la suspension risque de rester incertaine.
La question de l’article 49, alinéa 3 est centrale. Cet article de la Constitution permet au gouvernement d’engager la responsabilité de l’exécutif sur un texte et d’imposer, sauf motion de censure adoptée, son adoption sans vote formel sur l’ensemble. Le Parti socialiste a obtenu l’engagement de ne pas recourir à ce mécanisme pour faire passer certaines mesures. Sans l’activation du 49.3, certains textes jugés sensibles pourraient ne pas franchir l’Assemblée.
Concrètement, l’absence de 49.3 rend plus probable un blocage parlementaire. Les débats s’allongent, les amendements se multiplient et la nécessité d’un compromis se fait plus pressante. Les signataires de l’accord devront donc convaincre, au cas par cas, des députés et sénateurs externes au socle pour sécuriser les majorités nécessaires.
Le budget : deux lois distinctes et des votes multiples
Le calendrier budgétaire complique encore la donne. Le budget de l’État se compose de deux textes distincts et indépendants : la loi de finances, qui rassemble principalement les mesures fiscales, et la loi de financement de la Sécurité sociale, qui intègre notamment les dispositions concernant les retraites.
La loi de finances porte la partie recettes — impôts, taxes et autres mesures destinées à alimenter les ressources de l’État. Elle contient, selon les discussions en cours, des options sur la taxation des très hauts revenus, évoquant par exemple une « taxe Zucman » ou des variantes allégées. La loi de financement de la Sécurité sociale, elle, couvre les recettes et dépenses sociales et intègre les décisions relatives au calendrier et au contenu de la réforme des retraites.
Chaque loi fait l’objet d’examens séparés et appelle plusieurs votes. L’un porte sur la partie recettes (mesures fiscales et autres ressources), l’autre sur la partie dépenses (dotations par ministère). Ces votes se déroulent au fil des lectures successives devant l’Assemblée nationale puis le Sénat. À chaque étape, des majorités distinctes peuvent se former ou se défaire.
En pratique, l’abstention du recours au 49.3 peut rendre la validation du budget plus lente et incertaine. Sans ce levier constitutionnel, le gouvernement dépendra des négociations parlementaires et d’accords ponctuels pour faire adopter tant les recettes que les dépenses.
La manœuvre politique engagée vise donc à stabiliser une majorité suffisamment large pour voter les textes essentiels. Mais la réalité institutionnelle rappelle que la parole du Premier ministre et les engagements politiques doivent ensuite se traduire en majorités parlementaires effectives pour produire des lois.