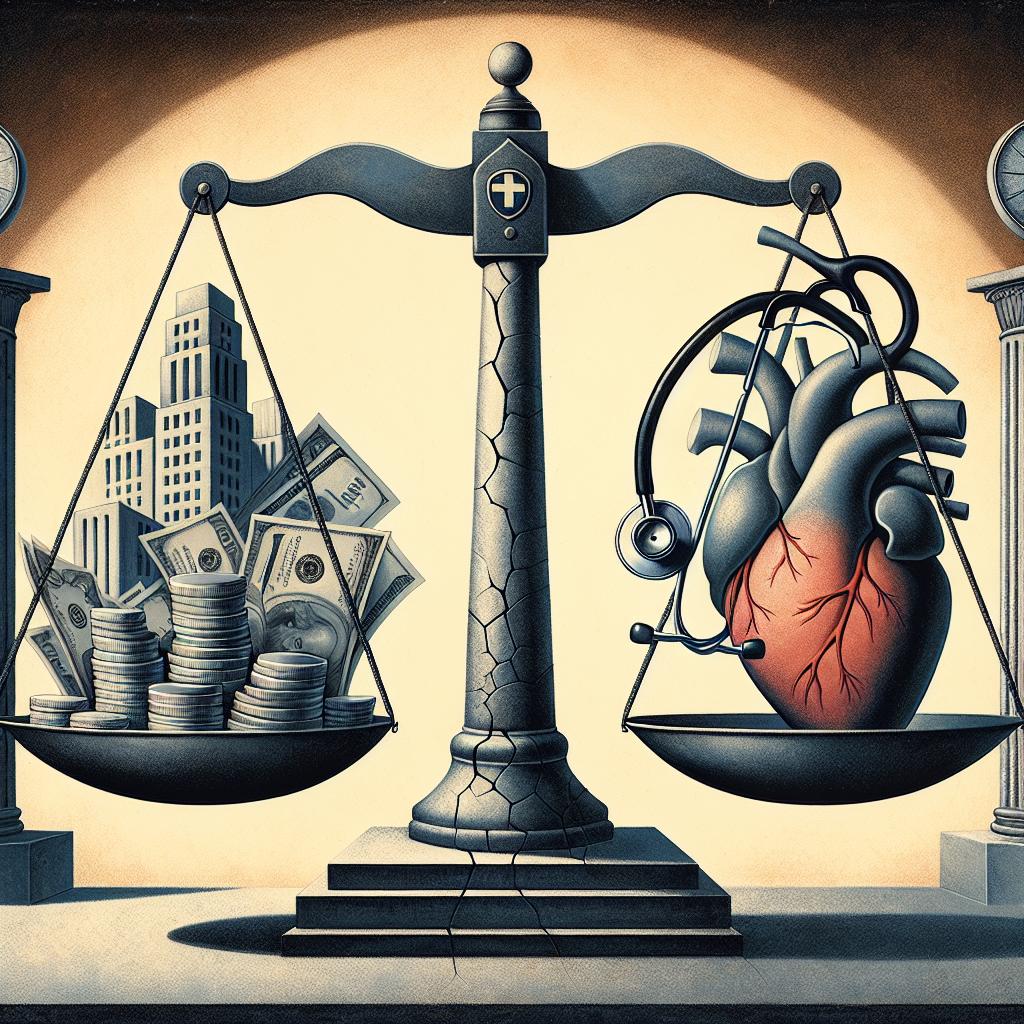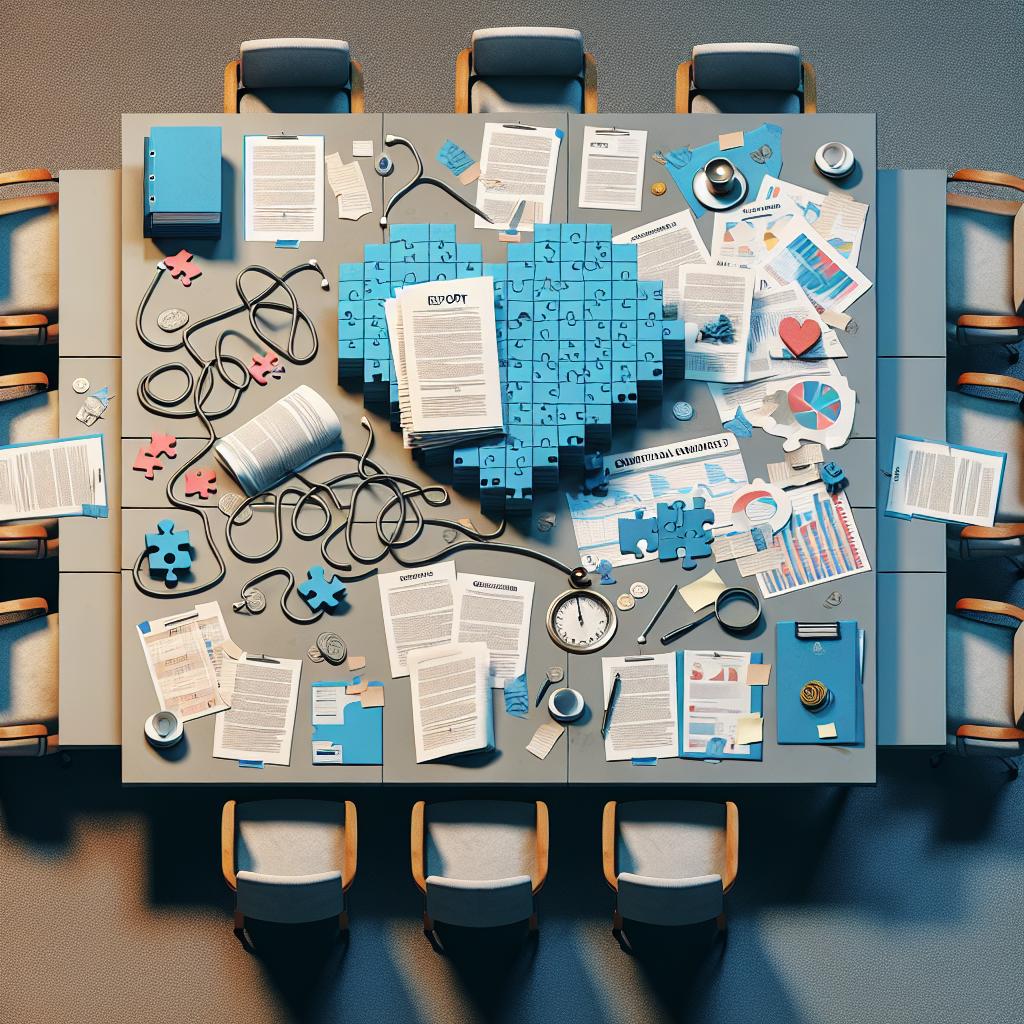Notre système de santé, longtemps présenté comme un modèle de protection collective, montre aujourd’hui des signes persistants de dégradation. De réformes en décisions politiques, le financement n’a pas été repensé en profondeur ; en conséquence, les ajustements se font par la taxation et la pénalisation des usagers — patients et professionnels de santé — plutôt que par une refonte structurelle.
Une fiscalité qui pèse sur les malades
La montée des prélèvements directs se traduit notamment par le doublement des franchises sur les soins, une mesure qualifiée par certains observateurs de « taxe sur la maladie ». Cette formulation s’oppose à l’esprit fondateur de la Sécurité sociale, résumé par la maxime « cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins ». La justification politique invoquée consiste à « responsabiliser » les patients, une expression qui modifie la perception de la maladie en faisant des personnes malades des acteurs responsables de l’équilibre financier du système.
Parallèlement, des annonces récentes évoquent la fiscalisation des indemnités journalières versées aux personnes bénéficiant d’une affection de longue durée (ALD). Si ces mesures sont mises en œuvre, elles risquent d’affaiblir davantage le principe de solidarité, en transférant une part du poids financier sur les malades eux-mêmes plutôt que sur une mobilisation plus large des ressources publiques.
Les médecins sous pression : encadrement et pénalisations
Les professionnels de santé apparaissent également comme des cibles des réformes. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour l’année 2026 prévoit, selon les textes présentés, des dispositifs d’encadrement, des pénalisations et des surtaxes appliqués aux revenus liés au soin. Dans ce contexte, les médecins qui facturent des honoraires complémentaires sont régulièrement désignés responsables d’une aggravation des inégalités d’accès aux soins.
La stigmatisation des praticiens facturant des surcoûts s’accompagne d’une volonté affichée de limiter ces pratiques au nom de l’équité. Le débat public oppose cependant deux réalités : d’un côté, la nécessité de préserver l’accès aux soins pour les patients les plus fragiles ; de l’autre, la question du maintien d’une offre médicale stable et de qualité quand les recettes publiques seules ne suffisent pas à compenser l’inflation des coûts.
Origines légales des honoraires complémentaires
La possibilité de facturer des compléments d’honoraires n’est pas récente. Elle a été autorisée sous le gouvernement de Raymond Barre [1924-2007], alors premier ministre, lorsque la montée de l’inflation rendait difficile la seule prise en charge par l’assurance-maladie. Cette disposition a été pensée comme un mécanisme permettant de maintenir l’offre et la qualité des soins face à des tensions économiques.
Les conditions d’accès à ces compléments d’honoraires sont encadrées par la loi et restent strictes : pour pouvoir les pratiquer, un médecin doit justifier d’au moins deux années comme assistant chef de clinique ou assistant spécialisé, ou cinq années comme praticien hospitalier titulaire, ou cinq années comme praticien hospitalier dans les hôpitaux d’instruction des armées. Ces critères visent à limiter l’usage des compléments d’honoraires à des praticiens disposant d’une expérience et d’un statut reconnus.
Conséquences et enjeux pour la solidarité
Au-delà des mesures ponctuelles, c’est le modèle solidaire qui est en jeu. À défaut d’une réforme ambitieuse et durable du financement, le système devient, selon l’expression employée par certains, autophage : il prélève sur ses propres bénéficiaires pour subsister. Cette dynamique risque d’éroder progressivement la cohésion du système et d’accroître les inégalités d’accès aux soins.
Les choix de court terme, motivés par la réduction immédiate des dépenses, peuvent produire des effets inverses sur la durée. Un affaiblissement de la prise en charge collective ou des pressions supplémentaires sur les revenus des soignants pourrait rendre plus difficile le maintien d’une offre médicale équilibrée sur l’ensemble du territoire.
En l’état, les mesures évoquées — doublement des franchises, fiscalisation des indemnités pour ALD, encadrement des compléments d’honoraires dans le PLFSS 2026 — traduisent une tension entre exigences budgétaires et principe de solidarité. Leur mise en œuvre effective et leurs impacts réels dépendront des textes définitifs et des modalités d’application, ainsi que des réponses politiques qui seront apportées pour préserver l’accès et la qualité des soins.
Sans appel à l’action ni pronostic, le constat demeure : la pérennité du système de santé dépendra principalement des choix politiques à venir et de la capacité à concilier contraintes financières et exigences d’un accès solidaire aux soins.