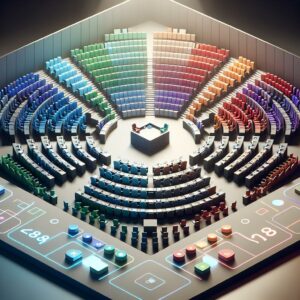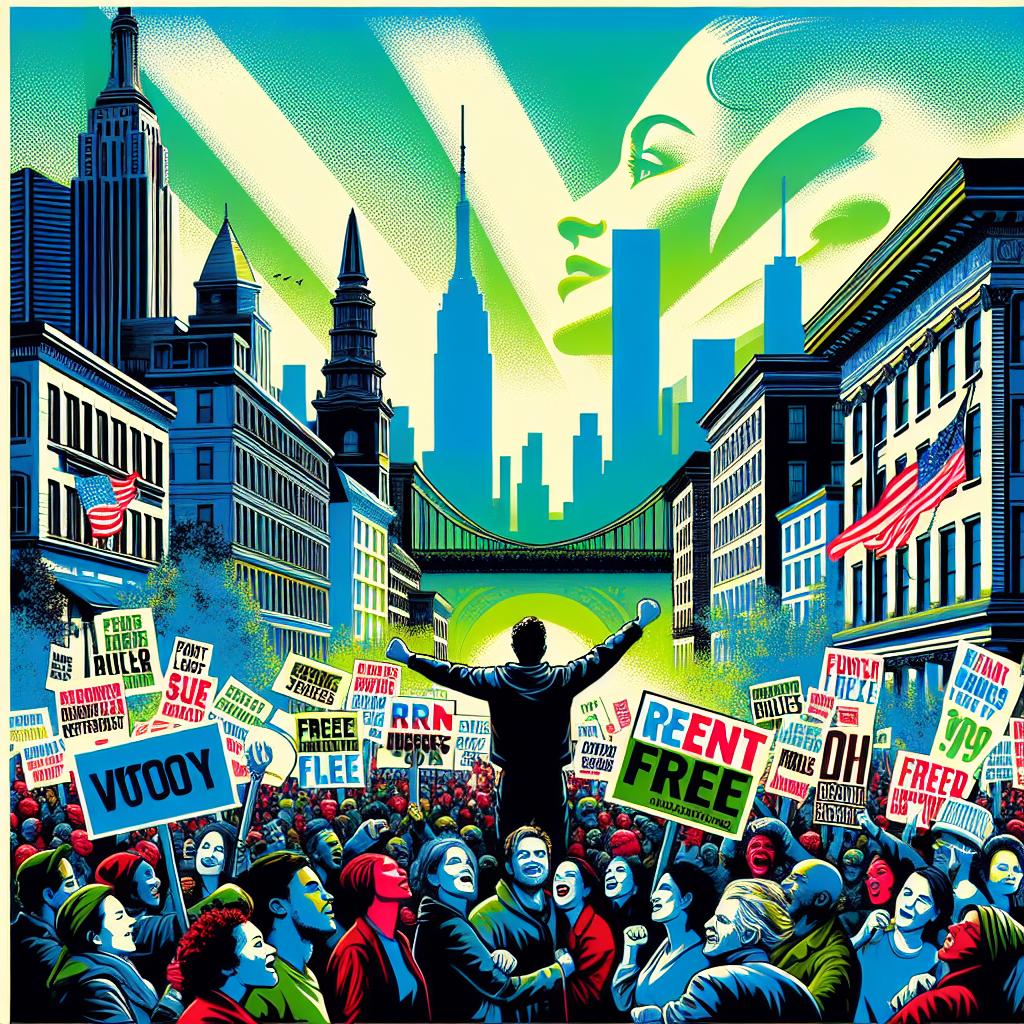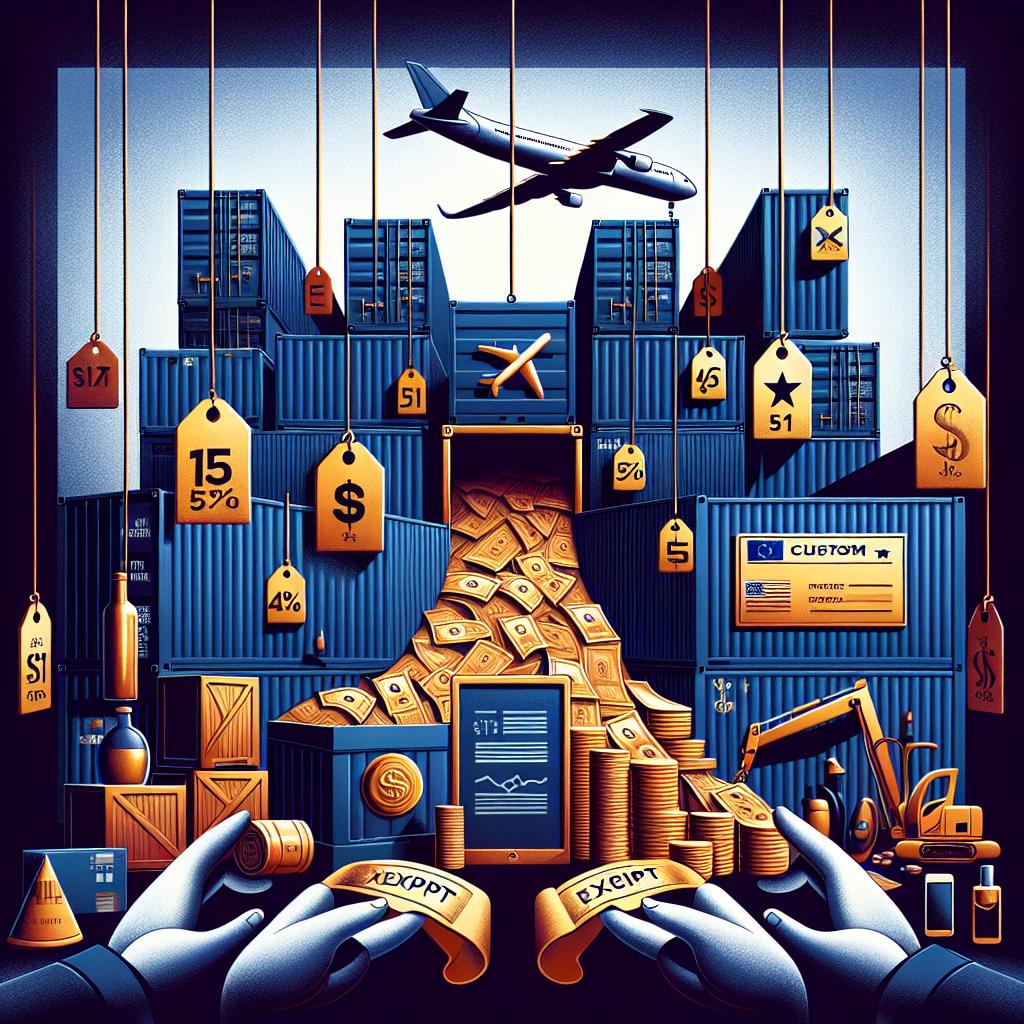Contexte et chronologie
La crise ouverte par la chute du gouvernement Bayrou, survenue le lundi 8 septembre, s’inscrit dans une série de secousses politiques et sociales qui ont marqué le quinquennat d’Emmanuel Macron. Depuis le début de son premier mandat, le paysage politique national a connu des tensions récurrentes qui ont affaibli la logique majoritaire sans pour autant provoquer une rupture du régime institutionnel de la Ve République.
Parmi ces événements, le mouvement des « gilets jaunes », durant l’hiver 2018–2019, occupe une place centrale. Né de la contestation contre la hausse des prix des carburants et l’extension perçue de la taxe carbone, ce mouvement spontané a mis en évidence une fracture sociale et politique importante, notamment chez des catégories populaires et moyennes confrontées à l’érosion du pouvoir d’achat.
Les contestations sociales : de la spontanéité à la mobilisation organisée
Les « gilets jaunes » se sont distingués par leur caractère largement spontané, échappant initialement aux structures politiques et syndicales traditionnelles. Outre la question fiscale, le mouvement a porté une revendication forte de démocratie directe, traduisant une défiance envers le système représentatif et le sentiment d’une déconnexion entre élus et citoyens.
Quatre ans plus tard, l’hiver 2023 a vu une autre séquence importante : un puissant mouvement social contre la réforme des retraites. Contrairement à la révolte de 2018–2019, cette mobilisation a été encadrée par l’intersyndicale et articulée autour d’un projet de contestation clair, lié à l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. La réforme, défendue par le président et annoncée pendant la campagne électorale, a cristallisé l’opposition dans la rue et accentué l’isolement politique de l’exécutif.
Conséquences électorales et désenchantement
Sur le plan politique, ces tensions ont contribué à remodeler le paysage électoral. La situation s’est notamment traduite par une dissolution de l’Assemblée nationale en 2024, dont les effets ont été jugés délétères par une partie de l’opinion. La perte de la majorité parlementaire s’est accompagnée d’un ressentiment marqué chez certains électeurs, qui ont eu le sentiment que la victoire électorale leur avait été en quelque sorte dérobée.
Ce mécontentement ne s’est pas cantonné à un seul bord : il concerne à la fois des électeurs de gauche et des partisans du Rassemblement national (RN), selon le constat dressé dans le débat public. Dans ce contexte, la pratique du compromis politique est devenue plus difficile, rendant toute gouvernance majoritaire plus précaire.
Instabilité gouvernementale et situation présente
Au cours des douze derniers mois, la France a vu la chute de deux gouvernements successifs, d’abord celui de Michel Barnier, puis celui de François Bayrou. Ces départs ont nourri un sentiment d’instabilité et ont mis en lumière la fragilité des majorités parlementaires contemporaines.
À l’heure actuelle, le pays traverse une période de fortes incertitudes, dans un environnement international qualifié de chahuté et dangereux par plusieurs observateurs politiques. L’absence d’une majorité stable et la multiplication des crises internes compliquent la définition d’une perspective claire à moyen terme.
En synthèse, la succession d’événements — contestations sociales, réformes controversées, dissolutions et alternances gouvernementales — a progressivement érodé la trajectoire politique attendue par les institutions. Si ces tensions n’ont pas entraîné une crise de régime, elles ont largement remis en cause la continuité du « fait majoritaire » et posé la question de la capacité des acteurs politiques à retrouver un terrain de compromis.
Les éléments rapportés dans cet article proviennent du récit politique et chronologique fourni plus haut ; les dates et faits cités y sont conservés tels qu’énoncés.