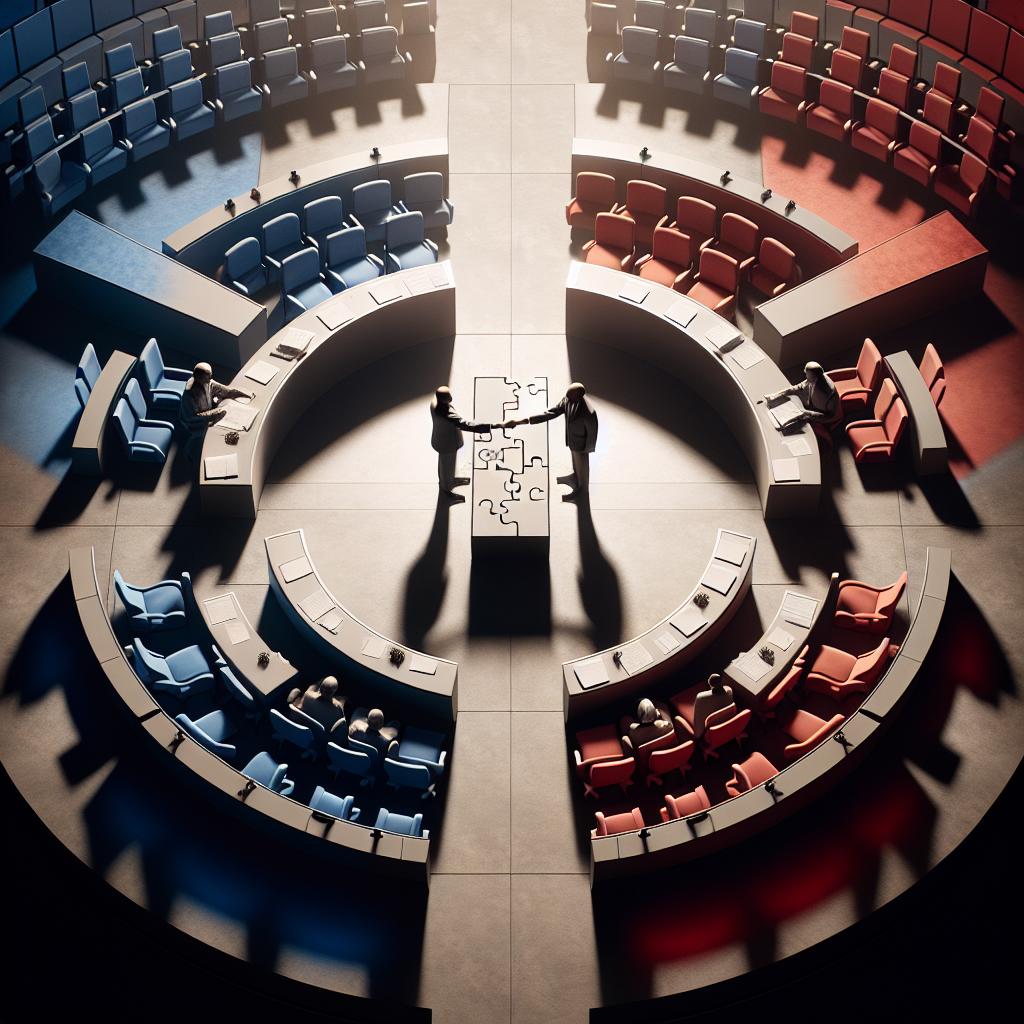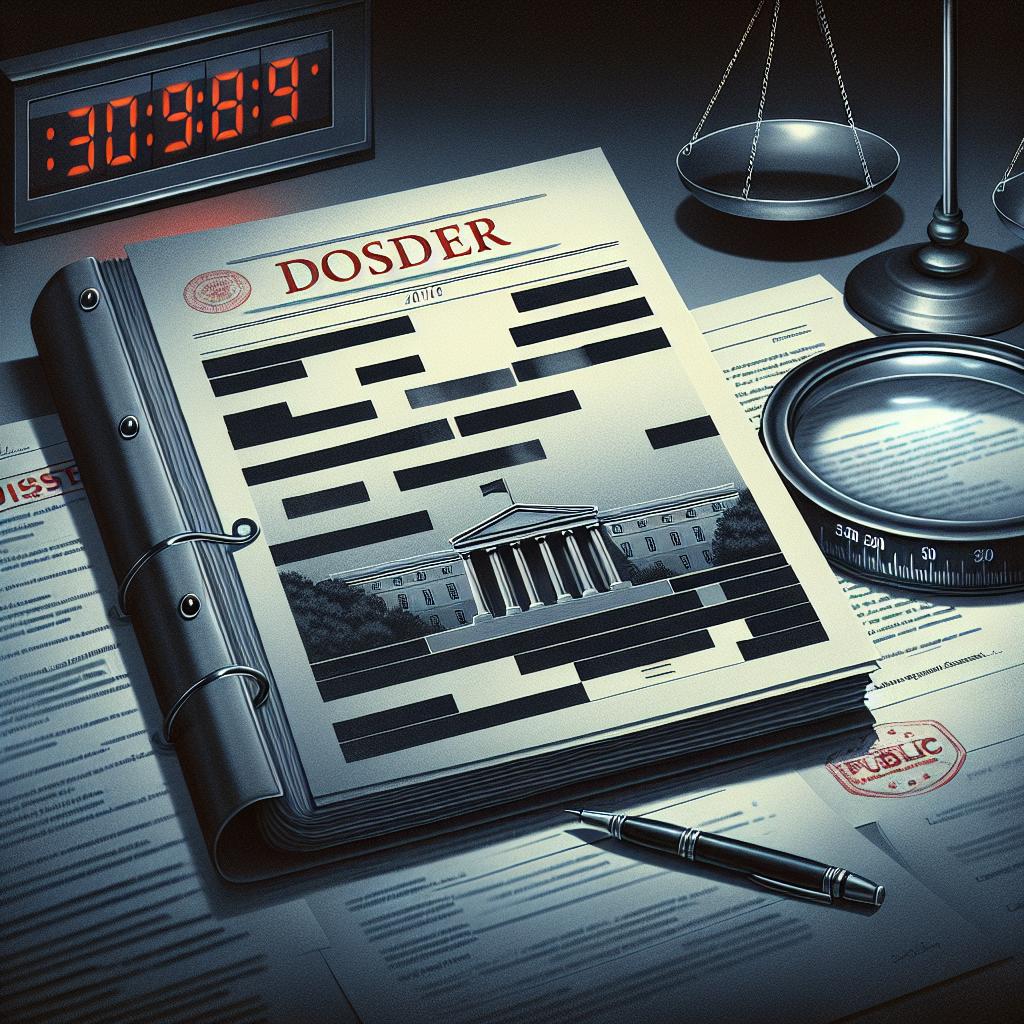Depuis les élections législatives de 2022, le mot « coalition » s’est imposé dans le vocabulaire politique français. L’expression est revenue avec force à l’été 2024, lorsque Lucie Castets, candidate du Nouveau Front populaire (NFP) pour Matignon, s’est déclarée « prête » à construire des « coalitions » pour « assurer la stabilité du pays ».
Un terme repris par la nouvelle direction gouvernementale
Cette rhétorique du rassemblement a été rapidement relayée par la suite. Michel Barnier, nommé premier ministre par Emmanuel Macron le 5 septembre 2024, a plaidé pour des rapprochements, et François Bayrou, qui lui a succédé trois mois plus tard, a lui aussi défendu l’idée d’un dialogue avec des partenaires politiques d’origines différentes.
Qu’ils viennent de la droite ou de la gauche, ces responsables invoquent la nécessité de s’ouvrir au-delà des lignes partisanes traditionnelles. Leur discours met en avant l’objectif de donner une assise plus large au gouvernement, afin de réduire les risques d’instabilité et de permettre l’adoption de mesures jugées indispensables.
Une contrainte née de la fragmentation parlementaire
Dans les faits, cette orientation n’est pas seulement une option stratégique : elle répond à une contrainte institutionnelle. En l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale, aucun exécutif n’a la marge de manœuvre suffisante pour gouverner seul et faire adopter son programme sans négociations.
Depuis les élections législatives de 2022, et plus encore après les scrutins de 2024, la confortable majorité parlementaire qui avait accompagné, depuis 1962, la plupart des gouvernements de la Ve République s’est étiolée. Le Palais-Bourbon apparaît aujourd’hui divisé en trois blocs — la gauche, le « bloc central » et la droite radicale — au lieu du traditionnel clivage binaire.
Dans un hémicycle aussi fragmenté, aucune majorité stable ne peut se former sans accords ponctuels ou coalitions durables. Un exécutif qui tenterait d’appliquer strictement son programme sans rechercher des alliances s’exposerait rapidement à des revers parlementaires, et notamment à une motion de censure susceptible de le renverser.
Conséquences pratiques pour la gouvernance
Concrètement, la recherche de coalitions se traduit par des négociations sur les priorités législatives et par des compromis sur le calendrier et le contenu des réformes. Les alliances peuvent être pragmatiques et temporaires, centrées sur des textes particuliers, ou plus ambitieuses, visant une coopération durable entre groupes parlementaires.
Les partisans du rassemblement estiment que de telles coalitions permettent d’élargir le socle politique, d’améliorer la représentativité des décisions et de réduire les effets de l’instabilité. Les opposants, pour leur part, mettent en garde contre la dilution des engagements programmatiques et la perte de clarté pour les électeurs lorsque les lignes idéologiques se brouillent.
Le recours aux coalitions pose enfin la question de la lisibilité de l’action publique : comment concilier gouvernabilité et cohérence politique lorsque des forces aux sensibilités différentes se retrouvent autour d’un même exécutif ? Cette interrogation est au cœur des débats actuels et conditionnera en grande partie la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ses décisions.
Sans majorité nette, la pratique politique tend donc à privilégier le dialogue et le compromis. Reste à savoir si ces coalitions seront conçues comme des outils ponctuels de gestion parlementaire, ou si elles évolueront vers des formes de gouvernance plus stables et durables.