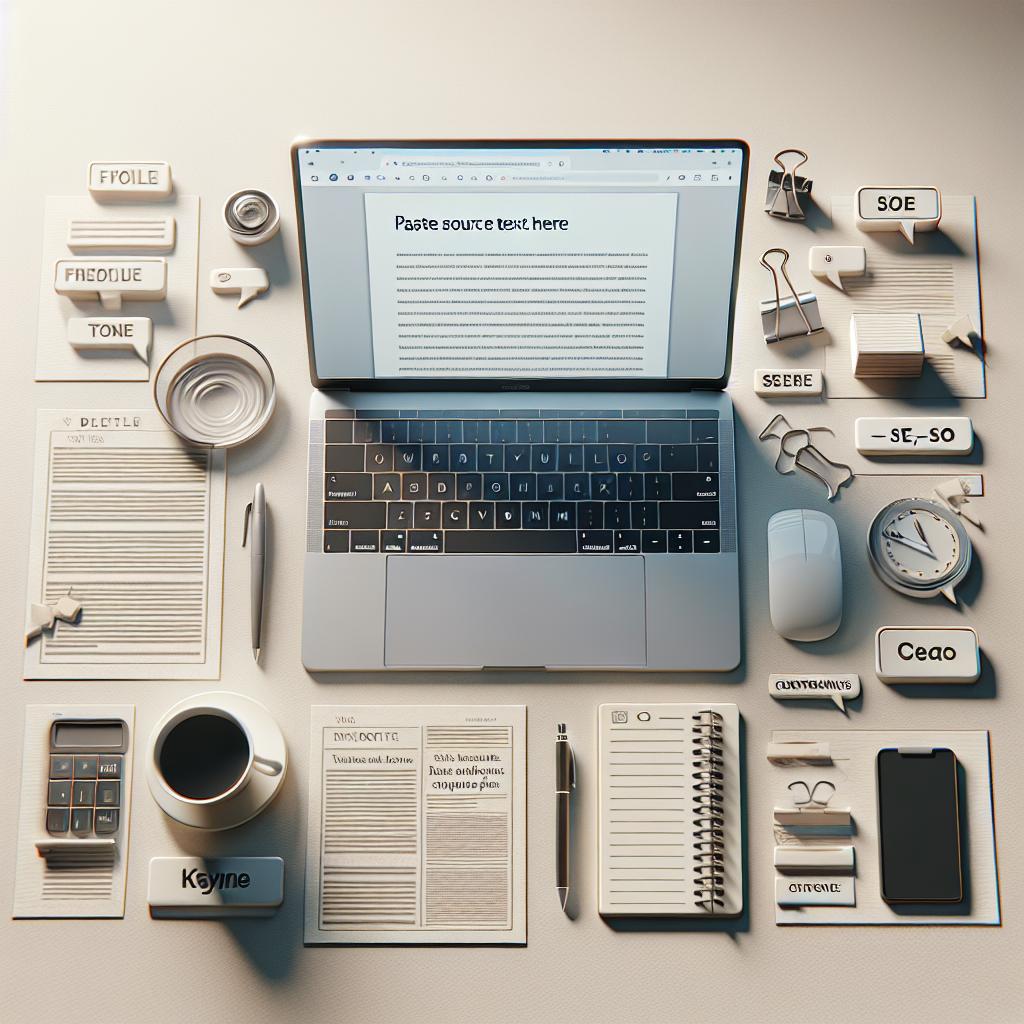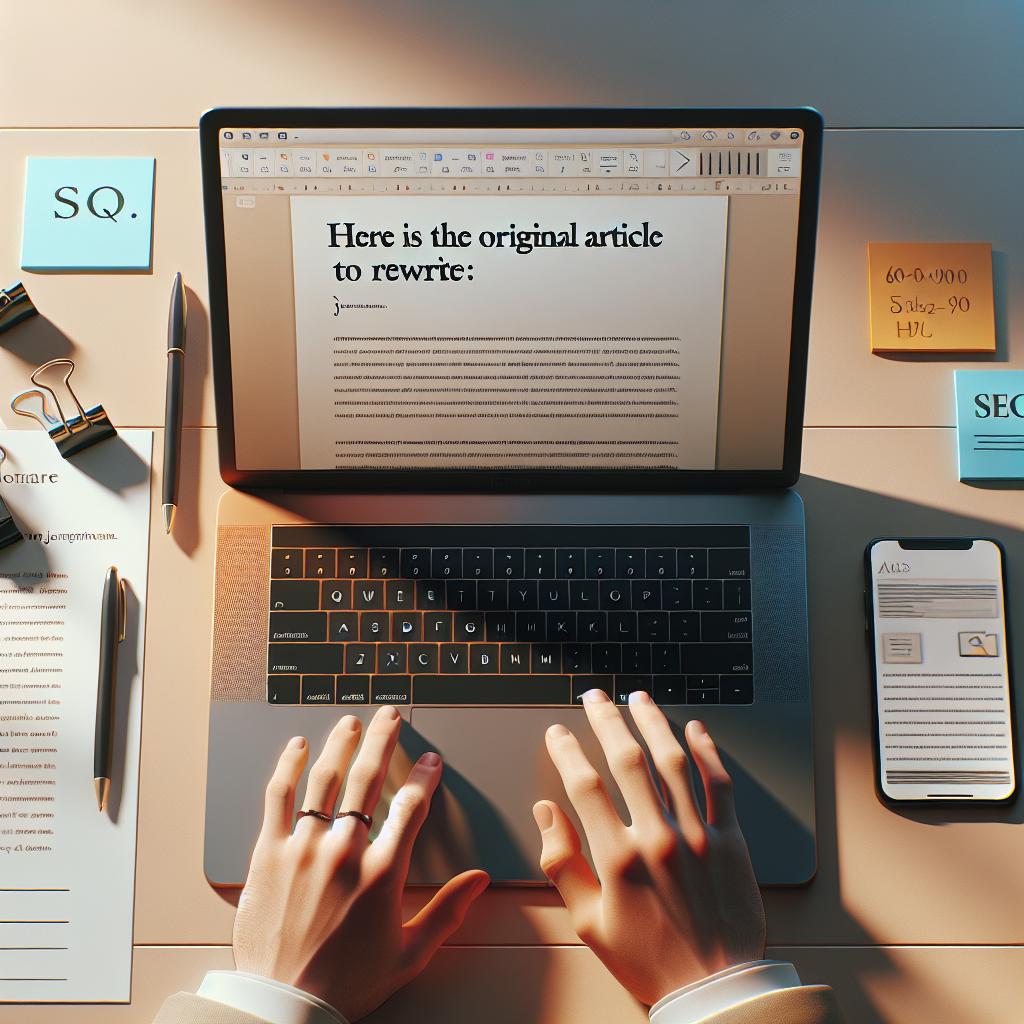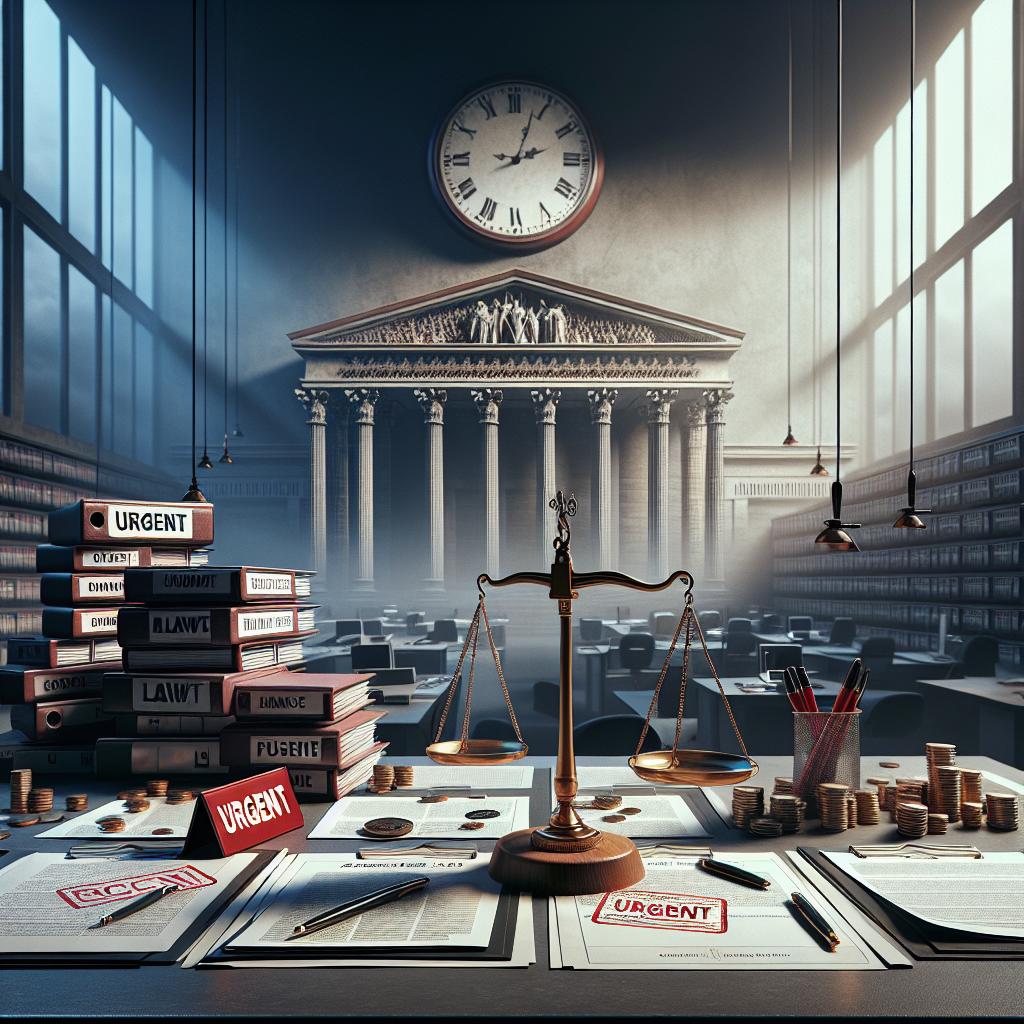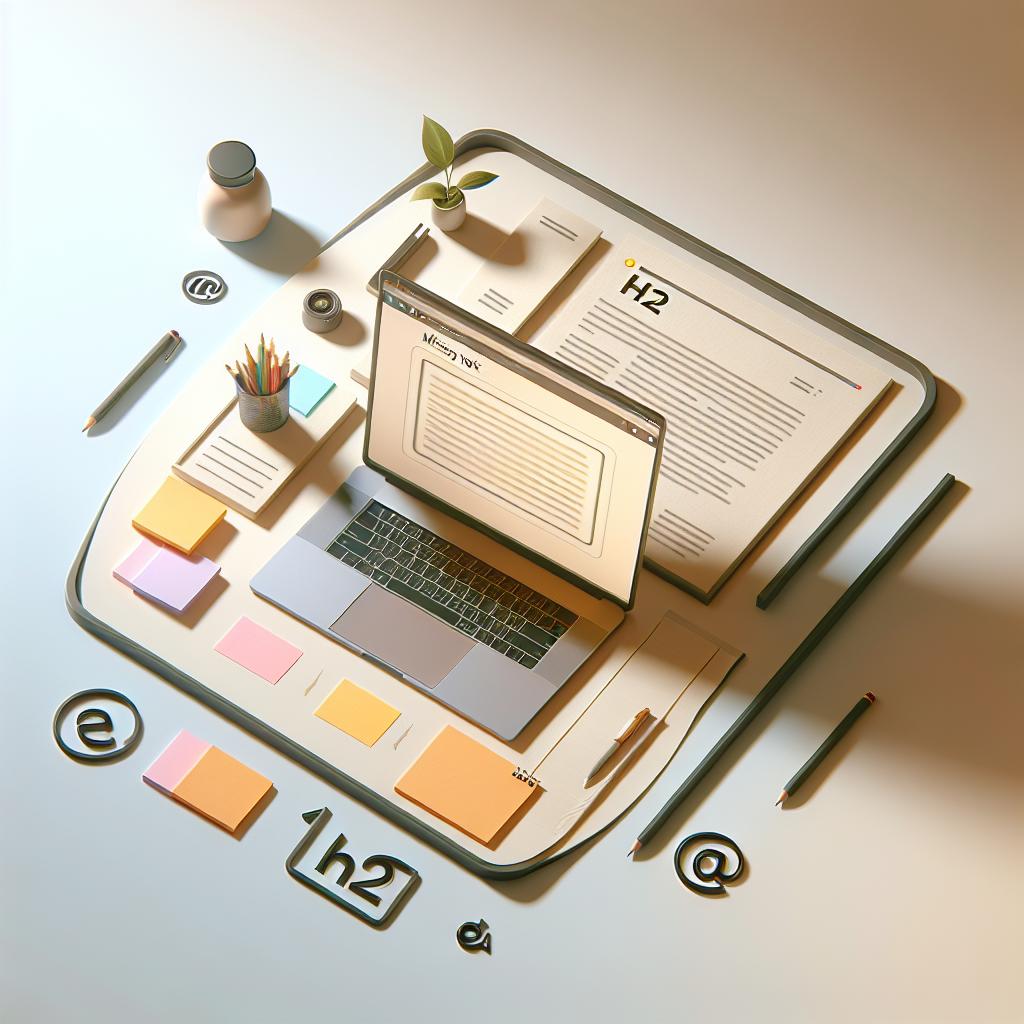Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 12 septembre, la taxe française sur les services numériques, une mesure contestée depuis son adoption en 2019 par les grands acteurs du numérique. Saisie par Digital Classifieds France — filiale du groupe allemand Axel Springer et propriétaire des sites SeLoger et MeilleursAgents — la haute juridiction a rejeté les arguments présentés par la société requérante et déclaré la taxe conforme à la Constitution.
La décision et ses motifs
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime que la taxe ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux garantis par la Constitution. Les juges indiquent explicitement que la mesure ne méconnaît « ni les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, ni la liberté d’entreprendre, « ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».
La saisine provenait d’une entreprise du secteur des petites annonces en ligne, Digital Classifieds France. Les avocats de cette société contestaient la légalité de la taxe, invoquant notamment des inégalités de traitement et des contraintes pour l’activité économique. Le Conseil a toutefois écarté ces arguments, validant la conformité de la loi aux exigences constitutionnelles.
Un revers pour les poids lourds d’Internet
La confirmation de la taxe représente un échec pour les grandes plateformes numériques qui s’opposent à cette imposition depuis son instauration. Principalement critiquée par les entreprises américaines du numérique — identifiées dans le débat public sous les initiales GAFA, puis GAFAM avec l’inclusion de Microsoft — la mesure a suscité des résistances juridiques et politiques dès 2019.
Au-delà des groupes privés, la taxe a également suscité des réactions politiques à l’international. Le texte rappelle que la contestation a parfois été relayée au plus haut niveau, citant notamment l’opposition du président américain Donald Trump. Ces appels à remettre en cause la taxe ont accompagné les recours judiciaires et les débats diplomatiques autour de la fiscalité du numérique.
Enjeux budgétaires : un rendement en hausse
Pour Bercy, la validation du Conseil constitutionnel est à la fois une victoire politique et un soulagement financier. Les recettes de la taxe ont augmenté fortement depuis 2019. Elles s’élevaient à 277 millions d’euros la première année, ont atteint 756 millions d’euros en 2024 et sont attendues à 774 millions en 2025.
La suppression de la taxe aurait donc créé un manque à gagner notable pour l’État, particulièrement sensible dans un contexte de contraintes budgétaires. La taxe vise une trentaine d’entreprises ciblées par le dispositif, ce qui explique en partie la sensibilité politique de la mesure et l’attention portée à son rendement.
Portée et limites de la mesure
La taxe sur les services numériques concerne des modèles économiques basés sur la mise en relation et la monétisation de données. En pratique, elle cible une petite trentaine d’acteurs disposant d’un chiffre d’affaires et d’une présence digitale suffisante pour être assujettis. Le Conseil constitutionnel a jugé que, dans ce cadre, le traitement légal ne contrevenait pas aux principes constitutionnels invoqués.
Reste que la validation judiciaire n’éteint pas les débats politiques et économiques sur la fiscalité du numérique, son efficacité et son équité. Plusieurs pays européens ont expérimenté des approches différentes, et la question d’une harmonisation à l’échelle internationale demeure au cœur des discussions entre États, institutions européennes et organisations multilatérales.
Conséquences pratiques
À court terme, l’État conserve une recette importante et prévisible. Pour les entreprises concernées, la décision signifie la poursuite d’un régime fiscal supplémentaire en France, avec des implications comptables et opérationnelles. Les acteurs qui avaient engagé des recours juridiques ou des contestations publiques devront maintenant adapter leur stratégie à une réalité fiscale confirmée par la plus haute juridiction constitutionnelle française.
Au-delà des effets immédiats, la validation par le Conseil constitutionnel renforce le cadre national qui encadre la fiscalité du numérique et peut influer sur les négociations internationales en cours sur la taxation des activités numériques.
En l’état, la décision clôt une étape judiciaire importante, tout en laissant ouvertes les discussions politiques et techniques sur l’avenir de la fiscalité numérique.