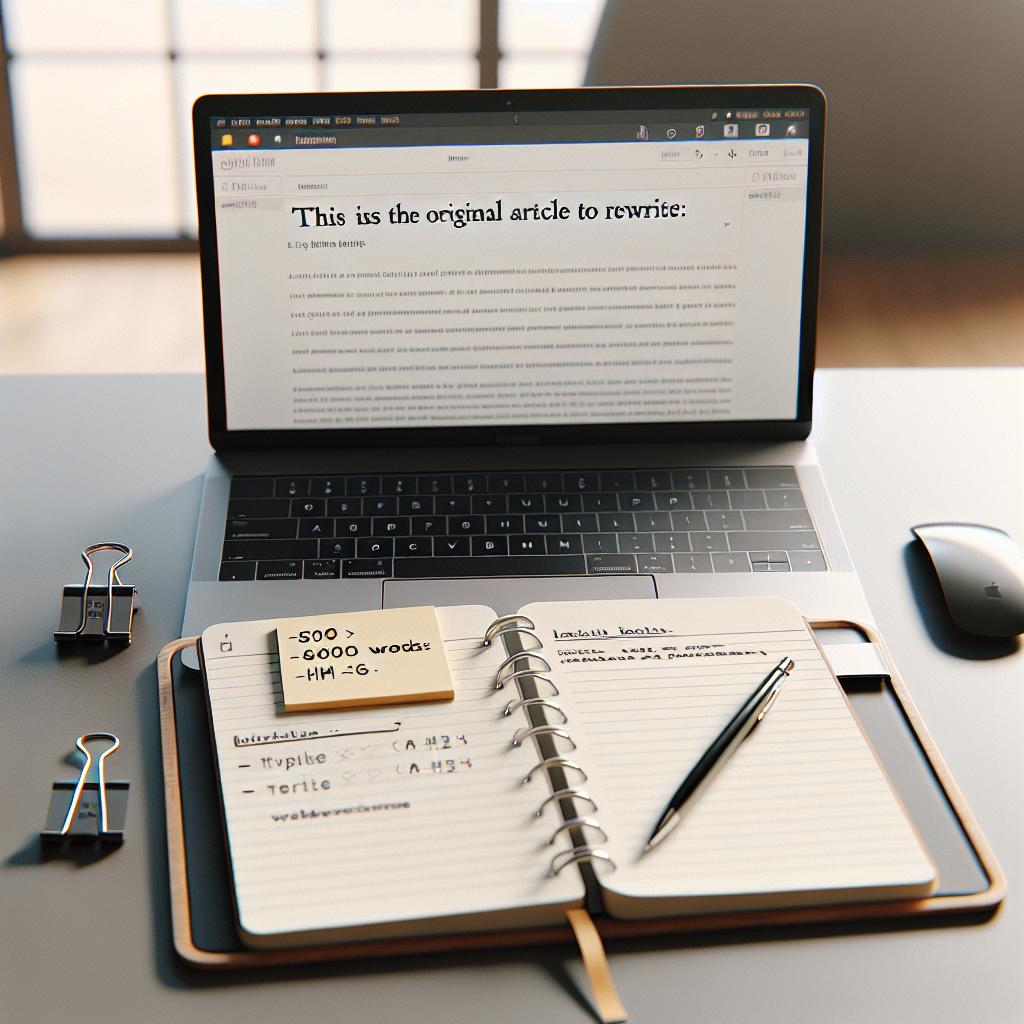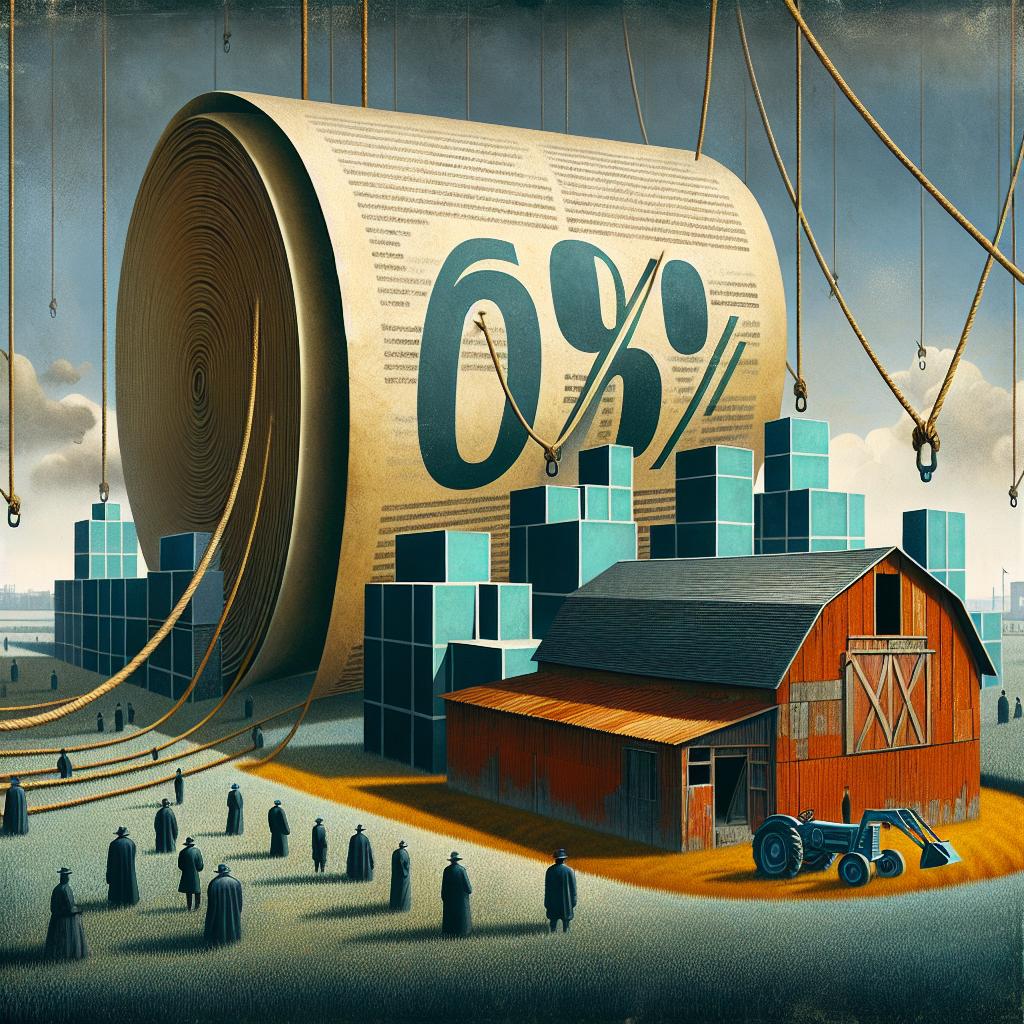Le Conseil constitutionnel n’est pas présenté comme parfait par ses défenseurs. Pourtant, dans un contexte que le texte qualifie de « glissement généralisé illibéral », il demeure, dans sa configuration actuelle, l’organe chargé par la Constitution de vérifier que le législateur respecte les droits et libertés. « Qui n’est pas un risque, mais un devoir », résume Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, pour décrire cette mission de contrôle démocratique. Selon ce raisonnement, une loi qui méconnaîtrait la Constitution ne pourrait plus prétendre exprimer la volonté générale, car elle porterait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La fonction du Conseil : protéger la loi comme expression de la volonté générale
La logique exposée par le doyen Vedel, alors membre du Conseil, est explicite : « La loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » Par cette formulation, le Conseil n’apparaît pas comme un juge politique chargé de trancher les conflits entre majorités parlementaires ; il n’a pas pour rôle de gouverner. Sa mission consiste plutôt à empêcher que les titulaires du pouvoir utilisent leur position pour porter atteinte aux droits et libertés, qui sont considérés comme le bien commun.
La distinction est souvent résumée par une lecture des idées de Montesquieu : le gouvernement et le Parlement disposent de la faculté de « statuer », c’est‑à‑dire de trancher des débats politiques et d’édicter des lois. Le Conseil, lui, a la faculté d’« empêcher » : il peut bloquer la promulgation d’une loi jugée contraire à la Constitution, notamment lorsqu’il s’agit de droits fondamentaux — à titre d’exemple, le texte évoque le droit à un environnement sain et équilibré.
Un équilibre des pouvoirs remis en cause?
Cette architecture constitutionnelle, destinée à garantir un équilibre entre les pouvoirs et à préserver la qualité démocratique des lois, fait l’objet de critiques croissantes. Selon le texte de départ, des voix — issues du monde politique et du milieu académique — demandent aujourd’hui soit la suppression du Conseil constitutionnel, soit sa transformation en simple instance consultative dont les avis n’auraient plus l’autorité de la chose jugée.
Les partisans d’une telle réforme invoquent, selon le propos repris, une ambition de recentrage du pouvoir législatif ou une critique de l’intervention des juges constitutionnels dans des questions perçues comme relevant du débat politique. En sens inverse, les défenseurs du Conseil soulignent que le retrait de son pouvoir juridictionnel ferait perdre aux citoyens un rempart institutionnel contre les lois susceptibles de restreindre des libertés fondamentales.
Le texte cite, à titre d’exemple, la « loi Duplomb », relative à la réintroduction ou non de produits phytopharmaceutiques, pour illustrer un cas concret où le Parlement peut statuer et le Conseil opposer un contrôle fondé sur le droit à un environnement sain et équilibré. Cette référence figure dans le document initial ; elle est reprise ici sans commentaire sur son contenu détaillé, faute d’éléments complémentaires fournis dans le texte de départ.
Dans le débat public, deux enjeux apparaissent au premier plan : d’une part la préservation d’un contrôle juridictionnel susceptible d’empêcher des atteintes aux droits et libertés ; d’autre part la crainte, pour certains, d’une « juridicisation » excessive de questions qui relèveraient selon eux du choix politique démocratique. Chacun de ces axes pose des questions de principe sur la séparation des pouvoirs et la nature même de la souveraineté populaire.
Le maintien ou la transformation du Conseil constitutionnel soulèvent donc des interrogations profondes sur la manière dont une démocratie définit et protège le bien commun. Le débat ne se résume pas à une défense d’institutions pour elles‑mêmes : il interroge la capacité des institutions à garantir que les lois demeurent conformes à des droits et des principes constitutionnels reconnus comme essentiels.
À défaut d’univoque, la discussion publique sur la place du Conseil reflète des choix de société. Elle invite à confronter des arguments juridiques et politiques : quel degré de contrôle juridictionnel est compatible avec l’autonomie du pouvoir législatif ? Quel équilibre permet de concilier gouvernabilité et protection des libertés ? Ces questions, au cœur des démocraties contemporaines, rendent compte d’un débat qui dépasse la seule institution et engage la conception même de l’état de droit.