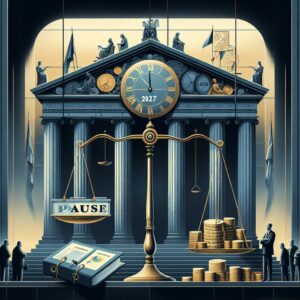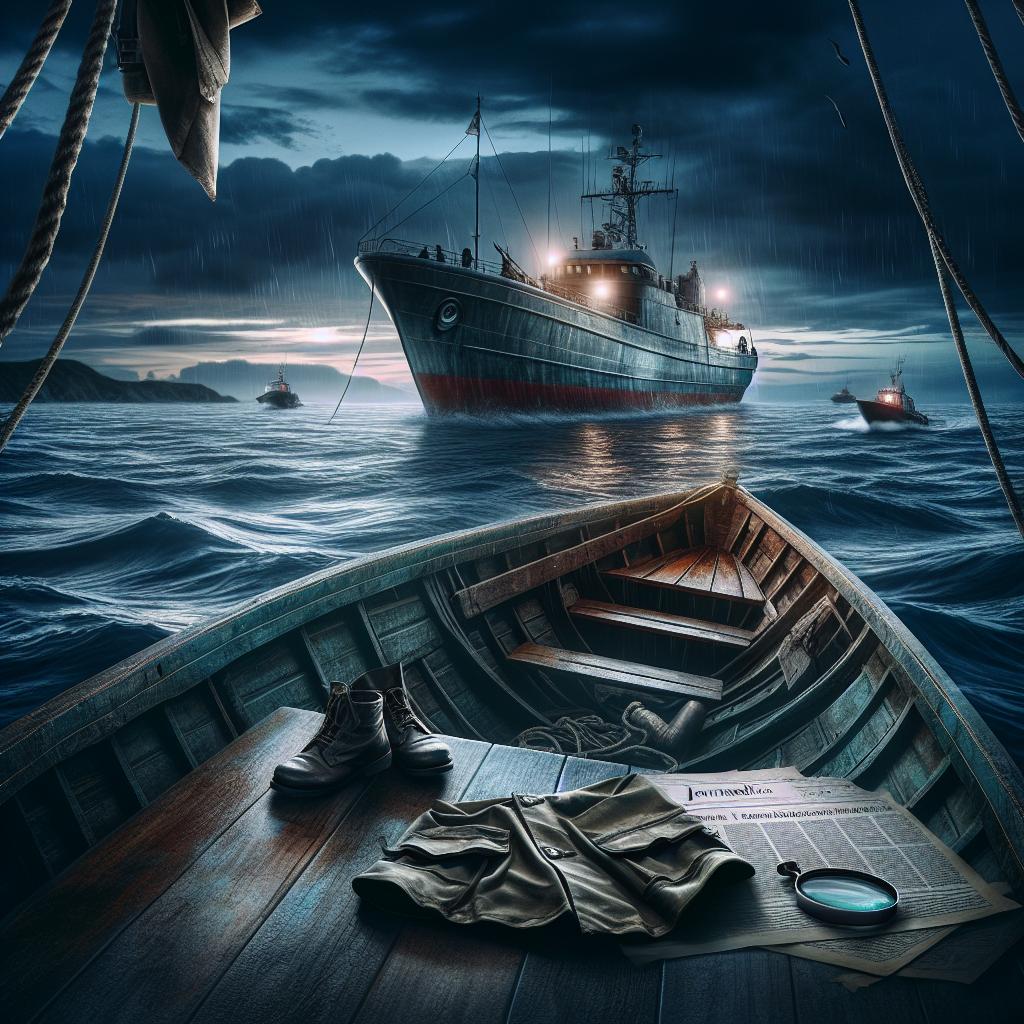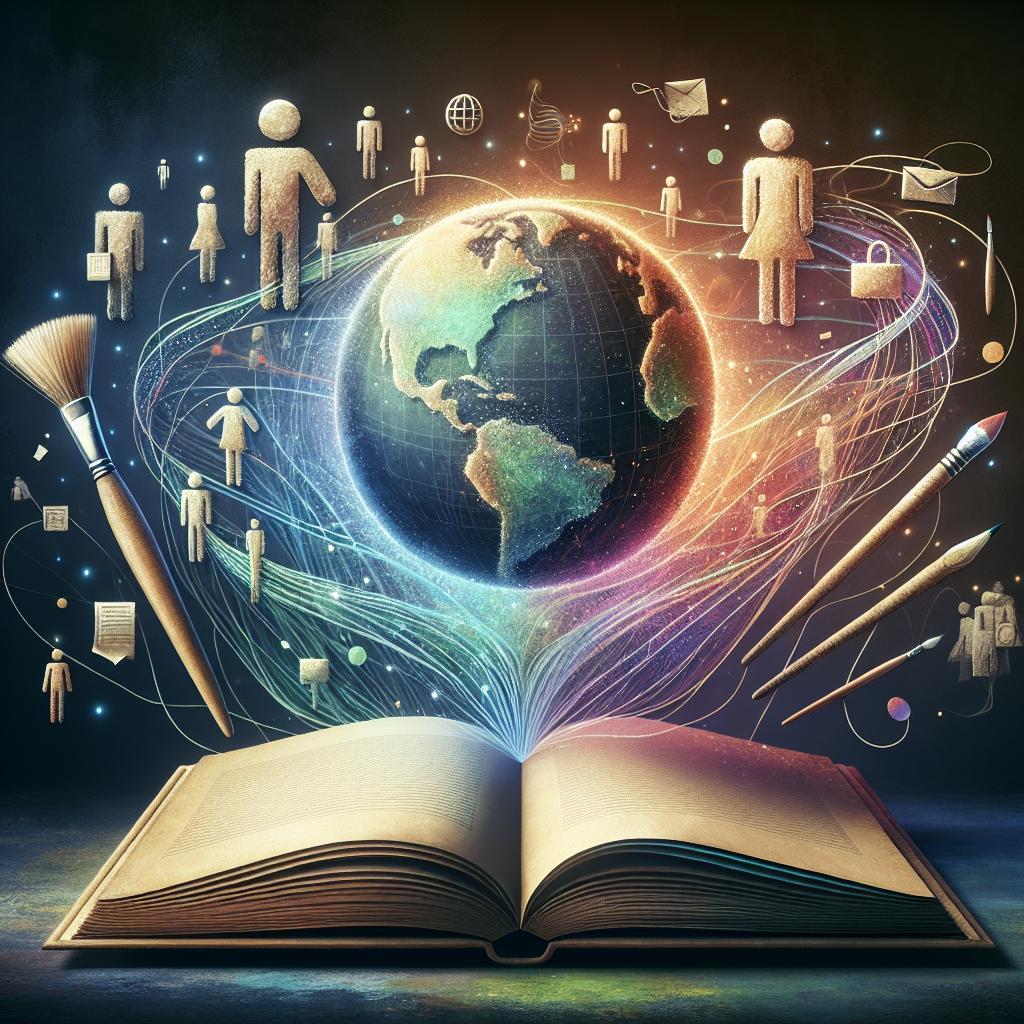Avant l’échec politique, le revers juridique. À la veille de l’insuccès annoncé des motions de censure déposées contre le Premier ministre, Sébastien Lecornu, le Conseil d’État a rejeté, mercredi 15 octobre, un recours formé par Marine Le Pen. Cette décision empêche la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et complique l’avenir électoral de la dirigeante du Rassemblement national.
Le rejet et son objet
La plus haute juridiction administrative a refusé d’adresser la QPC au Conseil constitutionnel. Celle-ci visait à contester l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité prononcée le 31 mars par le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire dite des assistants parlementaires européens du Front national. Marine Le Pen avait interjeté appel de cette condamnation.
La procédure engagée remonte à une requête déposée en juillet. Elle s’attaquait au refus, intervenu en mai, du Premier ministre d’alors, François Bayrou, d’abroger des « dispositions réglementaires » dont l’application avait conduit à la radiation de la cheffe de file de l’extrême droite des listes électorales. Le recours cherchait à faire annuler ou à faire modifier ce mécanisme administratif.
Motifs juridiques invoqués par le Conseil d’État
Dans son communiqué, le Conseil d’État constate que « le recours ne tendait pas tant à l’abrogation ou la modification de dispositions réglementaires qu’à la modification de la loi et de la loi organique ». Selon la haute juridiction, la requête relevait donc d’un changement du régime législatif de l’inéligibilité et de l’exécution provisoire, et non d’une simple rectification réglementaire.
Le Conseil d’État rappelle qu’un Premier ministre n’a pas compétence pour modifier la loi ou la loi organique, compétences qui relèvent du Parlement. En l’absence d’un pouvoir d’abrogation législative du chef du gouvernement, la requête présentée par Marine Le Pen a été jugée infondée. La QPC accompagnant le recours a été, pour cette raison, écartée.
Ce que cela signifie pour l’exécution provisoire et l’éligibilité
La décision du Conseil d’État ne remet pas en cause, sur le fond, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 31 mars. Elle porte exclusivement sur la voie procédurale choisie par la requérante et sur la compétence du Premier ministre pour intervenir par voie réglementaire. En pratique, le rejet de la transmission de la QPC prive, pour l’instant, Marine Le Pen d’un nouvel examen constitutionnel portant sur l’exécution provisoire de sa peine.
L’exécution provisoire signifie que l’effet de la peine — ici l’inéligibilité — peut s’appliquer dès sa prononciation, même si l’intéressé fait appel. Le contrôle de la régularité de cette application peut s’exercer devant les juridictions compétentes, mais la voie retenue par la requérante devait, selon le Conseil d’État, viser à modifier un cadre législatif et non un simple texte réglementaire.
La décision administrative a donc une portée pratique immédiate : sans transmission de la QPC, il n’y aura pas d’examen par le Conseil constitutionnel de l’argument constitutionnel soulevé dans ce dossier, au moins par cette voie procédurale.
Impacts politiques et contexte
Politiquement, le rejet judiciaire accroît l’incertitude autour de la participation de Marine Le Pen à des scrutins futurs. Le texte mentionne que la mesure avait déjà entraîné sa radiation des listes électorales, conséquence directe de la condamnation. La dirigeante a fait appel de la décision pénale, mais l’effet de l’inéligibilité s’est trouvé exécuté provisoirement entre-temps.
Par ailleurs, ce revers juridique intervient alors que des motions de censure ciblent le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le lien entre ces deux événements est d’ordre chronologique et politique : la décision du Conseil d’État a été rendue « à la veille » de l’échec attendu des motions, selon le contexte rapporté. Le rejet administratif fragilise une stratégie procédurale et ajoute une dimension judiciaire au débat politique en cours.
La décision du Conseil d’État illustre la séparation des compétences entre pouvoir réglementaire et législatif. Elle rappelle aussi les limites des recours administratifs lorsque l’objet véritable de la contestation est une règle de nature législative.
Enfin, si la voie de la QPC a été écartée dans ce cas précis, d’autres voies de contestation restent possibles dans le cadre des appels pénaux et des procédures soulevant des questions de droit. La situation en reste donc juridiquement active, même si, à court terme, le recours présenté en juillet n’a pas abouti.