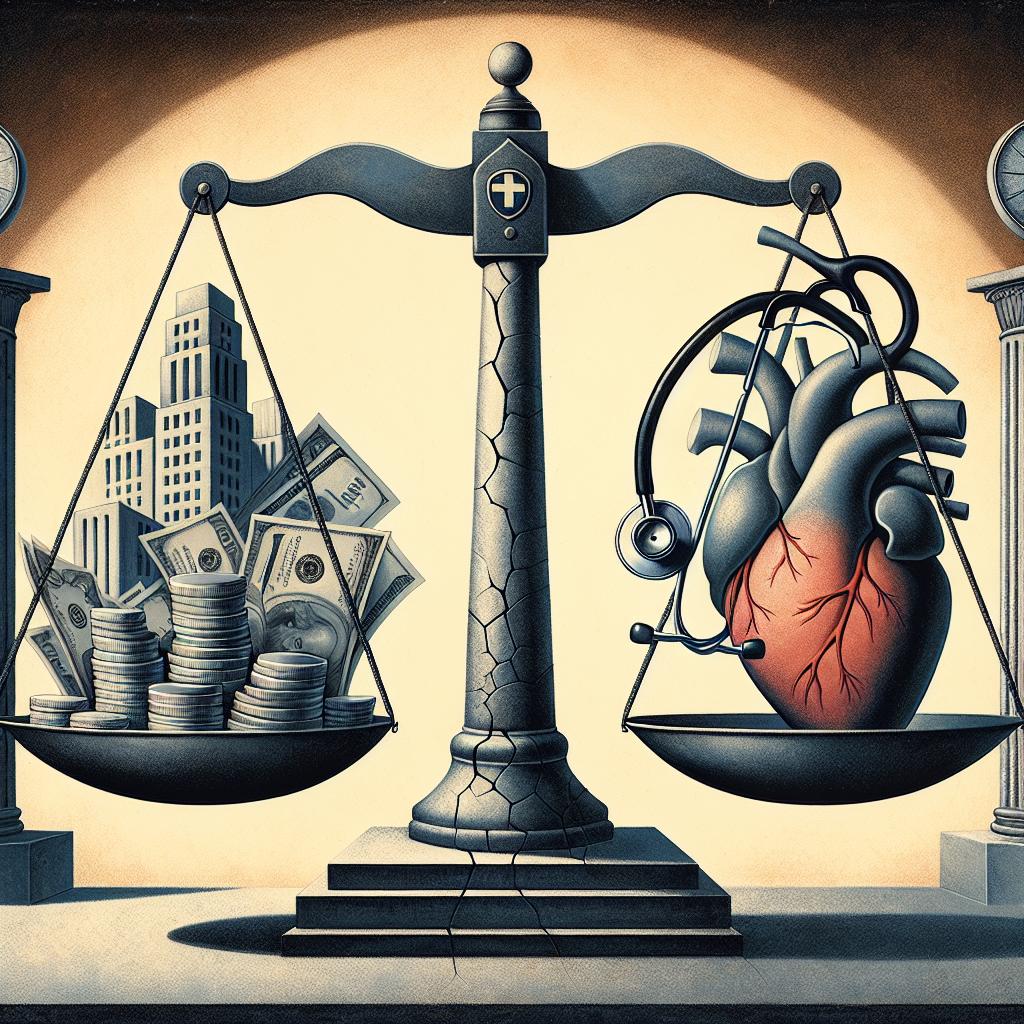Un bilan de mission au moment de la démission
Le premier ministre démissionnaire a achevé ce que ses partisans qualifiaient d’une « mission » de « moine-soldat ». Mercredi 8 octobre, Sébastien Lecornu a indiqué au « 20 heures » de France 2 qu’il ne pouvait « pas dire grand-chose » mais qu’un « chemin » restait possible, car « une majorité très relative de formations politiques sont prêtes à s’accorder sur un budget commun ».
La sortie de cette crise politique majeure repose essentiellement sur le président de la République, Emmanuel Macron, seul habilité à nommer un nouveau premier ministre ou à dissoudre l’Assemblée nationale. Ces deux options inquiètent la plupart des partis — à l’exception du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise — et contraignent le président à des concessions tant sur la forme que sur le fond pour tenter de tenir jusqu’à la fin de son second mandat.
Un pouvoir éprouvé et des alliés qui se désengagent
Depuis le week-end précédant la démission, l’exécutif a vu des éléments importants de son autorité se fragiliser. Le quinquennat, déjà fragilisé par les élections législatives de 2022 puis par la dissolution de 2024, semble désormais sérieusement mis à l’épreuve. La nouveauté tient au fait que des figures proches du macronisme appellent désormais à des évolutions ou expriment leur incompréhension.
En l’espace de quelques jours, deux anciens premiers ministres, Gabriel Attal et Édouard Philippe, ont déclaré ne plus comprendre la trajectoire du chef de l’État ou l’ont invité à démissionner. Une autre ancienne cheffe de gouvernement, Élisabeth Borne, a proposé de suspendre la réforme des retraites de 2023, adoptée « au forceps » grâce au recours au 49.3, malgré une mobilisation sociale importante. Selon Sébastien Lecornu, ce dossier est « bloquant » et constitue la clé d’un éventuel apaisement politique.
Des choix contraints pour l’Élysée
Confronté à ces pressions, le président est acculé. Lâché par une partie de la droite, il peut soit nommer un exécutif de gauche susceptible de suspendre la réforme, soit choisir un premier ministre issu de son propre camp prêt à assumer un recul pour éviter une censure du gouvernement. Dans les deux cas, la situation illustre l’affaiblissement du pouvoir présidentiel puisque, pour la première fois, il pourrait être contraint de renoncer à un texte jugé structurant par une partie de sa majorité.
La réforme des retraites, qualifiée de « paramétrique » et jugée moins ambitieuse que le système à points envisagé lors du premier quinquennat, reste néanmoins un marqueur politique fort pour les députés macronistes. À plusieurs reprises lors de ses mandats, Emmanuel Macron s’est engagé à « changer de méthode » et à « se réinventer », sans que ces formules aient jusqu’ici modifié de façon durable sa pratique du pouvoir. Aujourd’hui, le contexte politique rend ces engagements plus contraignants que jamais.
Conséquences pour les partis et le budget
Si la crise se résout par un recul de l’Élysée, les autres forces politiques devront assumer leurs responsabilités. Après une semaine de tractations et de postures, l’opinion attend que les institutions votent un budget à l’Assemblée nationale puis au Sénat ; un nouvel échec sur ce point serait difficilement compréhensible pour l’électorat.
En cas de suspension de la réforme des retraites, la gauche devra expliciter ses propositions de financement pour 2026 et les années suivantes. De son côté, une partie de la droite est de plus en plus tentée par un rapprochement avec le RN, qui réclame l’abrogation de la réforme. Ce rapprochement, déjà évoqué dans le débat public, pose des questions politiques et éthiques que la droite devra clarifier.
Ce dossier, que le président pensait avoir clos, se retrouve finalement au cœur de la fin tourmentée de son second quinquennat. Les décisions à venir de l’Élysée et des groupes parlementaires détermineront si la crise politique évolue vers un compromis budgétaire et institutionnel ou vers une instabilité prolongée.