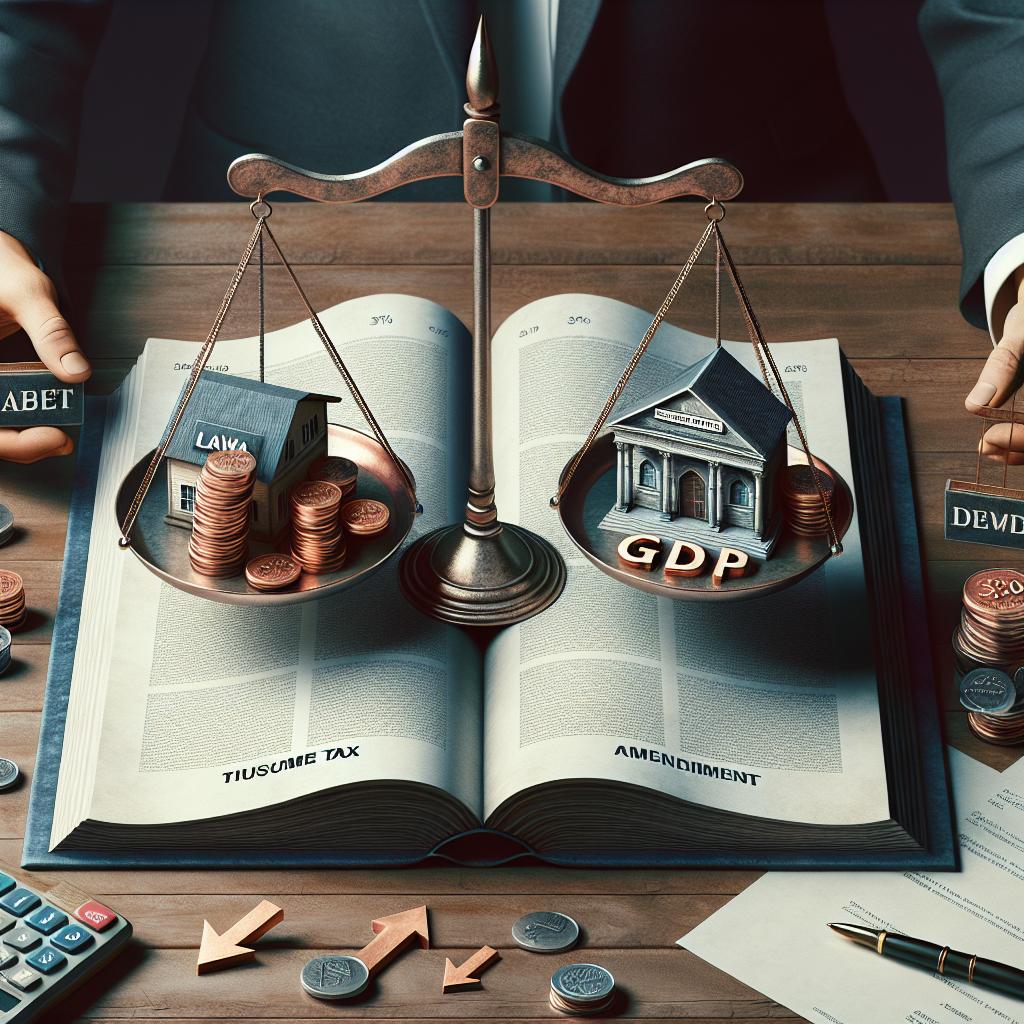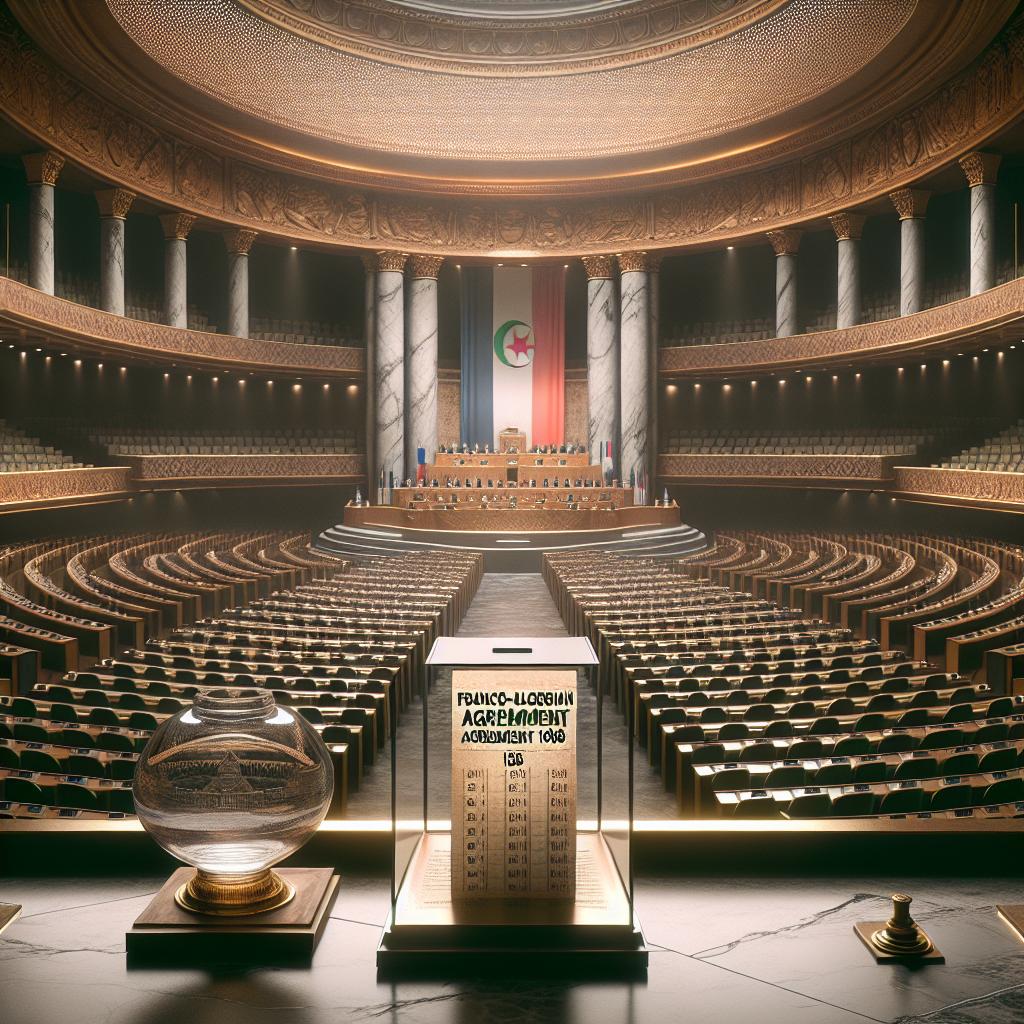La Maison de la Nouvelle-Calédonie (MNC) à Paris, créée en 1989 au lendemain de l’accord de Matignon, fermera ses portes, a annoncé lundi 22 septembre le gouvernement local. Cette décision survient « en pleine déconfiture depuis l’insurrection de mai 2024 », selon le communiqué, et illustre les difficultés financières et politiques qui affectent l’institution.
« Nous n’avons plus les moyens de nos ambitions », a regretté Alcide Ponga, président de la MNC et élu au Rassemblement-Les Républicains, cité par Les Nouvelles calédoniennes. La formulation met en lumière à la fois un bilan financier et un contexte politique profondément éprouvés.
Un symbole d’unité fragilisé
La MNC avait été pensée comme un symbole de réconciliation après plusieurs années de crise. Créée dans la foulée de l’accord de Matignon, elle visait à incarner « le destin commun » capable de rassembler les Kanak et « les autres victimes de l’histoire » calédonienne, parmi lesquelles sont mentionnés les descendants de bagnards.
La fermeture de la Maison intervient alors même qu’un projet d’accord sur l’avenir politique de la Nouvelle-Calédonie, signé en juillet à Bougival (Yvelines) entre l’État, les indépendantistes et les non-indépendantistes, reste incertain quant à sa mise en œuvre. La coïncidence renforce la portée symbolique de la décision : l’institution culturelle, dont la vocation était d’être un lieu de dialogue, disparaît au moment où le processus politique paraît fragile.
Un lieu chargé de sens et de mémoire
Installée près de l’Opéra, la Maison occupait un immeuble de standing et offrait un parcours conçu pour évoquer la culture et l’histoire calédoniennes. On y accédait par un chemin pavé de verre qui débouchait sur une grande case centrale, ornée des huit poteaux sculptés caractéristiques des aires coutumières autochtones.
Cette case jouxtait le « salon du Broussard », espace consacré à l’emblématique éleveur caldoche, et une bibliothèque destinée à conserver et valoriser des fonds documentaires sur le territoire. La configuration des lieux associait ainsi architecture, objets et récits pour traduire une volonté de rencontre entre communautés et mémoires.
Enjeux financiers et politiques
Le gouvernement local a explicitement lié la fermeture à des difficultés de financement. Les responsables de la MNC évoquent un manque de ressources pour maintenir le niveau d’activité et d’accueil attendu. Le constat d’Alcide Ponga—« Nous n’avons plus les moyens de nos ambitions »—résume une contrainte budgétaire qui frappe un espace culturel dépendant de subventions et de partenariats.
Sur le plan politique, la décision s’inscrit dans un contexte post‑insurrectionnel. L’insurrection de mai 2024 a fragilisé les institutions et modifié les équilibres locaux, selon le communiqué du gouvernement local. La mise en sommeil ou la disparition d’un acteur culturel comme la MNC pourrait avoir des répercussions sur les initiatives de dialogue interculturel déjà mises à l’épreuve.
Réactions et perspectives
Au moment de l’annonce, les réactions publiques restent mesurées dans les sources consultées. Le communiqué officiel et la citation d’Alcide Ponga, relayés par Les Nouvelles calédoniennes, font état d’un bilan préoccupant mais ne détaillent pas encore les modalités pratiques de la fermeture — calendrier, destination des collections, ou possibilités de relocalisation d’activités.
La fermeture de la MNC pose des questions concrètes sur la sauvegarde des archives et objets conservés, ainsi que sur la continuité des projets culturels et pédagogiques. Elle interroge aussi la capacité des acteurs publics et associatifs à préserver des espaces de rencontre dans un moment politique sensible.
Sans éléments nouveaux fournis par l’annonce, l’avenir immédiat de ces activités dépendra des décisions ultérieures du gouvernement local et des partenaires culturels. Pour l’heure, la disparition programmée de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris reste un marqueur fort des difficultés traversées par le territoire depuis 2024.