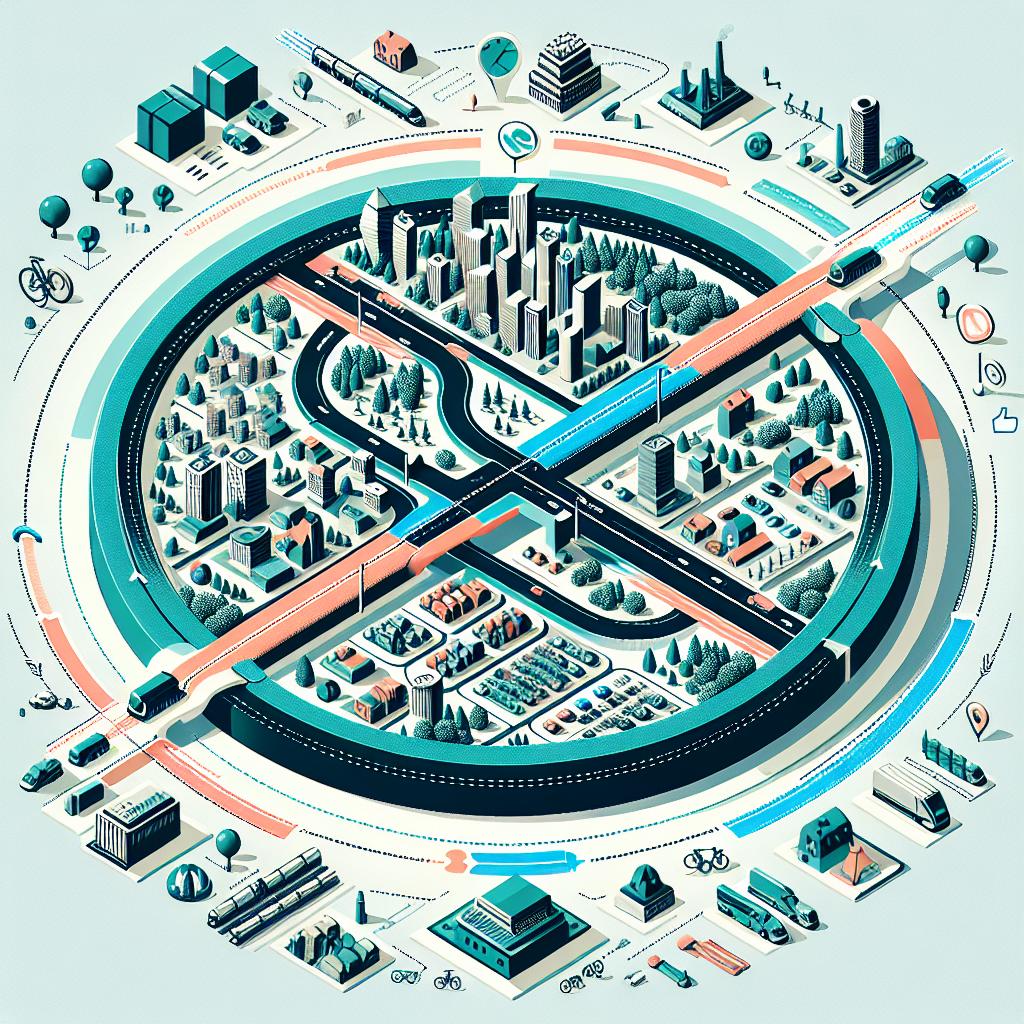La colère monte dans le monde du travail : huit syndicats majeurs ont appelé à une journée de mobilisation le jeudi 18 septembre 2025. L’appel, relayé par l’ensemble des organisations signataires, visait à traduire dans la rue un mécontentement jugé profond et durable.
Une mobilisation attendue et largement anticipée
Les autorités avaient anticipé une forte participation. Le ministère de l’Intérieur tablait sur un cortège national rassemblant entre 600 000 et 900 000 personnes, sur l’ensemble du territoire. Ces prévisions faisaient écho au mouvement « Bloquons tout » intervenu huit jours plus tôt, lors duquel le comptage officiel était d’un peu moins de 200 000 manifestants, le 10 septembre.
Le rappel chiffré de la Place Beauvau a ravivé les souvenirs de la mobilisation contre la réforme des retraites, au premier semestre 2023. À cette période, la barre du million de manifestants avait été franchie à plusieurs reprises, conférant à ce seuil une valeur symbolique que cherchent à retrouver les organisations syndicales.
Origine des actions et revendications centrales
Les actions du 18 septembre ont été annoncées le 29 août. Elles visaient en priorité la fermeture du « musée des horreurs », expression utilisée par les syndicats pour désigner l’ensemble de propositions dévoilées à la mi-juillet par François Bayrou. Ces mesures, présentées par l’ex-premier ministre comme destinées à générer près de 44 milliards d’euros d’économies dans le projet de budget 2026, ont servi de point de départ à la coalition syndicale.
Depuis l’annonce de ces idées, la direction du gouvernement a évolué : Sébastien Lecornu a succédé à François Bayrou à Matignon. Dans un premier geste politique, M. Lecornu a renoncé à la suppression de deux jours fériés, mesure qui avait été présentée par M. Bayrou deux mois auparavant. Cette concession a été mise en avant par l’exécutif comme une réponse partielle aux inquiétudes sociales, sans toutefois éteindre la contestation syndicale.
Objectifs syndicaux et signification politique
Pour les huit organisations réunies, l’enjeu dépasse le simple retrait d’une ou deux mesures. Les syndicats cherchent à remettre en cause la logique d’économie annoncée et à proposer une autre lecture des priorités budgétaires. Le rassemblement du 18 septembre s’inscrit ainsi dans une stratégie visant à peser sur l’agenda politique national et à mobiliser l’opinion publique autour de revendications sociales plus larges.
La référence répétée au million de manifestants du premier semestre 2023 montre l’importance donnée au symbole : retrouver des mobilisations de cette ampleur signifierait, pour l’intersyndicale, une capacité retrouvée à faire converger les colères et à peser sur les décisions gouvernementales.
Calendrier et perspectives
Les dirigeants syndicaux avaient planifié la journée du 18 septembre comme une étape calibrée. Annoncée fin août, l’action intervenait après une série d’initiatives locales et nationales — dont le mouvement Bloquons tout du 10 septembre — destinées à maintenir la pression avant l’examen des décisions budgétaires liées à 2026.
Sur le plan politique, la concession de M. Lecornu concernant les jours fériés illustre la volonté de Matignon d’apaiser certains points de tension. Reste à savoir si cette mesure isolée sera jugée suffisante par les organisations syndicales, qui réclament une riposte plus large face à la trajectoire d’économies annoncée.
Cette journée de mobilisation se lit donc comme un test : pour les syndicats, elle évalue la capacité à renouveler une dynamique de contestation ; pour l’exécutif, elle mesure la marge de manœuvre pour faire passer des choix budgétaires tout en limitant le coût politique d’un durcissement du conflit social.
En l’absence d’éléments nouveaux confirmés par les parties, les chiffres officiels de participation et la réaction du gouvernement après la manifestation restent des points clefs pour apprécier l’impact réel de cette journée sur la suite du débat public et budgétaire.