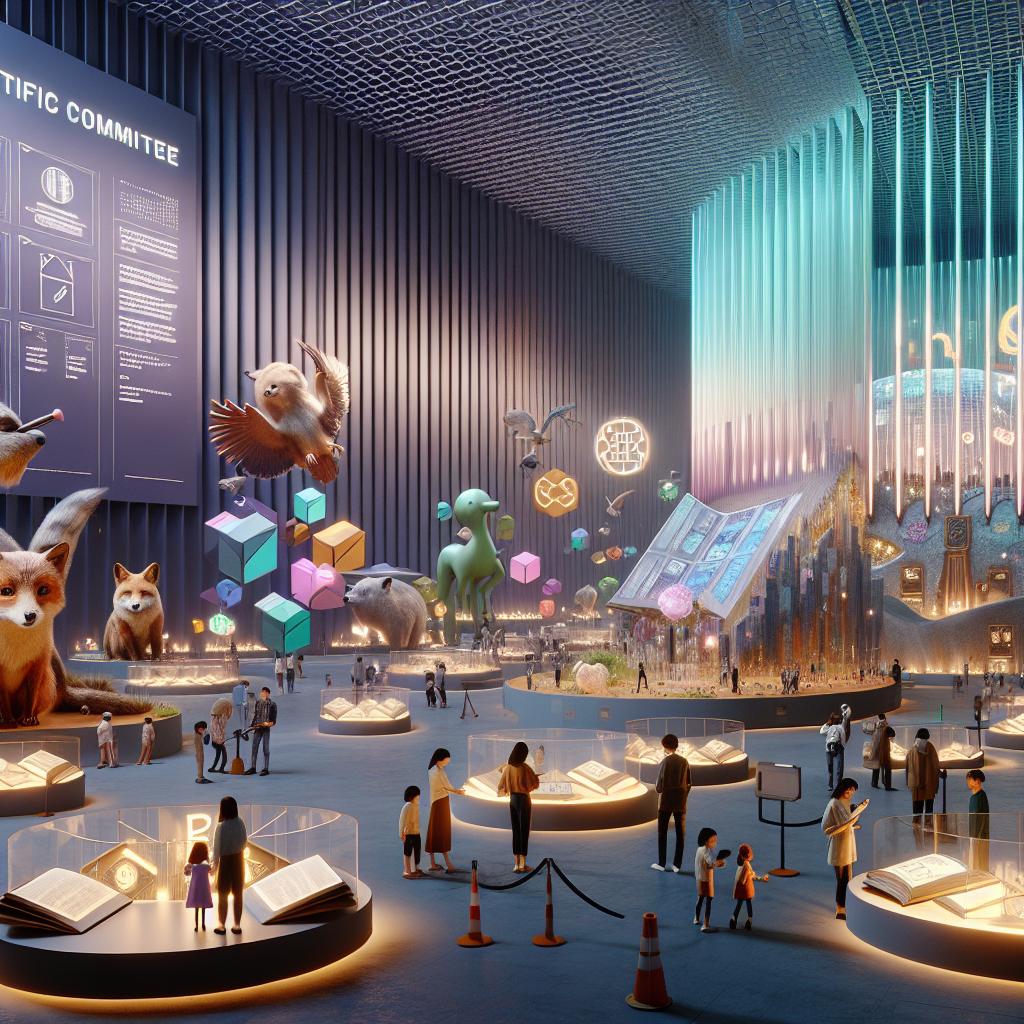Depuis les élections législatives de juillet 2024, la mécanique institutionnelle de la Ve République semble s’être emballée : successions rapides, gouvernements de courte durée et procédures inédites ont marqué une période d’instabilité politique sans précédent depuis plusieurs décennies en France. Les faits — dates et durées — font apparaître une série d’événements inhabituels qui ont nourri incompréhension et analyses contrastées dans le pays.
Une succession de gouvernements et d’événements inédits
Le 16 juillet 2024, le gouvernement de Gabriel Attal a présenté sa démission. Il a assuré les « affaires courantes » jusqu’au 5 septembre 2024, soit une période de cinquante-six jours, qualifiée de record pour la Ve République.
Il a été remplacé par Michel Barnier, dont l’action a été interrompue trois mois plus tard par une motion de censure — un renversement qui ne s’était pas produit depuis 1962, selon les éléments rapportés.
En décembre 2024, François Bayrou a été nommé à Matignon. Son passage à la tête du gouvernement a duré environ neuf mois ; il a demandé un vote de confiance sur sa politique alors qu’il savait que les députés lui refuseraient ce soutien, ce qui a précipité sa chute.
Par ailleurs, le 9 septembre 2024, Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre. Il a mené une période de consultations durant près d’un mois, a présenté une équipe gouvernementale le 5 octobre au soir, puis a remis sa démission le 6 octobre au matin, sans avoir été explicitement renversé par un vote des députés — une situation décrite comme sans précédent.
Les lectures dominantes : dissolution et retour du « régime des partis »
Depuis plus d’un an, la plupart des commentaires publics et des éditorialistes mettent en avant la dissolution anticipée de l’Assemblée nationale, intervenue en juin 2024, comme cause principale de l’instabilité institutionnelle. Cette hypothèse renvoie à des lectures historiques et constitutionnelles : certains observateurs y voient un glissement vers un fonctionnement proche de celui de la IVe République, longtemps critiquée pour sa fragilité et ses gouvernements fluctuants.
Le rappel historique est explicite. Le journaliste Joseph Barsalou, dans son ouvrage de 1964, qualifiait la IVe République de « la mal-aimée ». De son côté, Charles de Gaulle dénonçait dès 1946 le « régime des partis », qu’il considérait comme source de divisions mortelles, et il faisait du présidentialisme le rempart nécessaire à « la grandeur de la France ». Ces références sont fréquemment invoquées pour documenter la crainte d’un retour à des pratiques parlementaires perçues comme instables.
Au-delà du cadre institutionnel : facteurs politiques et sociaux
Focaliser l’analyse uniquement sur le cadre constitutionnel risque d’occulter d’autres facteurs qui contribuent à la situation : recomposition des forces politiques après les élections, rapports de force internes aux partis, fractures sociales et attentes électorales mal alignées avec les majorités parlementaires. Les mouvements d’opinion et la fragmentation politique peuvent rendre la construction d’une majorité stable plus difficile, même au sein d’un régime présidentiel.
La personnalisation de certains choix — nomination de chefs de gouvernement, demandes de vote de confiance — et la stratégie des groupes parlementaires jouent également un rôle. Des décisions prises à visée tactique peuvent accélérer des crises qui auraient pu rester circonscrites si des compromis institutionnels ou politiques avaient été privilégiés.
Conséquences et perspectives
Sur le plan institutionnel, cette série d’événements interroge la capacité des institutions à assurer une continuité de l’action publique et à préserver la lisibilité du pouvoir exécutif. Sur le plan politique, elle met en lumière la difficulté croissante à forger des majorités stables dans un paysage marqué par la pluralité des forces et par des attentes citoyennes parfois contradictoires.
Plutôt que d’annoncer une transformation radicale du régime, la période récente invite à regarder simultanément les ressorts institutionnels, les configurations partisanes et les stratégies politiques des acteurs. Comprendre la conjonction de ces éléments est nécessaire pour saisir pourquoi des procédures et des démissions, inhabituelles pour la Ve République, se sont succédé en l’espace de quelques mois.
En l’absence d’éléments nouveaux vérifiables, il reste essentiel de suivre la chronologie des décisions et des votes tels qu’ils sont consignés, et d’apprécier leur portée politique en regard des équilibres parlementaires et de l’évolution de l’opinion publique.