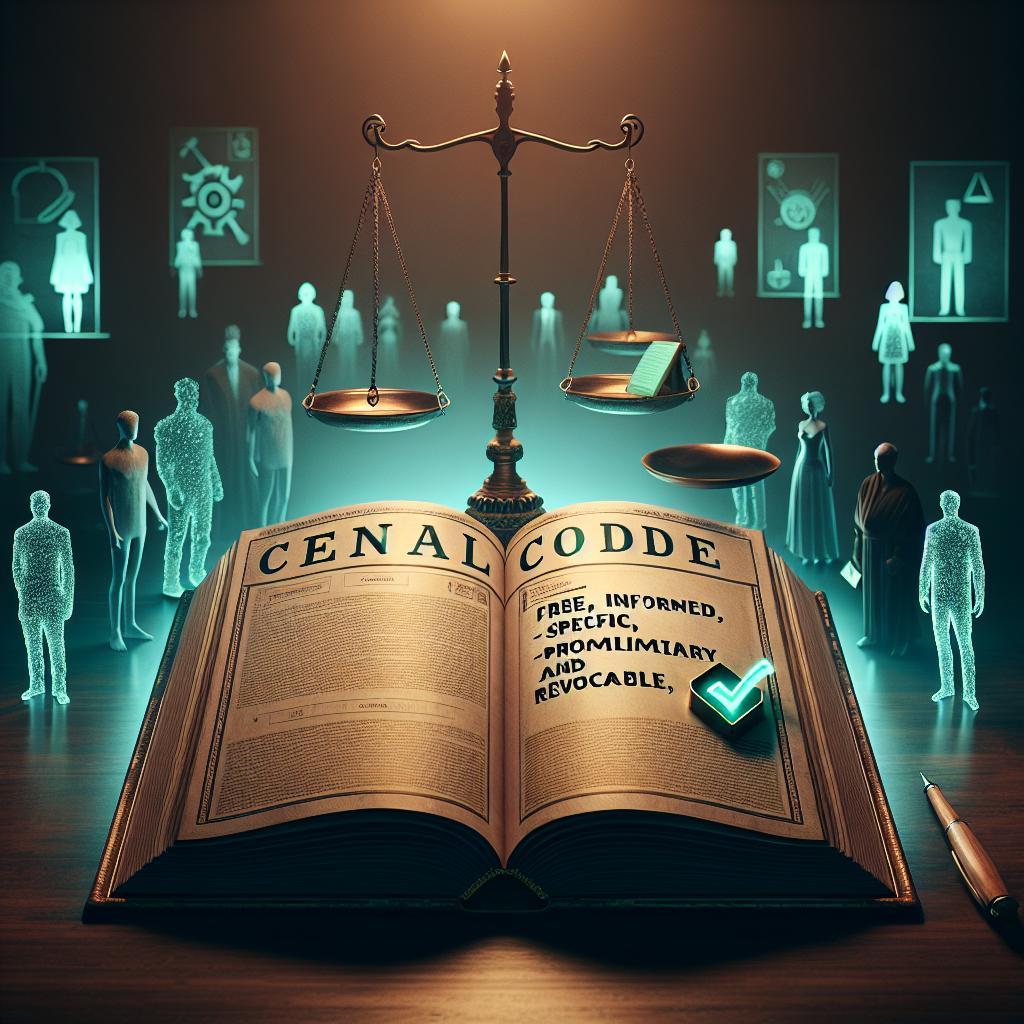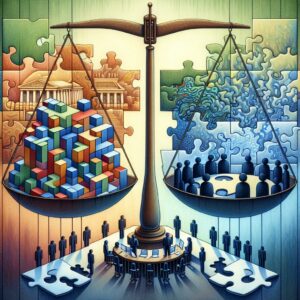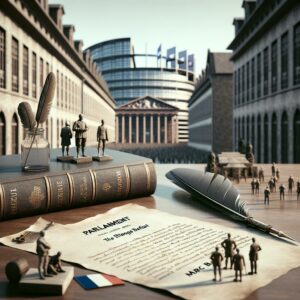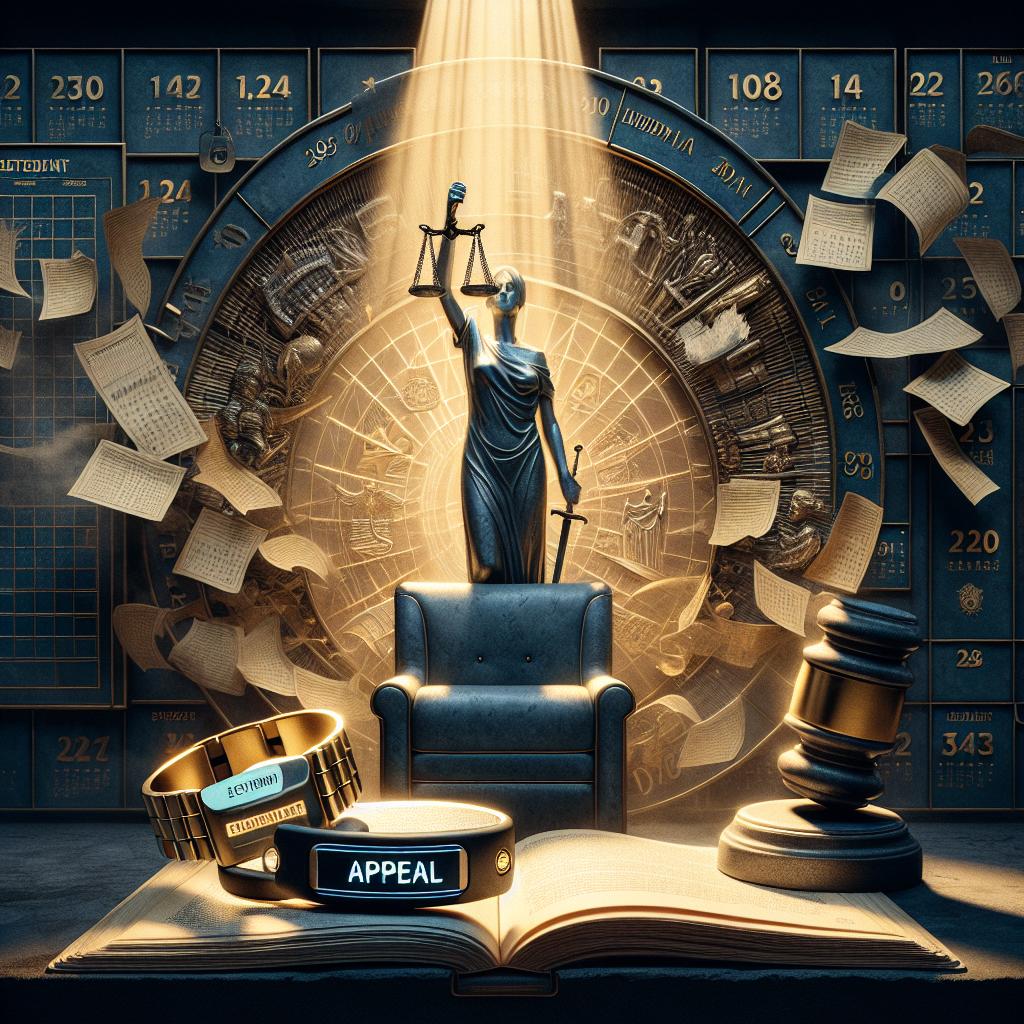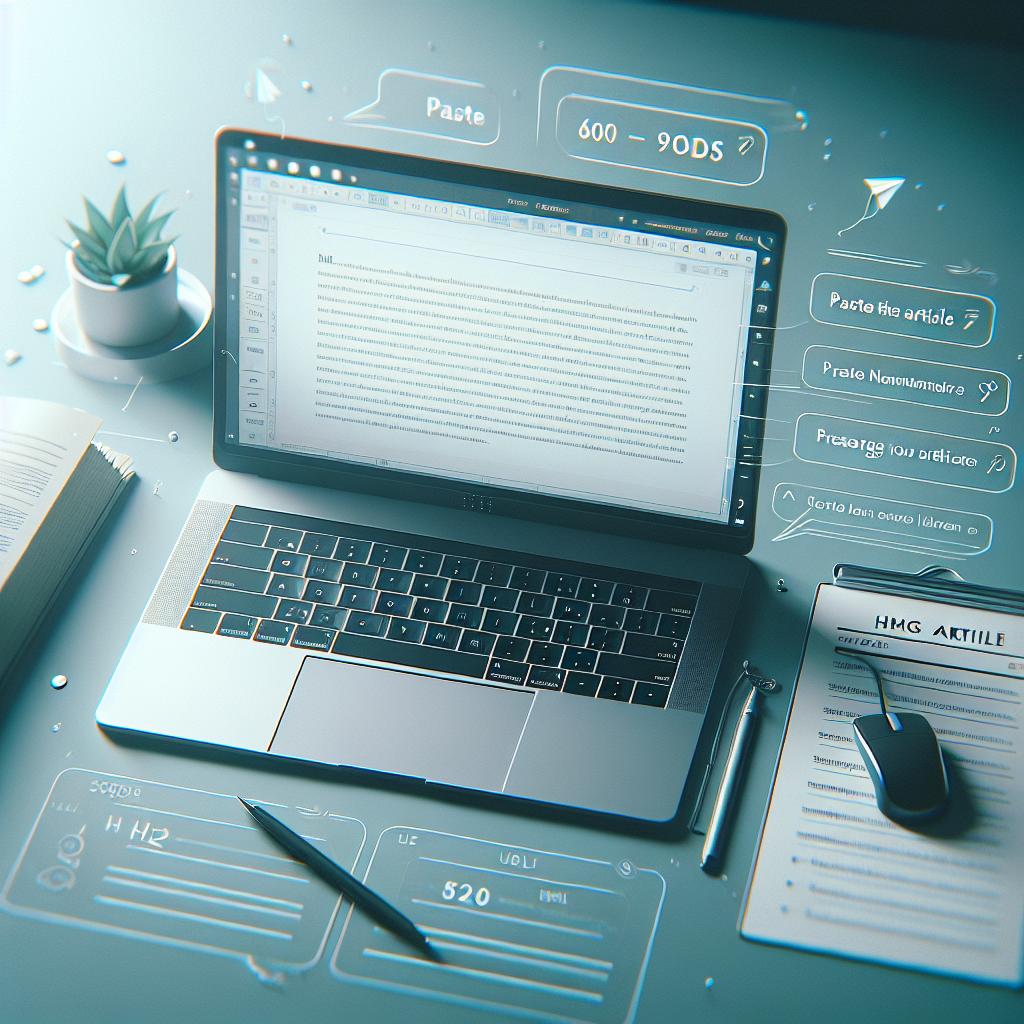Le Parlement a entériné, mercredi 29 octobre 2025, une modification majeure du code pénal qui introduit explicitement la notion de consentement dans la définition du viol, aboutissement d’un long processus législatif transpartisan et d’un large débat public.
Le texte adopté et sa procédure
La proposition de loi, portée par les députées Marie‑Charlotte Garin (EÉLV) et Véronique Riotton (Renaissance), a été définitivement adoptée par un ultime vote au Sénat : 327 voix pour et 15 abstentions. Les députés avaient déjà approuvé majoritairement le texte lors de la semaine du 20 au 26 octobre 2025.
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti. » C’est la formule qui figurera dans le code pénal dès la promulgation, annoncée pour « dans quelques jours » après la transmission au président de la République, selon le calendrier parlementaire.
Le projet a été défendu par le gouvernement, notamment par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et la ministre déléguée aux droits des femmes Aurore Bergé, qui ont soutenu le principe même s’ils étaient absents du vote final au Sénat.
Une définition du consentement encadrée
Le texte précise la portée du consentement : il sera défini comme « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Le projet ajoute que ce consentement « est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Le texte réitère en outre qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature », reprenant ainsi des critères déjà présents dans la définition des agressions sexuelles mais désormais explicités autour de la notion centrale du consentement.
Ces précisions visent à réduire l’incertitude juridique en mettant par écrit des éléments jusque‑là essentiellement construits par la jurisprudence. Un avis du Conseil d’État rendu au début du mois de mars 2025 avait par ailleurs renforcé la solidité juridique de la modification proposée, selon les travaux parlementaires.
Des soutiens, des réserves et des oppositions
Les initiatrices du texte ont salué l’adoption comme « une victoire historique ». Dans un communiqué commun, elles ont qualifié la réforme d’« avancée majeure dans la lutte contre les violences sexuelles ».
La sénatrice écologiste Mélanie Vogel a résumé l’enjeu en des termes symboliques : « Nous vivons depuis des siècles dans la culture du viol. Commençons à construire la culture du consentement ». Elle a insisté sur le fait que « le seul oui qui vaille est un oui libre ».
Pour autant, le texte n’a pas fait l’unanimité. Seule l’extrême droite s’est opposée en force au Parlement, la députée RN Sophie Blanc estimant que « les avocats devront désormais disséquer non plus la violence du coupable, mais les gestes, les mots, le silence de la personne qui se déclare victime ». Plusieurs sénateurs se sont abstenus, dont l’ancienne ministre socialiste Laurence Rossignol, qui a exprimé son regret sur le choix du mot « consentement », qu’elle juge porteur d’une « vision archaïque de la sexualité ».
Parmi les craintes soulevées pendant l’instruction du texte figurent le risque d’une inversion de la charge de la preuve et la crainte d’une « contractualisation » des relations sexuelles. Au fil des débats, nombre d’élus ont indiqué avoir été rassurés par les garanties juridiques et les clarifications apportées.
Effets attendus et demandes d’accompagnement
Plusieurs voix parlementaires ont annoncé qu’elles suivront l’impact de la réforme sur la répression des violences sexuelles. La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) a demandé que la loi soit accompagnée d’une « véritable éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle » ainsi que d’une formation des magistrats, policiers et gendarmes.
Lola Schulmann, chargée de plaidoyer chez Amnesty International France, a salué l’adoption tout en tempérant : « L’adoption de cette loi jouera un rôle crucial dans l’évolution des mentalités à l’égard du viol, mais elle ne fait pas non plus office de coup de baguette magique » pour mettre fin à l’impunité.
La réforme intervient quelques mois après le procès très médiatisé des viols de Mazan, durant lequel la question du consentement a occupé une place centrale dans les débats publics et médiatiques. Elle place désormais la France aux côtés d’autres pays ayant fait le choix d’intégrer explicitement le consentement dans leur droit pénal, cités lors des échanges parlementaires (Canada, Suède, Espagne et Norvège, cette dernière depuis le printemps 2025).
Le passage de la norme à la pratique dépendra désormais de sa mise en œuvre : appréciation judiciaire des circonstances, formation des professionnels de la justice et des forces de l’ordre, et actions éducatives, autant de leviers évoqués pour transformer la modification législative en changement effectif des comportements et des pratiques judiciaires.