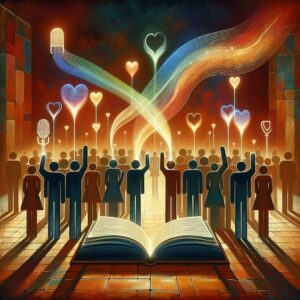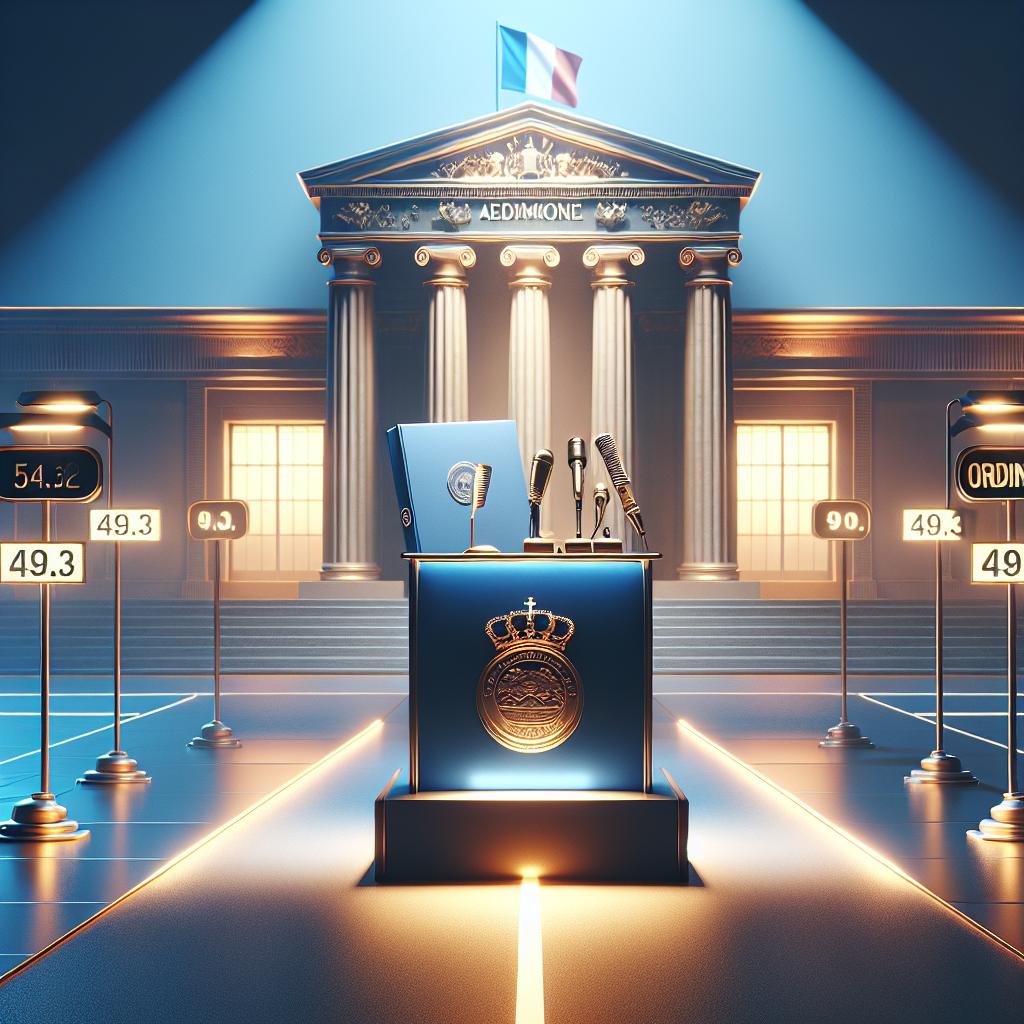Un paradoxe de gouvernance : réunions secrètes, mesures publiques
Le 7 juillet, le président Emmanuel Macron a réuni le conseil de défense et de sécurité nationale pour traiter des questions liées à la lutte contre l’islamisme, au séparatisme et à l’entrisme. Au‑delà du sujet précis, cet épisode soulève une question récurrente : pourquoi multiplier des réunions placées sous le sceau du secret quand les décisions qui en résultent sont ensuite rendues publiques ?
Ce contraste entre confidentialité des échanges et publicité des mesures illustre un mode de gouvernance fondé sur la notion de « sécurité nationale ». La pratique consiste à concentrer au sommet de l’État des arbitrages et des décisions qui, faute de transparence sur les délibérations, échappent en partie au contrôle parlementaire et à l’examen public.
Origine et importation d’un concept sans base constitutionnelle
Le concept de « sécurité nationale » tel qu’il est utilisé en France n’a pas de fondement explicite dans la Constitution. Il a été introduit dans l’appareil institutionnel français sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2008, selon la chronologie généralement admise.
Cette notion s’inspire d’un cadre anglo‑saxon plus ancien : la loi sur la sécurité nationale des États‑Unis, adoptée en 1947. En important ce concept, l’exécutif français a récupéré une logique de coordination intersectorielle — défense, sécurité intérieure, politique étrangère, économie — tout en héritant de la malléabilité et des limites associées à ce cadre.
Des contours flous et des pouvoirs élargis
La principale critique adressée à ce dispositif tient à l’absence d’une définition contraignante et précise de la « sécurité nationale ». Ce vide juridique laisse au président de la République une marge d’appréciation importante pour qualifier un sujet de « sécurité nationale » et pour en décider la gestion, y compris en dehors du champ public habituel.
Dans sa préface du livre blanc « Défense et sécurité nationale » de 2008 — texte de portée non contraignante —, le président Sarkozy écrivait que la « stratégie de sécurité nationale (…) associe, sans les confondre, la politique de défense, la politique de sécurité intérieure, la politique étrangère et la politique économique ». Cette formulation illustre la porosité des frontières entre domaines et la facilité avec laquelle un grand nombre de sujets peuvent être rattachés à la sécurité nationale.
Conséquences pour l’équilibre des pouvoirs
Selon le diagnostic exposé par les observateurs cités dans le texte d’origine, l’extension de ce concept a modifié l’équilibre des pouvoirs, en France comme aux États‑Unis. En concentrant des décisions sensibles au sein d’une instance présidée et tenue au secret, on observe une réduction de la visibilité parlementaire et citoyenne sur des choix stratégiques.
Ce mécanisme procure des avantages opérationnels : il permet une réaction rapide et une coordination resserrée face à des menaces jugées urgentes. Mais il présente aussi des « faiblesses » — pour reprendre le terme utilisé dans le document source — en matière de contrôle démocratique et de bornes juridiques clairement établies.
Un concept aux limites mal définies
Le recours à la notion de sécurité nationale, lorsqu’il reste sans définition contraignante, élargit le périmètre de l’action présidentielle. Il autorise l’intégration de domaines très variés à la stratégie de l’État et légitime des interventions parfois conduites à huis clos.
La critique principale est donc institutionnelle : faute d’avoir précisé juridiquement les contours de la sécurité nationale, la France aurait manqué l’occasion de réduire les zones d’opacité et de protéger l’équilibre entre efficacité opérationnelle et contrôle démocratique.
Ce constat ne résout pas le dilemme pratique entre la nécessité de protéger la nation et l’exigence de transparence. Il invite en revanche à réfléchir, à partir des textes et des pratiques actuels, sur les outils juridiques et politiques capables de concilier ces deux exigences.