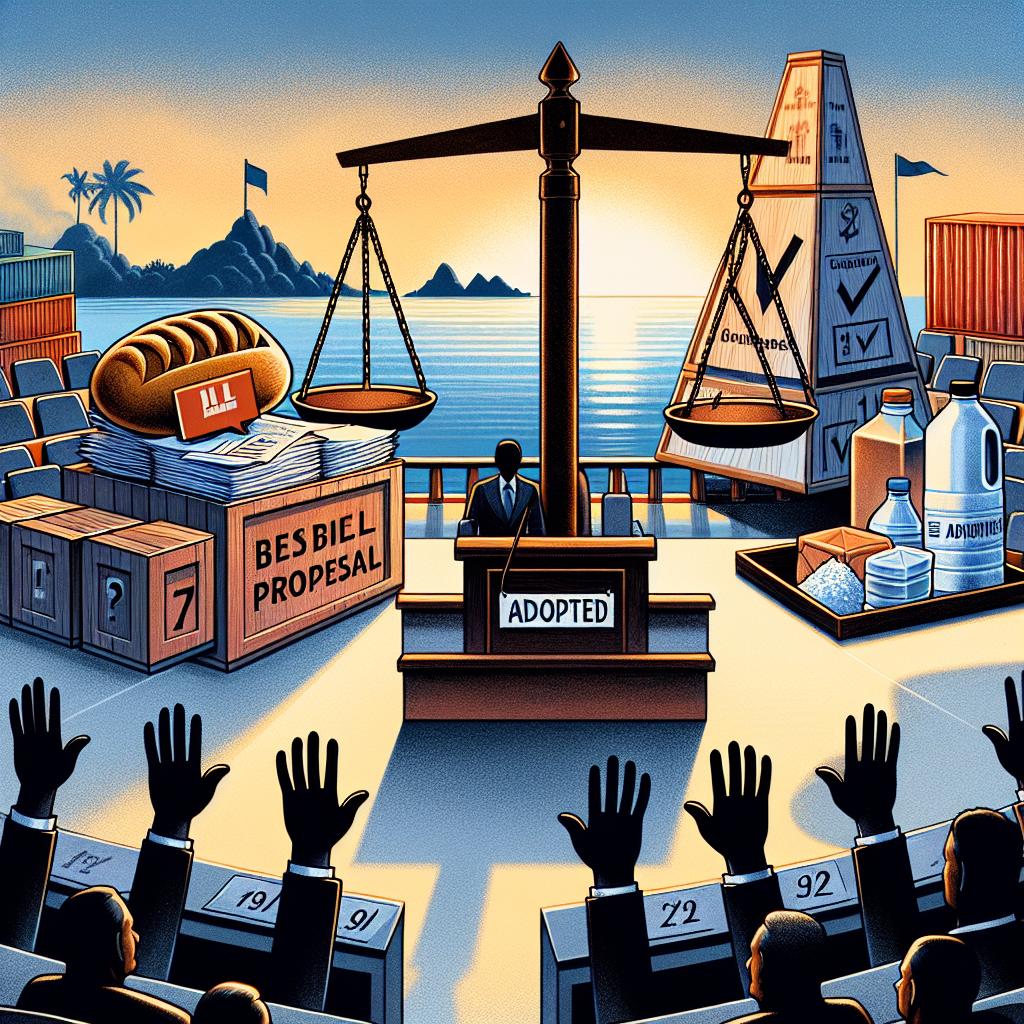La lutte contre la « vie chère » dans les territoires d’outre‑mer, qualifiée d’« urgence » par le ministre Sébastien Lecornu, a franchi une étape mercredi 29 octobre avec l’adoption par le Sénat d’un projet de loi. Le texte, porté par la ministre des outre‑mer Naïma Moutchou, a été voté à main levée et transmis à l’Assemblée nationale, mais il a été jugé largement insuffisant par de nombreux parlementaires ultramarins, qui craignent d’aggraver la déception des territoires concernés.
Un soutien formel, des réserves marquées
Le vote sénatorial a validé une quinzaine de mesures de portée technique proposées par le gouvernement. Malgré ce soutien apparent, les débats ont surtout mis en lumière l’exaspération des élus d’outre‑mer : plusieurs sénateurs originaires des territoires se sont abstenus, estimant que le texte ne répond pas aux attentes.
Plusieurs responsables ont exprimé leur déception en des termes nets. Micheline Jacques, sénatrice Les Républicains de Saint‑Barthélemy et rapporteure, a averti : « Il convient de ne pas donner de faux espoirs, qui engendreront bientôt d’amères déceptions chez nos concitoyens ultramarins. »
Dans les rangs socialistes, la sénatrice de Martinique Catherine Conconne a dénoncé « une occasion manquée » et résumé la critique ainsi : « Cette loi‑extincteur ne va pas éteindre le feu de la vie chère sous nos yeux », pointant l’absence de mesures agissant sur les revenus.
L’ancien ministre des outre‑mer Victorin Lurel a pour sa part relevé qu’« il n’y a pas un centime de mis par le gouvernement », une remarque illustrant la frustration sur l’absence d’effort budgétaire direct. Naïma Moutchou a assumé le « choix » du gouvernement de ne pas s’inscrire « dans le champ social et budgétaire », considérant que la question des revenus devait se traiter « dans la durée ».
Mesures retirées : transport et péréquation
Le Sénat a supprimé deux mesures phares du projet présenté par l’exécutif. La première visait à exclure les frais de transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP), c’est‑à‑dire la limite de prix en dessous de laquelle un distributeur ne peut revendre un produit sans s’exposer à des sanctions. Le gouvernement espérait qu’une baisse de ce seuil favoriserait une diminution des prix en rayon, notamment pour les produits de première nécessité. Les sénateurs ont toutefois estimé qu’une telle modification risquait de renforcer la position dominante des grands distributeurs plutôt que d’abaisser réellement les prix pour les consommateurs.
Le second retrait concerne la mise en place d’un mécanisme de « péréquation » destiné à réduire les « frais d’approche » — transport, taxes et autres coûts liés à l’éloignement — qui alourdissent le prix des produits importés en outre‑mer. Le gouvernement a refusé d’associer l’État à ce nouvel instrument, qui devait rassembler distributeurs et entreprises de fret maritime. Même le chef du groupe macroniste au Sénat, François Patriat, a pointé « un vrai désaccord de fond » avec l’exécutif, estimant que ce refus contrevenait à « la parole donnée » aux territoires ultramarins. Face à ces oppositions, le Sénat a supprimé la mesure, et Naïma Moutchou a reconnu que « Le projet de loi risque quelque peu d’être vidé de sa substance. »
Avancées limitées : bouclier qualité‑prix et régulation locale
Malgré ces reculs, le Sénat a approuvé plusieurs dispositions obtenant un large consensus. Le « bouclier qualité‑prix » (BQP), qui fixe un panier de produits de première nécessité, est renforcé : il vise désormais une réduction effective de l’écart des prix avec l’Hexagone, et non plus une simple modération tarifaire.
Les parlementaires ont également souhaité donner aux préfets des outre‑mer la faculté de réguler temporairement les prix en cas de crise — par exemple après une catastrophe naturelle — et ont adopté une mesure ciblée sur le prix des eaux en bouteille, un sujet récurrent et central pour ces territoires.
Un volet consacré à la transparence impose par ailleurs aux entreprises des obligations de transmission de données sur leurs marges et leurs comptes, assorties de sanctions pour non‑conformité. Un amendement socialiste a été adopté pour subordonner l’octroi d’aides publiques aux entreprises implantées en outre‑mer au respect de l’obligation de publication de leurs comptes sociaux.
Contexte chiffré et attentes territoriales
Les critiques des élus ultramarins s’appuient sur des écarts de prix significatifs. Selon l’Insee, l’écart de prix pour les produits alimentaires peut atteindre jusqu’à 42 % entre certains territoires d’outre‑mer (la Guadeloupe et la Martinique en tête) et la France métropolitaine. En Guadeloupe, les prix alimentaires auraient augmenté de 35 % sur dix ans, statistique souvent citée pour illustrer l’ampleur du phénomène.
Ces enjeux restent sensibles après les manifestations qui ont secoué la Martinique à l’automne 2024, au cœur desquelles la question du pouvoir d’achat et de la transparence des prix avait occupé une place centrale.
Transmission à l’Assemblée nationale et perspectives
Le texte adopté par le Sénat est désormais transmis à l’Assemblée nationale. Si certaines mesures techniques ont été confirmées, l’essentiel des attentes des élus ultramarins — mesures budgétaires et dispositifs de péréquation impliquant l’État — n’a pas été satisfait. Les débats parlementaires à venir détermineront si le gouvernement accepte d’amender son approche ou si la loi restera principalement un paquet de mesures techniques, au risque de décevoir les territoires concernés.