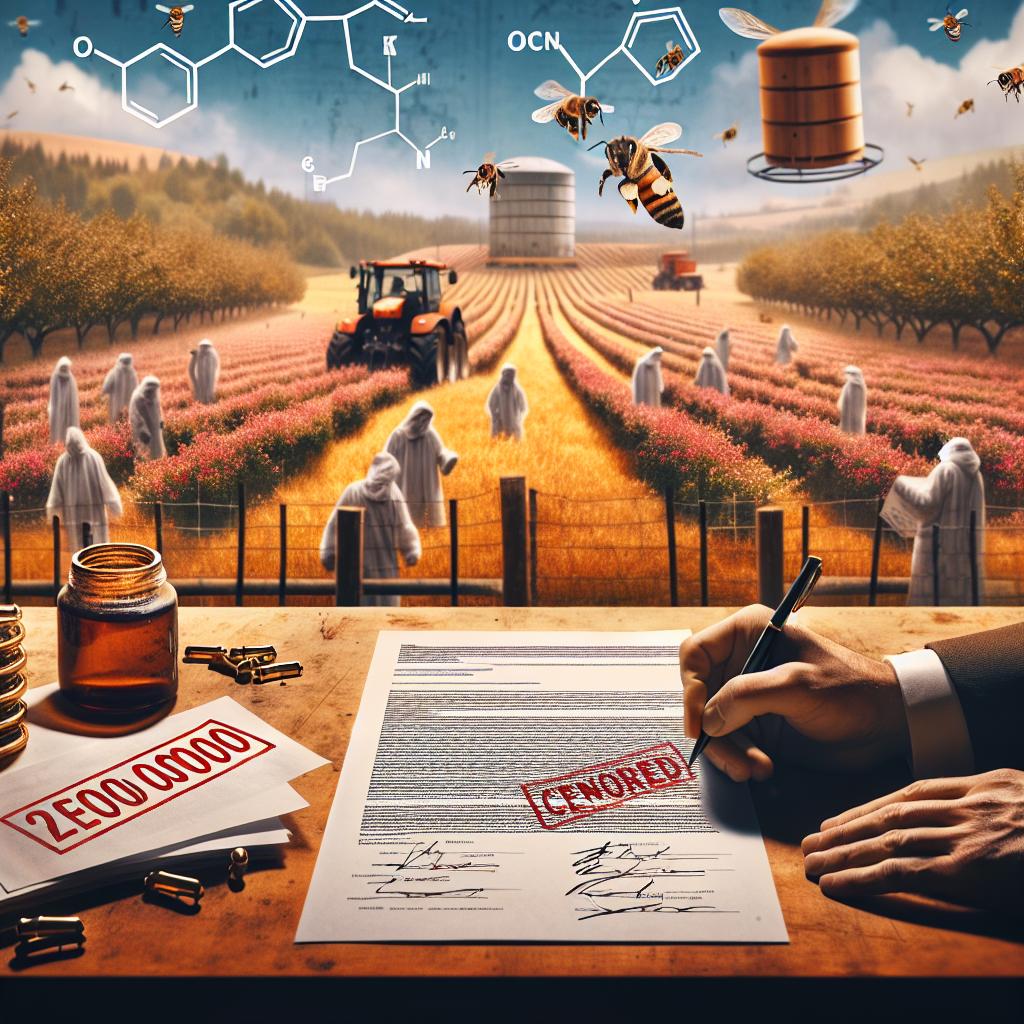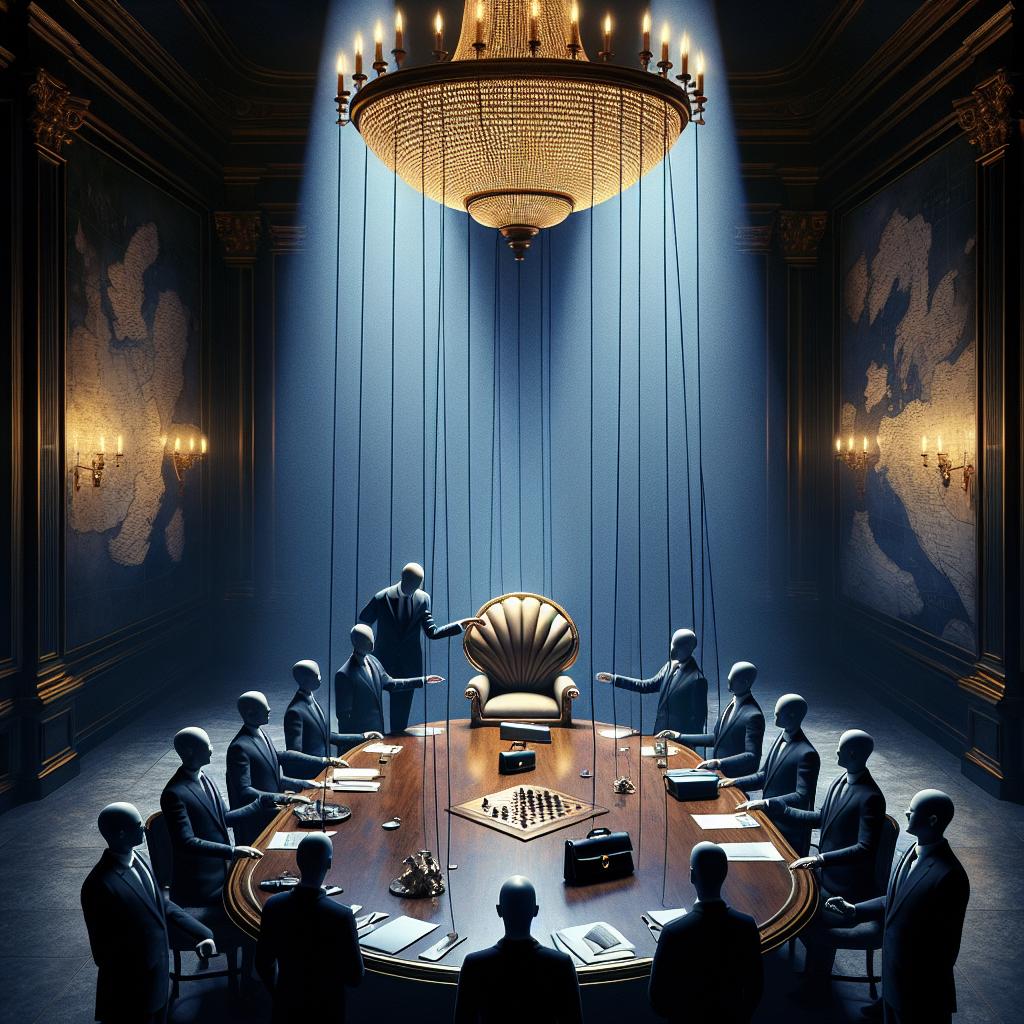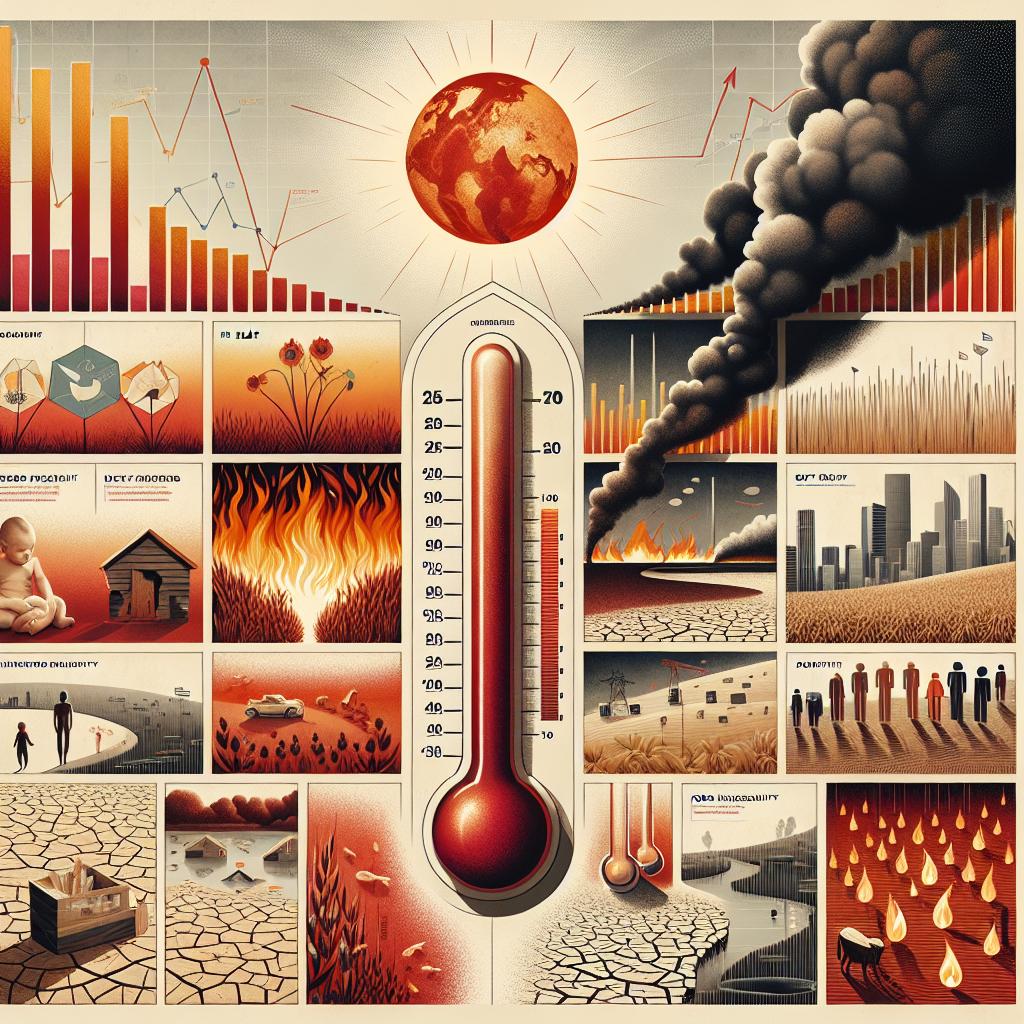Un peu plus de deux millions de signatures. C’est le nombre recueilli à ce stade par la pétition contre la loi Duplomb, lancée le 10 juillet par Eléonore Pattery, étudiante en master de 23 ans, soit deux jours après l’adoption, au Parlement, du texte porté par les sénateurs Laurent Duplomb (Les Républicains) et Franck Menonville (UDI, centre). La mobilisation illustre la polarisation du débat, autour d’un article très contesté qui porte sur la réintroduction, sous conditions, d’un insecticide de la famille des néonicotinoïdes : l’acétamipride.
Une loi partiellement censurée et promulguée
Le texte a été adopté par le Parlement puis saisi par des groupes de la gauche : entre le 11 et le 18 juillet, plus de soixante députés et sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel, contestant tant le fond de la loi que le contexte de son adoption. Les Sages ont rendu leur décision le 7 août, censurant partiellement le texte — notamment l’article 2, qui prévoyait la réintroduction sous conditions de l’acétamipride — au motif qu’une partie des dispositions déférées méconnaissait le cadre défini par la jurisprudence et la Charte de l’environnement. Le Conseil a toutefois validé d’autres mesures, comme des simplifications administratives destinées aux grandes exploitations et des dispositions concernant des ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole.
Le texte révisé a été promulgué par le président Emmanuel Macron, selon une publication au Journal officiel datée du 12 août. Le gouvernement, par la voix de la porte-parole Sophie Primas le 21 juillet, avait assuré être « soucieux d’écouter les mouvements démocratiques comme celui qui s’exprime aujourd’hui ». Malgré la promulgation, la loi n’exclut pas la possibilité qu’un nouveau texte puisse, dans des conditions strictes imposées par le Conseil constitutionnel, permettre certains usages de l’acétamipride par décret.
Acétamipride : un retour encadré et vivement contesté
L’acétamipride est un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, utilisés notamment en arboriculture (noisetiers, fruits à pépins, pêchers, cerisiers, pruniers, agrumes, framboisiers) et pour la production de légumes, selon le ministère de l’Agriculture. Son usage « définitif » est interdit en France depuis 2020, mais la substance a été autorisée en 2018 sur le marché unique européen jusqu’en 2033, et reste autorisée dans d’autres États membres.
Le point le plus sensible du texte visait à permettre, par décret — en cas de « menace grave compromettant la production agricole » et en l’absence d’alternative suffisante — la réintroduction temporaire et strictement encadrée de l’acétamipride. Le texte prévoyait également une réévaluation au bout de trois ans par un conseil de surveillance destiné à évaluer les conditions des dérogations accordées.
Les organisations agricoles — FNSEA, Coordination rurale — et certains producteurs (betteraves sucrières, arboriculteurs) ont plaidé pour cette possibilité, invoquant l’absence d’alternatives efficaces et la crainte d’une concurrence déloyale si d’autres pays européens continuent à utiliser la substance. À l’opposé, défenseurs de l’environnement et apiculteurs ont dénoncé la réintroduction possible de néonicotinoïdes, substances régulièrement pointées pour leur forte toxicité envers les abeilles et leur rôle dans le déclin des pollinisateurs.
Le Conseil constitutionnel a souligné que, faute d’encadrement suffisant, les dispositions prévues « méconnaissaient le cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l’environnement ». Par ailleurs, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a « déploré l’adoption » du texte [désormais partiellement censuré, ndlr], tandis que des eurodéputés, comme David Cormand (Verts/ALE), ont jugé que la loi « va à rebours de l’ensemble des analyses et études scientifiques ».
Règles européennes, limites de résidus et conséquences commerciales
La réglementation des pesticides relève, au niveau commercial et d’utilisation, de l’Union européenne. Une substance ne peut être mise sur le marché que si elle obtient l’approbation de la Commission européenne, fondée sur l’avis scientifique d’une agence de l’Union — principalement l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Une autorisation européenne est temporaire (au maximum 15 ans) et peut être renouvelée périodiquement ; la Commission fixe aussi les limites maximales de résidus (LMR) dans les aliments.
La Commission européenne a communiqué, au préalable, les dossiers évalués à l’appui de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, concluant que les LMR demandées pour certains produits étaient acceptables. Le règlement publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet a réévalué les LMR d’acétamipride pour plusieurs denrées : par exemple, 0,04 mg/kg pour les prunes et 0,3 mg/kg pour le miel.
Ces décisions techniques ont des retombées commerciales : même si la loi française est promulguée sans réintroduire automatiquement l’acétamipride, d’autres États membres restent autorisés à utiliser la substance et peuvent exporter des aliments présentant des concentrations plus élevées, ce qui inquiète certains acteurs agricoles français. Sur ce volet, le débat mêle choix de santé publique, exigences scientifiques et contraintes économiques.
En réponse aux inquiétudes, l’État a engagé des mesures : délivrance d’autorisations de mise sur le marché (AMM) pour des solutions de substitution, mobilisation de 140 millions d’euros dans le cadre de la planification écologique pour soutenir la recherche de solutions alternatives et l’accompagnement de filières. Les autorités sanitaires nationales (Anses) et européennes (EFSA) continuent, par ailleurs, de suivre et contrôler les résidus dans les produits agricoles, conformément aux limites fixées au niveau communautaire.
Le dossier reste sensible et illustre la tension entre exigences environnementales, contraintes économiques et cadre juridique européen, alors que la société civile et les professionnels agricoles se trouvent de nouveau face à des visions opposées de l’avenir de l’agriculture en France.