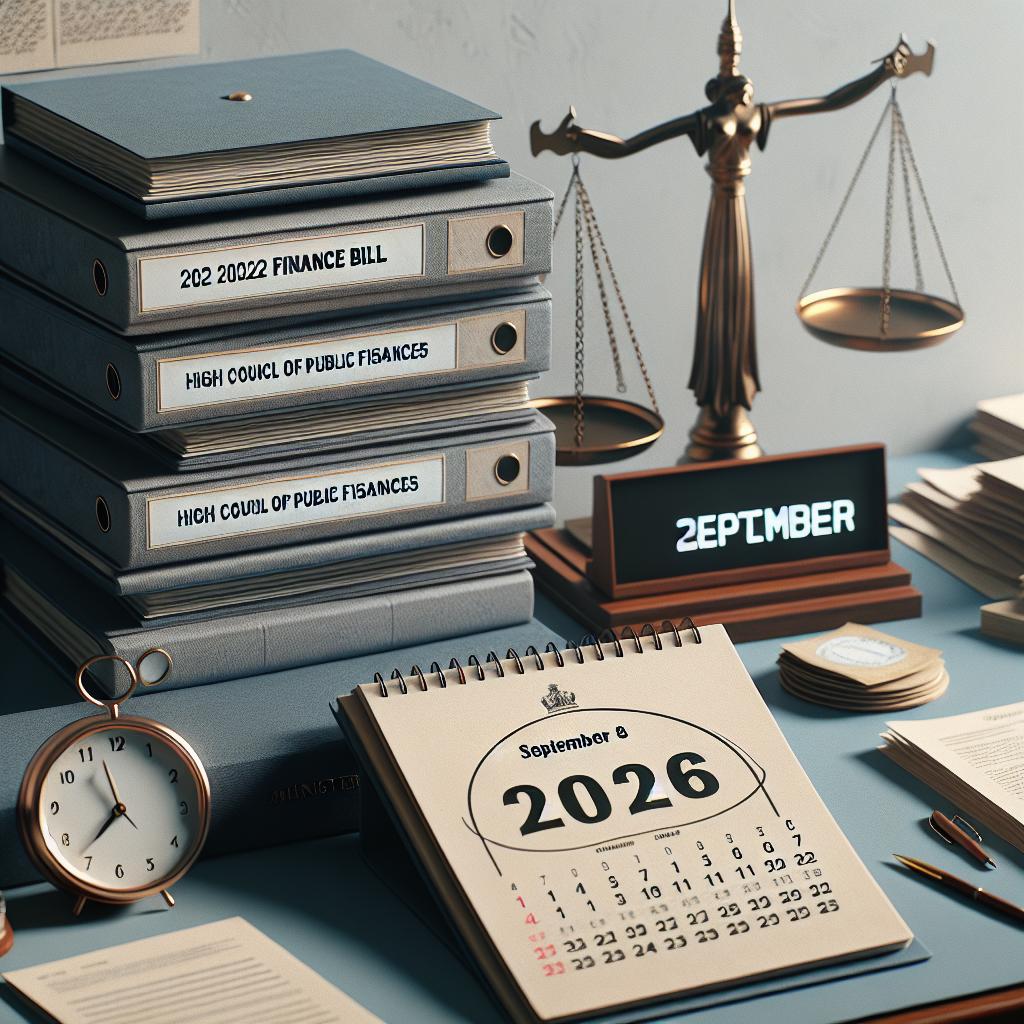Le Conseil constitutionnel a rendu, jeudi 7 août, une décision très attendue sur la loi dite « Duplomb », jugeant certaines de ses dispositions contraires à la Constitution et censure notamment l’article 2 qui prévoyait la réintroduction sous conditions de l’acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes.
Les motivations de la censure
Dans sa décision, le Conseil estime que « faute d’encadrement suffisant, les dispositions déférées (à l’article 2) méconnaissent le cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l’environnement ». Les Sages jugent que l’article en question ne fixe pas de garanties suffisantes pour concilier l’objectif poursuivi par le législateur et les exigences de protection de l’environnement et de la santé publique énoncées par la Charte.
En revanche, le Conseil a validé plusieurs autres mesures du texte, notamment des simplifications administratives accordées aux plus gros élevages et des dispositions visant la construction d’ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Le gouvernement a été invité à promulguer le texte résultant de la décision « dans les meilleurs délais » selon l’Élysée.
Un texte largement approuvé mais contesté
Le projet de loi, adopté le 8 juillet par l’Assemblée nationale par 316 voix contre 223, affichait comme objectif de « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Au cœur des divisions se trouvait précisément la réintroduction conditionnelle de l’acétamipride, substance considérée par ses détracteurs comme dangereuse pour l’environnement et la santé publique.
La disposition relative à l’acétamipride avait, selon ses partisans, un caractère protecteur des productions nationales face à la concurrence. Des sénateurs et le promoteur de la loi ont d’ailleurs souligné que l’autorisation de cette substance remontait à 2018 sur le marché unique européen et court jusqu’en 2033. La France, pour sa part, avait plaidé en 2020 auprès de ses homologues européens en fournissant de nouvelles données scientifiques visant à démontrer la toxicité du produit.
Dans l’opinion publique, la question a pris une tournure militante : une pétition lancée le 10 juillet par Éléonore Pattery, étudiante de 23 ans, réclamant l’abrogation de cette mesure, a réuni plus de 2,1 millions de signatures, selon les chiffres rapportés au moment des débats.
Le texte a suscité des réactions contrastées. À l’issue de la décision du 7 août, le sénateur à l’origine de la loi a exprimé sa « surprise » et son « mécontentement » quant à la censure de l’article relatif à l’acétamipride, alors que, selon lui, « 80 % » du texte avait été approuvé. Il a estimé que la décision pouvait toutefois fournir « les éléments qui pourraient permettre, avec un nouveau texte, de trouver des solutions pour pouvoir peut‑être réintroduire » la substance contestée.
Laurent Duplomb avait auparavant appelé, le 20 juillet, à « accepter les règles du jeu européen » et dénoncé l’effet de distorsion de concurrence que créerait selon lui une interdiction maintenue par la France.
Du côté de l’exécutif, l’Élysée a indiqué que le président de la République, Emmanuel Macron, « a pris bonne note de la décision du Conseil constitutionnel » et qu’il « promulguera » le texte dans les meilleurs délais, en l’état du contrôle exercé par l’institution.
Sur le plan juridique, la décision du Conseil constitutionnel est définitive : les Sages disposent de « l’autorité de la chose jugée » et leurs décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, conformément à l’article 62 de la Constitution.
Plusieurs anciens responsables et observateurs institutionnels ont commenté, parfois avec réserve, les modalités procédurales entourant l’examen du texte. L’ancien ministre de la Justice Jean‑Jacques Urvoas, le 3 août, a souligné les difficultés internes de l’institution face à certaines manœuvres procédurales et a appelé à la protection du droit d’amendement garanti par la Constitution.
Les Sages rappellent aussi que, lors d’un précédent examen en 2020, ils avaient autorisé une remise temporaire sur le marché de néonicotinoïdes pour protéger les cultures de betteraves sucrières menacées par des pucerons, décision expliquée alors par le caractère transitoire de la mesure en attendant des solutions de remplacement. Cette jurisprudence antérieure joue dans l’analyse actuelle, même si le Conseil a, dans le cas présent, jugé l’encadrement insuffisant.
La censure de l’article 2 marque un tournant dans le débat national sur l’usage des néonicotinoïdes et la manière dont les exigences environnementales et agricoles doivent être conciliées dans la loi. Le gouvernement dispose désormais d’un délai très court pour adapter le texte si son objectif est de trouver une solution conforme aux exigences constitutionnelles et à la Charte de l’environnement.