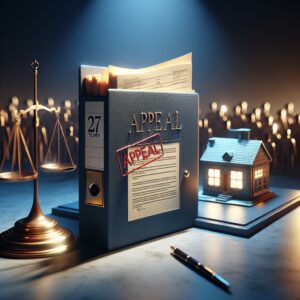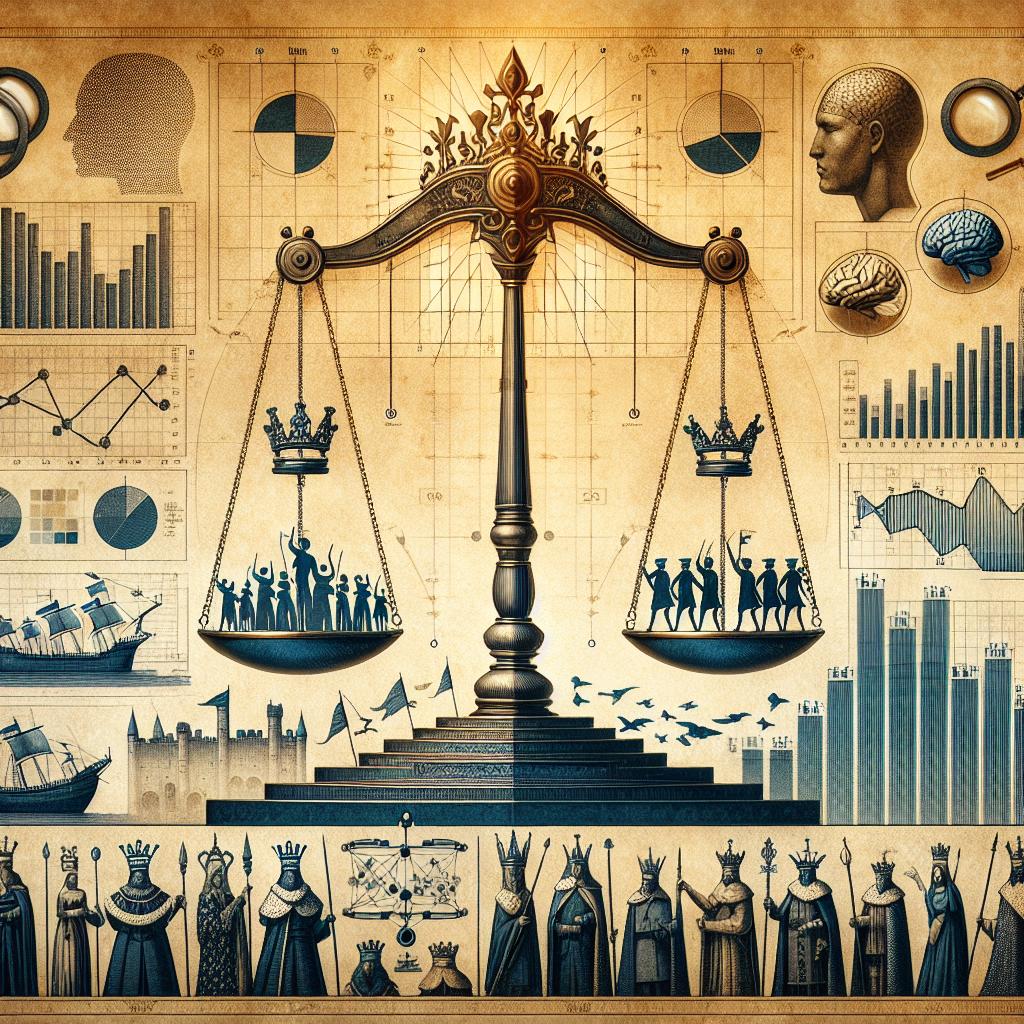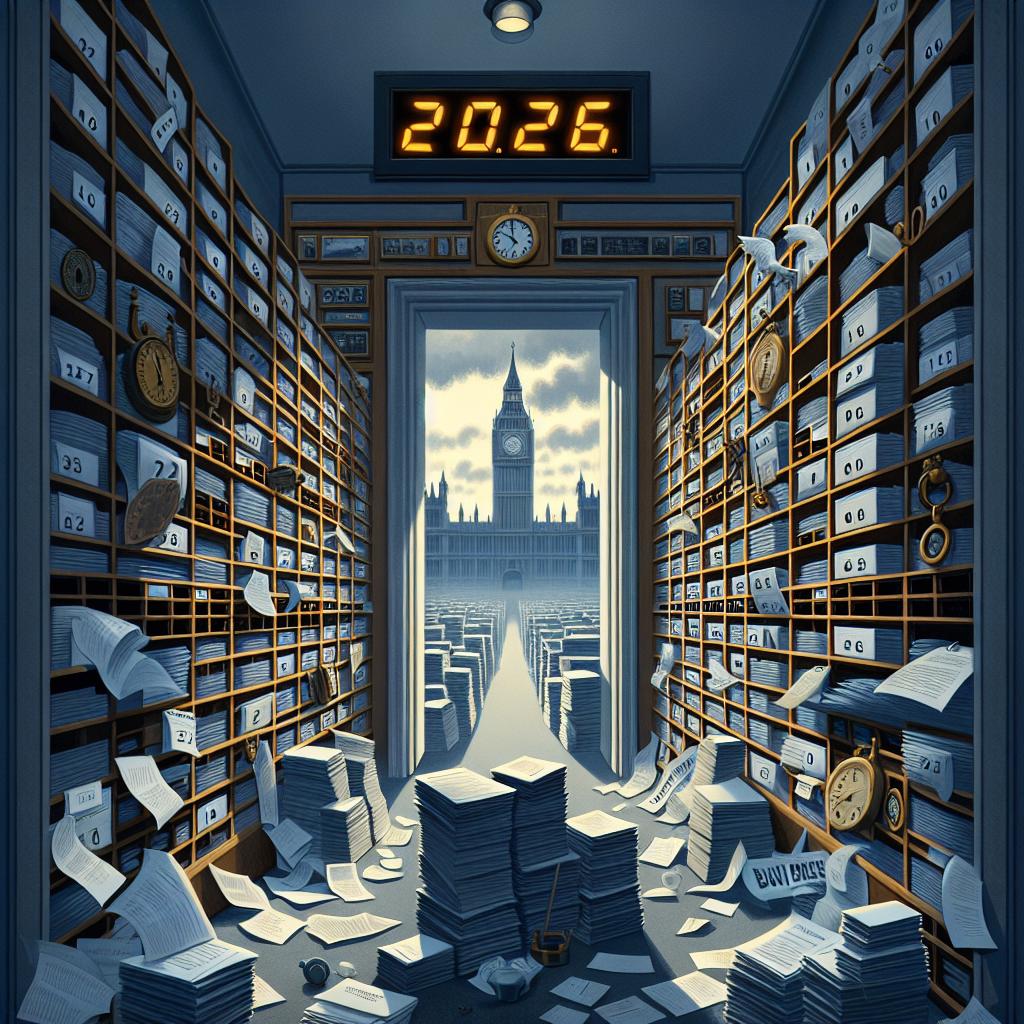Face à une crise politique aux épisodes répétés, il est utile de revenir à quelques constats simples : à l’Assemblée nationale, seules La France insoumise (LFI) — qui réclame la destitution du président de la République — et le Rassemblement national (RN) — qui appelle à la dissolution de l’Assemblée et parie sur des gains aux législatives anticipées — semblent prêts à durcir le jeu. En revanche, aucune des autres forces parlementaires n’a d’intérêt stratégique à provoquer une paralysie budgétaire en 2026.
Un basculement possible si la majorité s’unit
Si la droite, la gauche et le centre trouvaient un terrain d’entente autour de l’objectif prioritaire de stabiliser la situation avant la présidentielle de 2027, ils disposeraient numériquement des moyens de neutraliser les extrêmes sans que cela soit perçu comme une capitulation politique : les débats programmatiques majeurs seraient alors renvoyés à la campagne présidentielle, selon la logique exposée dans le texte d’origine.
Cette option, qui paraît rationnelle sur le papier, bute toutefois sur des résistances internes et des calculs électoraux puissants. Ces résistances ont déjà eu des conséquences concrètes : deux premiers ministres, Michel Barnier puis François Bayrou, ont été renversés en l’espace d’un an. Leur remplacement par Sébastien Lecornu, troisième titulaire du poste dans ce laps de temps, illustre la fragilité du poste et l’instabilité que traverse l’exécutif.
Le pari et la fragilité de Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées, a tiré des leçons des revers de ses prédécesseurs et affiché une posture moins interventionniste vis‑à‑vis du Parlement. Selon le texte d’origine, son humilité et sa reconnaissance que le pouvoir s’est déplacé vers l’hémicycle jouent en sa faveur. Il a notamment promis aux députés de renoncer à l’usage de l’article 49.3 de la Constitution, un engagement lourd de sens politique depuis la réforme des retraites.
Pourtant, en l’absence d’une coalition affichée et stable, son mandat reste précaire. Le dilemme est simple et brutal : s’il concède trop au Parti socialiste (PS), il risque de perdre une partie de la droite ; s’il n’en concède pas assez, la menace d’une motion de censure et d’une chute reste présente. Le texte original souligne que ce délicat équilibre conditionne la survie du gouvernement.
L’article 49.3 : un symbole politique
L’article 49.3, rappelé dans l’article original, est devenu le symbole d’un pouvoir « enfermé » depuis la crise autour de la réforme des retraites. Utilisé pour faire adopter des textes sans vote, il s’est transformé en point de cristallisation pour les oppositions et en motif d’hostilité pour l’opinion publique. Le geste de Lecornu — promettre de l’abandonner — vise à apaiser les tensions et à restaurer un rapport de confiance avec les députés, mais il ne suffit pas à créer une majorité solide.
La portée réelle de cet engagement dépendra de la capacité du premier ministre à transformer un simple abandon procédural en concessions politiques tangibles. Sans accords clairs sur les grands sujets budgétaires et législatifs, le retour de la menace de censure demeure une possibilité concrète.
L’impopularité présidentielle et ses répercussions
Le blocage persistant s’explique en grande partie par l’impopularité du chef de l’État. Selon l’enquête Ipsos intitulée « Fractures françaises », réalisée pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l’Institut Montaigne, publiée le 20 octobre (date fournie dans le texte original, année non précisée), 58 % des Français souhaiteraient la démission du président de la République. Cette statistique, citée telle quelle dans le document source, éclaire le climat politique : nul ne veut être perçu comme la béquille d’un exécutif honni depuis la dissolution controversée de juin 2024.
Depuis cette dissolution, explique le texte initial, Emmanuel Macron est souvent considéré comme le principal responsable de l’impasse politique. Ce jugement public pèse sur la stratégie des partis : accepter d’apparaître en soutien de l’exécutif revient à prendre un risque électoral majeur, tandis que s’en démarquer peut conduire à des ruptures institutionnelles.
Dans ce contexte, le maintien d’un calendrier budgétaire normal pour 2026 apparaît comme un objectif prioritaire et consensuel — mais difficile à atteindre. Les arbitrages nécessaires exigeraient une série d’accords transversaux, qui ne sont, pour l’instant, ni formalisés ni suffisamment consensuels pour garantir la stabilité jusqu’à la présidentielle de 2027.
Au terme de l’analyse proposée dans le texte d’origine, la situation politique demeure donc marquée par une double réalité : la possibilité technique d’un blocage des extrêmes existe si les forces modérées s’unissent, mais la réalité politique — faite de suspicions, d’impopularité présidentielle et de calculs électoraux — rend cette union improbable sans concessions claires et visibles.