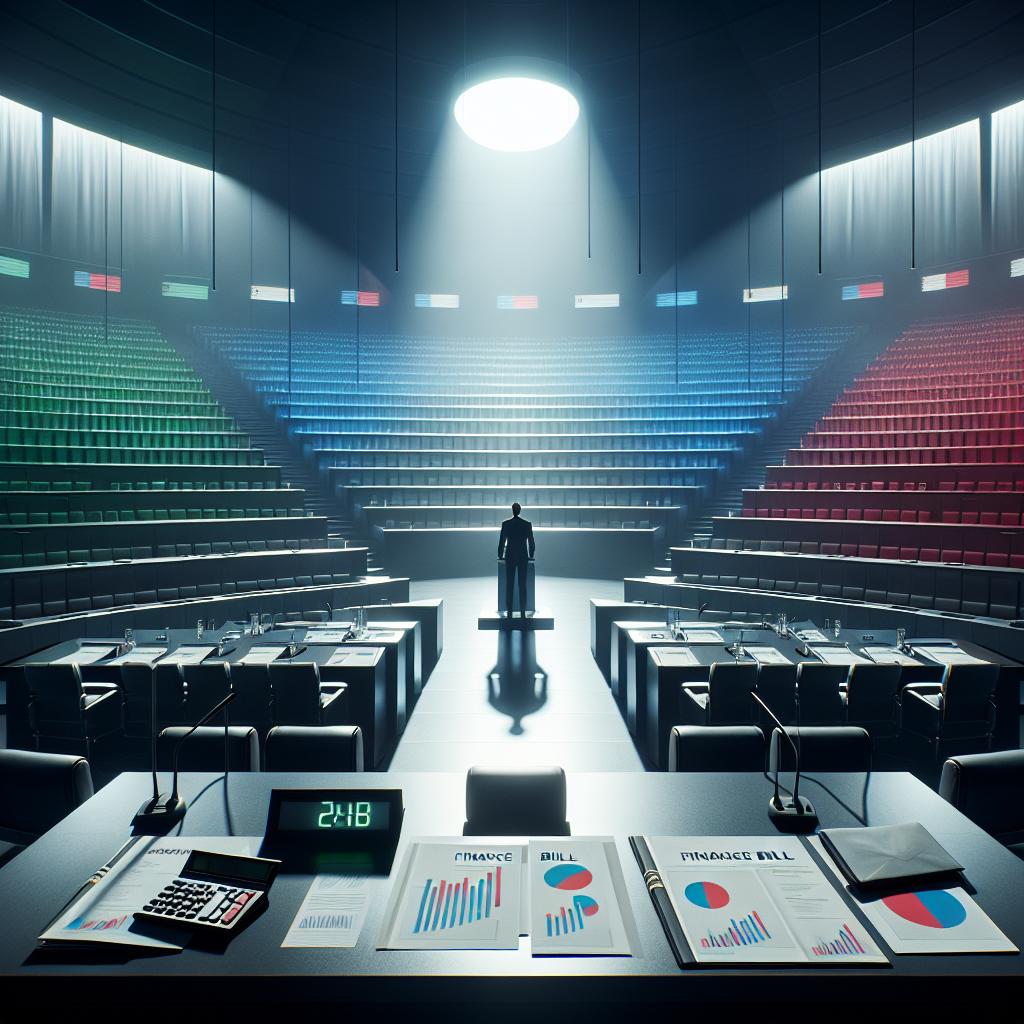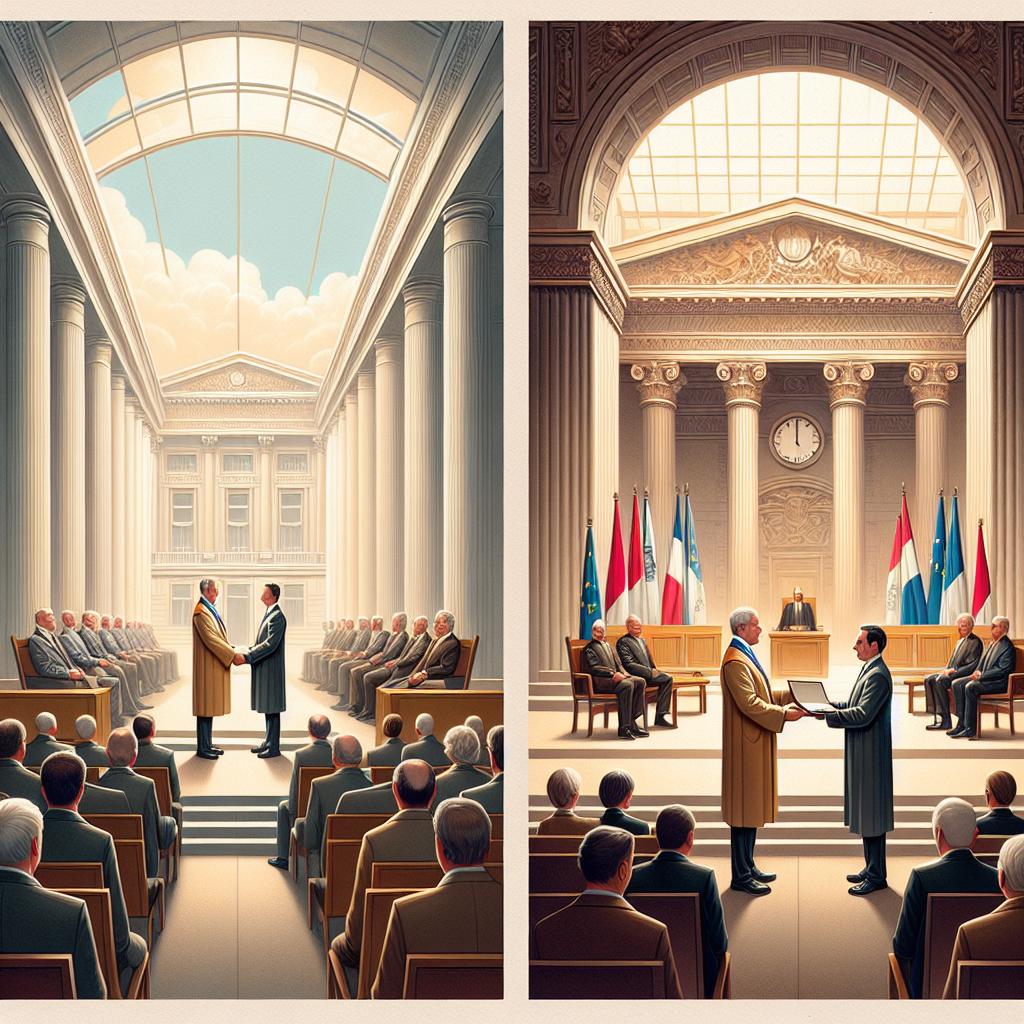Dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 novembre, la première partie du projet de loi de finances — celle portant sur les recettes — a été rejetée à la quasi-unanimité des députés. Un vote qualifié d’inédit, « du jamais‑vu sous la Ve République », qui met en lumière une situation politique nouvelle : les groupes censés soutenir l’exécutif se sont massivement abstenus, privant le texte d’un soutien attendu et questionnant la cohérence de la majorité parlementaire.
Une majorité fragilisée et l’abstention du « bloc central »
L’abstention du centre interpelle : comment expliquer qu’un bloc traditionnellement considéré comme clé pour la stabilité gouvernementale refuse de valider un texte budgétaire ? Ce comportement a isolé le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, présenté dans le texte comme « le plus faible » de la Ve République, selon ses propres mots.
Face à cette situation, les formations de gauche et d’extrême droite parient sur l’échec du gouvernement pour provoquer un retour rapide aux urnes. Le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI) misent sur cette déstabilisation, tandis que le Parti socialiste (PS) se place à part, revenant au centre du jeu politique et s’éloignant de son rival radical. Cette recomposition fragilise encore davantage les marges de manœuvre de l’exécutif.
La « méthode Lecornu » : dialogue et concessions, mais sans résultat garanti
Depuis sa prise de fonctions, M. Lecornu a privilégié une méthode fondée sur le dialogue et la concession. Il a notamment renoncé à recourir à l’article 49.3 de la Constitution et suspendu la réforme des retraites, deux gestes destinés à apaiser les tensions et à obtenir, au minimum, la neutralité du PS.
Pourtant, cette stratégie n’a pas produit les effets escomptés. Le PS, qui avait fait du renoncement au 49.3 une demande prioritaire, redoute un « compromis historique » avec le centre qui pourrait l’exposer aux critiques de la gauche. Résultat : le parti socialiste se retrouve dans une posture délicate, critiqué par ses partenaires de gauche pour s’être trop rapproché du gouvernement, tandis que pour l’exécutif, la fiabilité du PS reste à démontrer.
Plusieurs voix écologistes et socialistes réclament désormais la conclusion d’un accord global avec le bloc central pour permettre l’adoption du budget et sortir de la crise. À ce stade, ces appels n’ont pas suffi à faire reculer l’impasse politique.
Délais constitutionnels et options à court terme
La contrainte temporelle pèse lourd : la Constitution impose que les textes budgétaires soient promulgués avant le 31 décembre pour entrer en vigueur le 1er janvier. Le texte évoque qu’il reste « un peu moins de quarante jours », conditionnant l’urgence des décisions à venir.
Face à ce calendrier, le gouvernement se trouve devant deux options restrictives. La première, l’adoption par ordonnances, a été écartée par M. Lecornu. La seconde est le recours à une « loi spéciale », solution déjà utilisée en 2024, qui organise le fonctionnement financier provisoire de l’État jusqu’au vote d’un budget. Cette voie évite un blocage immédiat, mais comporte des conséquences : elle accroît l’instabilité économique, alourdit le déficit et prolonge l’incertitude politique.
Priorités affichées et conséquences stratégiques
Convaincu qu’une majorité existe sur certaines questions, le Premier ministre propose d’ouvrir, à l’Assemblée nationale, le débat sur cinq « priorités absolues » : le déficit, la réforme de l’État, l’énergie, l’agriculture, ainsi que la sécurité intérieure et extérieure. Il demande ensuite à toutes les formations politiques et aux partenaires sociaux de se « positionner » sur ces thèmes.
Reste à savoir si ce calendrier politique permettra de sortir de l’impasse. Le recours prolongé à des dispositifs temporaires ferait peser un risque de paralysie, notamment dans un contexte où la hausse des crédits de la défense est jugée nécessaire face à une menace russe présentée comme croissante.
Les prochains jours s’annoncent déterminants : le gouvernement doit soit convaincre suffisamment d’élus pour adopter le projet de loi de finances tel quel, soit trouver un compromis politique assez large pour valider un budget avant la fin de l’année. À défaut, la France devra se résoudre à des solutions provisoires, au risque d’aggraver la crise économique et politique et de retarder des décisions stratégiques.