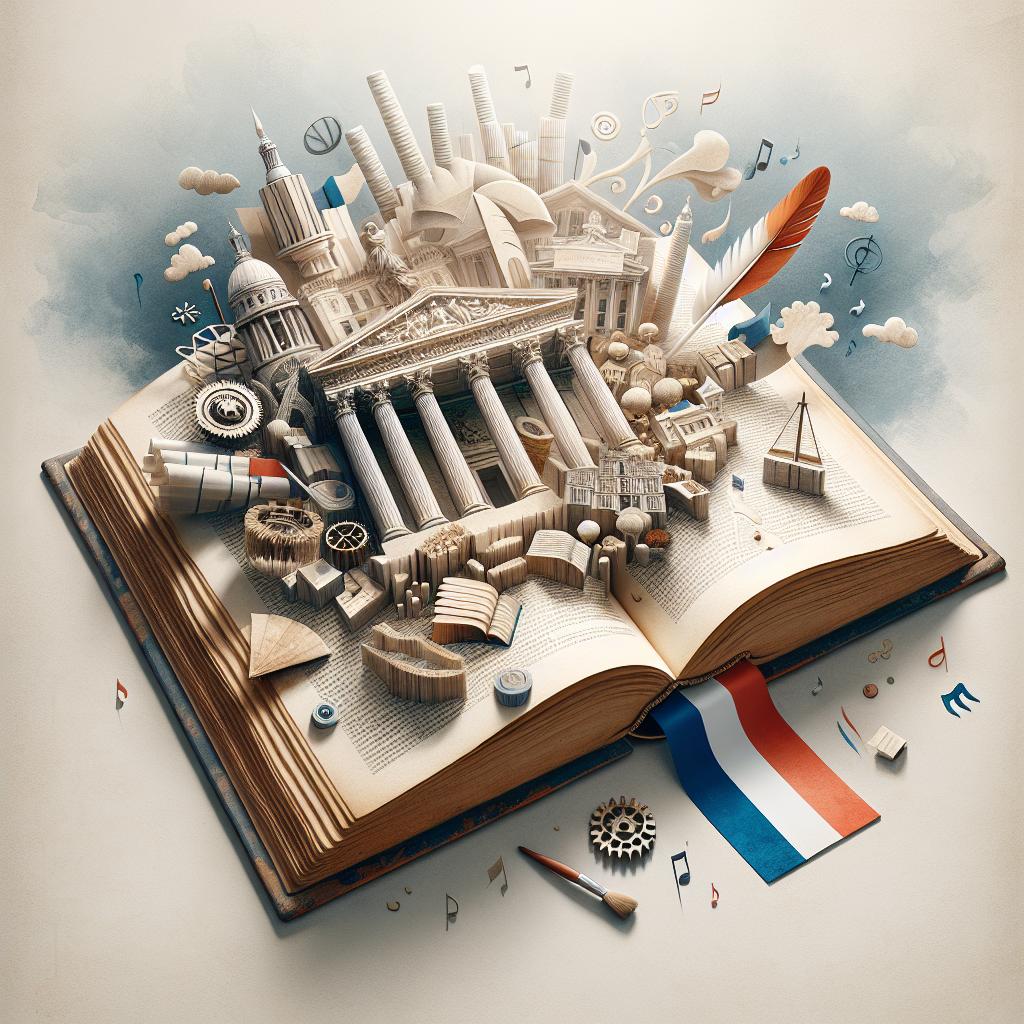Il y a quarante‑quatre ans, en septembre 1981, l’Assemblée nationale a été le théâtre d’un moment décisif : Robert Badinter y prononçait un plaidoyer intransigeant pour l’abolition de la peine de mort. Sa prise de parole, tour à tour vibrante et posée, a marqué les débats parlementaires et contribué à faire basculer une décision majeure pour la société française.
Ce discours s’inscrivait dans une conviction profonde. Pour Badinter, la lutte politique ne se réduit pas à des intérêts partisans : elle est, avant tout, une question d’humanité. Son art oratoire et la force de ses arguments imposaient le silence et le respect dans l’hémicycle, obligeant l’Assemblée à écouter une parole fondée sur une éthique du droit et de la dignité humaine.
Un engagement fondé sur la dignité humaine
Robert Badinter apparaissait comme un homme de combat dont l’outil principal était la loi. Il défendait l’idée que l’État, même lorsqu’il est source du droit, ne peut s’arroger des pouvoirs contraires aux principes essentiels qui fondent la République. La justice, selon lui, ne devait pas recourir à la violence pour la combattre : infliger la peine capitale revenait à instrumentaliser la force au nom de la paix sociale, ce qui contredisait la finalité même du droit.
Ce positionnement explique l’intensité de son plaidoyer en septembre 1981 et la manière dont il sut convaincre au‑delà des lignes politiques. L’auteur de ce texte rappelle qu’il n’était pas du même bord politique que Badinter, mais qu’il a été fier de voter l’abolition le 18 septembre 1981. Ce vote, mentionné avec précision, témoigne d’un basculement civil et législatif qui transcenda les appartenances partisanes.
Au‑delà de l’acte législatif, la relation politique s’est poursuivie dans le temps : l’auteur évoque un dialogue régulier et passionnant avec « cet homme d’État français et européen ». Cette formule souligne la portée nationale et internationale de l’action de Badinter, ainsi que la permanence de l’échange intellectuel qui suivit la décision parlementaire.
La lutte contre la haine : une dimension personnelle et politique
La parole publique de Robert Badinter ne se limitait pas à la question pénale. Il a fait de la loi un instrument de lutte contre toutes les formes d’antisémitisme et de racisme. Ces combats prenaient pour lui une dimension intime : il avait éprouvé la haine dans sa chair, ce qui le rendait d’autant plus intransigeant face à ces idéologies.
La mémoire joue un rôle central dans cette posture. L’auteur rapporte qu’au soir de sa vie, Badinter voyait avec colère les mêmes mots de haine qu’il avait observés enfant, inscrits à la craie sur les murs de son lycée parisien d’avant‑guerre. Ce constat, rapporté ici sans détail additionnel, éclaire la source de son indignation et la permanence d’une vigilance civique.
Formulant son rejet avec une grande clarté morale, Badinter qualifiait l’adhésion à l’antisémitisme et au racisme d’« absurdité criminelle ». Cette citation, conservée dans le texte d’origine, condense son jugement : il s’agit d’un crime non seulement contre des personnes, mais aussi contre les principes républicains. L’auteur énumère ces cibles : la République, l’égalité, la fraternité et la laïcité. Le caractère pluriel de l’attaque rappelle que la haine vise simultanément des individus et les fondements mêmes de la communauté politique.
La force du témoignage réside dans la cohérence entre l’expérience vécue et l’action législative. Pour Badinter, les mots prononcés à la tribune ne sont pas de la pure rhétorique : ils traduisent une trajectoire personnelle et une exigence morale, appliquées à l’élaboration et à l’interprétation de la loi.
Enfin, le souvenir de ces débats souligne une époque où l’Assemblée nationale, selon l’auteur, était encore un lieu de confrontations respectueuses. Les échanges pouvaient être vifs, mais ils s’inscrivaient dans une recherche commune du progrès du pays. La victoire de l’abolition, le 18 septembre 1981, reste présentée comme un moment où la conscience collective l’emporta sur les divisions partisanes.
Ce rappel historique met en lumière un principe durable : l’action publique, lorsqu’elle est animée par la défense de la dignité humaine, peut transformer des expériences individuelles en avancées législatives. Le souvenir de Robert Badinter, tel qu’il est restitué ici, illustre la capacité de la parole politique à produire des changements durables, et la responsabilité de la représentation nationale face aux valeurs fondamentales qu’elle est tenue de protéger.