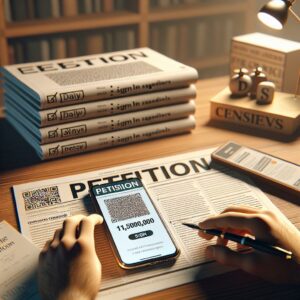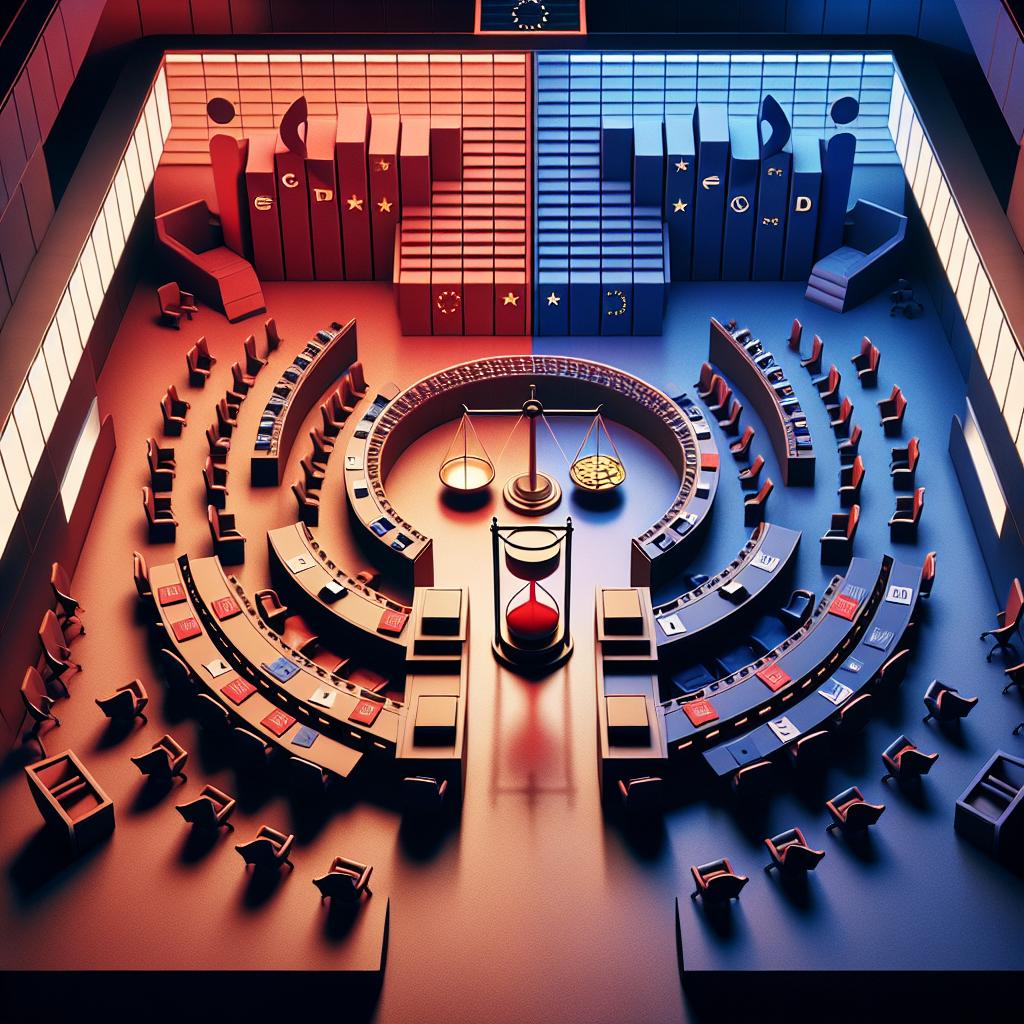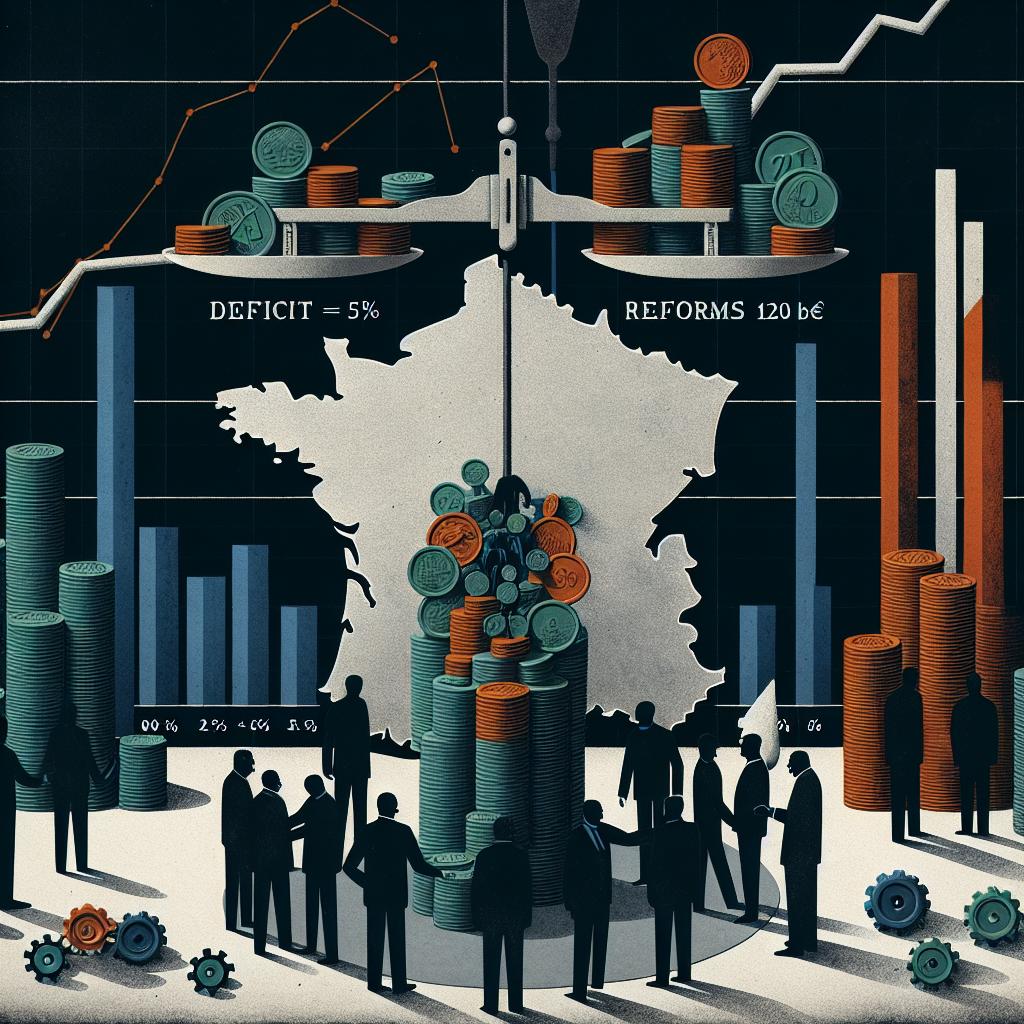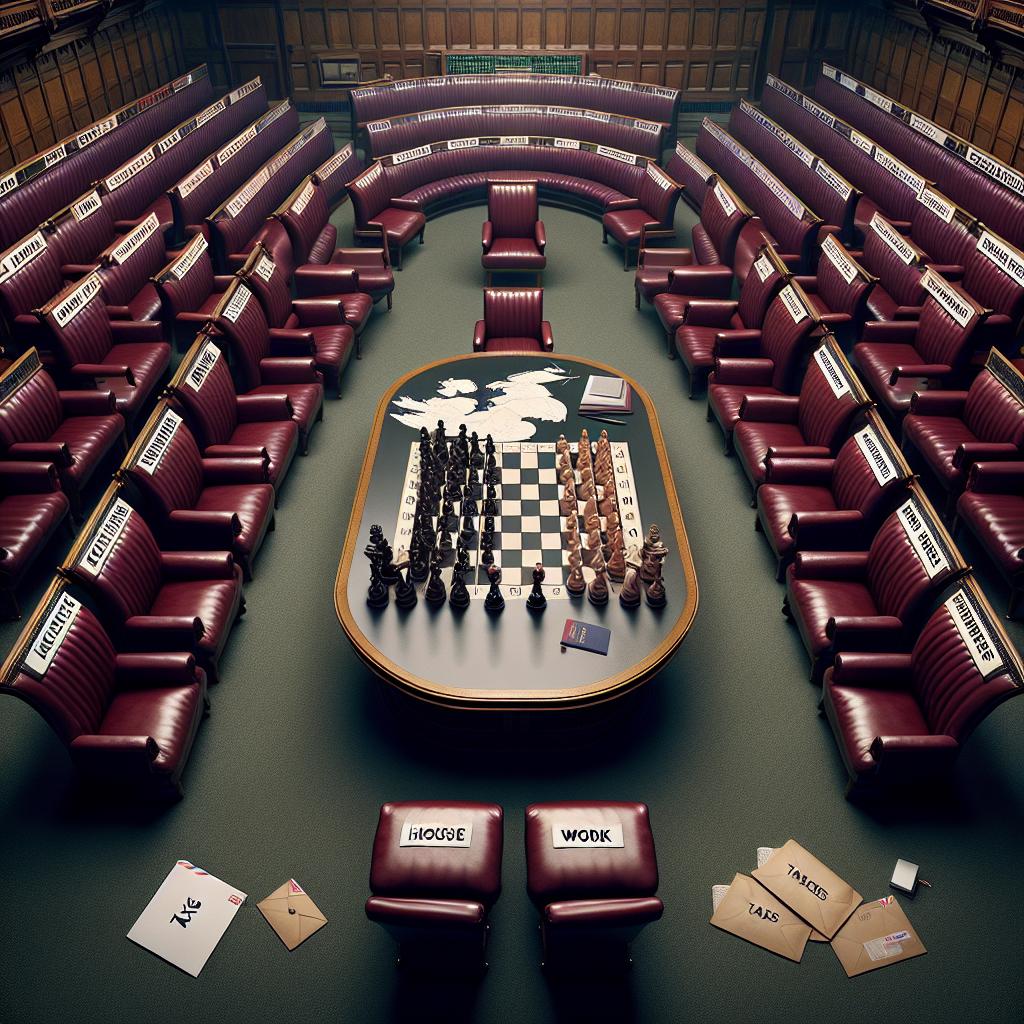La passion française pour l’histoire médiévale
La France entretient une relation particulière avec l’histoire. Dans l’espace public et politique, il est rare qu’un discours s’en dispense. Les musées d’histoire, qu’ils soient locaux ou nationaux, se multiplient et attirent un public nombreux. Le goût pour le passé se lit aussi dans la vitalité de l’édition historique et dans la diversité des formats : podcasts, fictions audiovisuelles, jeux vidéo, festivals et parcs à thèmes s’emparent régulièrement du Moyen Âge.
Cette attractivité commerciale et culturelle du Moyen Âge soulève toutefois une question simple : de quel Moyen Âge parle-t-on exactement ? Le terme renvoie à des réalités très différentes selon les usages, les publics et les intentions politiques ou commerciales.
Un imaginaire pluriel et parfois instrumentalisé
Le Moyen Âge peut être évoqué comme période d’étude, comme patrimoine ou comme matériau narratif. Mais il est aussi une ressource symbolique facilement mobilisable par des mouvements politiques. Certains groupes contemporains, en Europe et en Amérique du Nord, s’identifient à des figures médiévales — Templiers, croisés — pour légitimer des convictions nationalistes ou xénophobes.
Un exemple cité dans la recherche universitaire illustre ce phénomène : lors des manifestations de Charlottesville (Virginie) le 12 août 2017, des manifestants se sont présentés comme des « nouveaux Templiers », selon un article signé Katharine Millar et Julia Costa Lopez et publié dans la revue Politics. Ce type d’appropriation n’est pas anecdotique : il traduit la capacité de symboles anciens à être réinterprétés dans des débats politiques contemporains.
Quand l’histoire devient rhétorique de conflit
La réactivation de l’imaginaire des croisades a été observée dans plusieurs contextes récents. Après les attentats du 11 septembre 2001, le langage politique et la rhétorique de certains responsables américains, dont l’ancien président George W. Bush et ses partisans, ont réinvesti des catégories de lecture opposant « l’Occident » et le « monde musulman ». Ce vocabulaire a accompagné des choix de politique étrangère et des discours de justification de l’intervention militaire au Moyen-Orient.
À l’échelle non étatique, des groupes radicaux ont aussi revendiqué des filiations médiévales. La milice du Kansas autoproclamée « The Crusaders » a, selon les éléments rapportés, été arrêtée en 2016 pour avoir projeté l’attaque de plusieurs mosquées. Ces exemples montrent que des images et des récits historiques peuvent nourrir des discours violents lorsque leur portée symbolique est détournée.
En France : entre marché culturel et récupération politique
En France, la popularité du Moyen Âge se conjugue avec des enjeux économiques et politiques. Le phénomène concerne aussi des mécènes et des acteurs de premier plan du paysage médiatique et industriel. Parmi eux, des milliardaires d’extrême droite sont parfois mentionnés comme cherchant à promouvoir une vision particulière des racines « blanches » et « chrétiennes » de la civilisation. Le nom de Vincent Bolloré y est évoqué dans le débat public.
Plus récemment, l’homme d’affaires Pierre-Edouard Stérin a été au centre d’une attention médiatique pour un projet présenté sous le nom de « plan Périclès ». Ce plan, tel qu’il a été décrit dans la sphère publique, vise à favoriser la diffusion d’un roman ultranationaliste à large échelle, via des fêtes traditionnelles et des festivals. Parmi ces manifestations, les « Murmures de la cité », à Moulins, ont été qualifiées par L’Humanité de « mini-Puy du Fou ». Ces rapprochements soulignent les passerelles possibles entre initiatives culturelles, promotion identitaire et stratégies politiques.
Le croisement entre marché culturel et enjeux idéologiques rend nécessaire une lecture distinguée des phénomènes. La présence accrue du Moyen Âge dans les loisirs et la culture populaire n’implique pas automatiquement une instrumentalisation politique, mais elle crée un terrain favorable à des récupérations symboliques lorsque des acteurs en tirent parti.
En résumé, le regain d’intérêt pour le Moyen Âge en France se déploie sur plusieurs registres : scientifique, commercial et politique. Comprendre ce qui se joue exige de distinguer le travail d’histoire et d’édition des usages contemporains et parfois contestables de cet héritage.