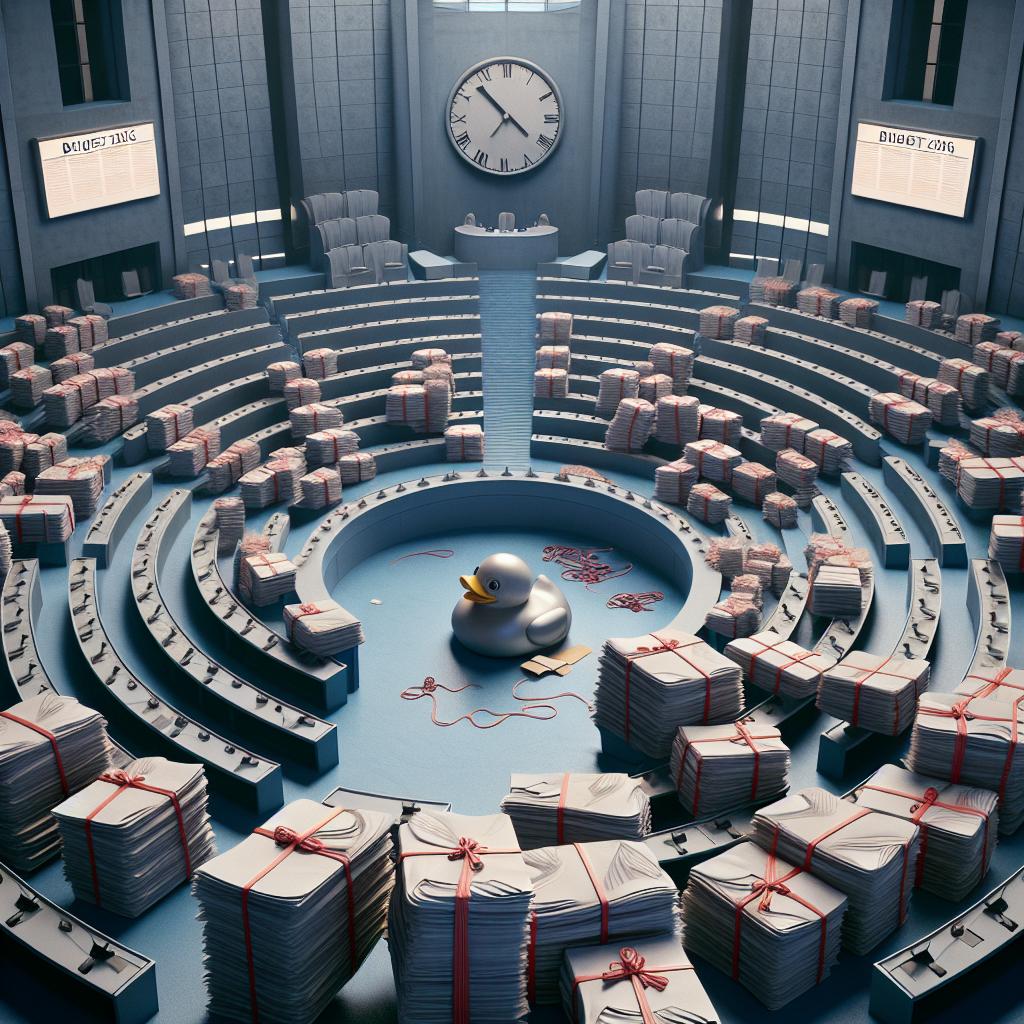Le projet d’accord sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, signé le 12 juillet à Bougival (Yvelines) par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et les représentants des six délégations indépendantistes et non indépendantistes du territoire, portait le sous-titre « Le pari de la confiance ». Ce pari, célébré rapidement comme accompli, a été remis en cause par la décision du congrès du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), rendue publique le 13 août, de rejeter ce texte de compromis.
Un accord contesté au sein même du FLNKS
Le projet de Bougival avait pourtant été paraphé sur place par Emmanuel Tjibaou, présenté dans le texte comme député et président de l’Union calédonienne, l’une des composantes majeures du FLNKS. Rapidement après la signature, des militants ont contesté le contenu de l’accord et Christian Tein, président du FLNKS, a exprimé son rejet, en attendant le vote formel de l’organisation qui a confirmé cette orientation.
Cette divergence interne illustre la fracture entre les instances dirigeantes et la base militante : un responsable peut accepter des engagements qui ne recueillent pas l’assentiment des sections locales ou des sympathisants, surtout sur un sujet aussi sensible que l’avenir institutionnel et la souveraineté. Le rejet place de nouveau l’avenir politique du territoire en incertitude, un peu plus d’un an après le déclenchement, le 13 mai 2024, d’émeutes qui ont fait 14 morts et plongé la Nouvelle-Calédonie dans une période de grande violence sociale.
Les innovations juridiques et les points de blocage
Le texte de Bougival reposait sur une construction juridique inédite : la création, au sein de la République française, d’un « État de la Nouvelle-Calédonie » inscrit dans la Constitution, ainsi que d’une « nationalité calédonienne » indissociable de la nationalité française. Cette formule visait à ouvrir une étape intermédiaire, préalable à une éventuelle pleine souveraineté telle que la revendiquent les indépendantistes.
Un transfert de compétences régaliennes est envisagé, mais limité dans l’immédiat aux relations internationales et soumis à une condition stricte : un vote favorable à une majorité supérieure à 60 % du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Plusieurs acteurs ont jugé cette exigence difficilement atteignable et inconciliable, selon eux, avec la reconnaissance du droit à l’autodétermination telle que la conçoit le FLNKS.
Le projet prévoyait également une révision de la répartition des sièges au Congrès, susceptible de favoriser la province Sud, majoritairement anti-indépendantiste. Cette disposition a été l’un des points de friction, car elle touche directement l’équilibre politique institutionnalisé et les conditions d’expression des différents courants dans l’assemblée locale.
Au-delà des textes, des questions pratiques et politiques subsistent : quels mécanismes de transition prévoir ? Comment garantir dans la durée la reconnaissance des droits de chacune des composantes de la société calédonienne ?
Pour l’exécutif, le rejet du texte représente un revers. Après la signature, le président de la République, Emmanuel Macron, avait estimé que la Nouvelle-Calédonie « ouvre une nouvelle page de son avenir », et Manuel Valls avait salué « le choix du courage et de la responsabilité ». Face au rejet, M. Valls a qualifié la décision du FLNKS « d’incompréhensible » et a annoncé le maintien de sa venue sur le Caillou durant la semaine du 18 août pour « examiner le projet » et « installer le comité de rédaction » de l’accord définitif.
Mais la réalité politique impose que l’un des partenaires essentiels ait formellement rejeté la proposition : le texte ne peut être mis en œuvre tel quel et devra être retravaillé. Les interlocuteurs locaux et nationaux resteront confrontés à la difficulté de concilier exigence de dialogue et contraintes d’urgence, notamment la reconstruction du territoire après les violences.
La crise calédonienne est d’autant plus complexe qu’elle est marquée par le poids de l’histoire coloniale, par des temporalités et des priorités différentes entre communautés, et par des enjeux concrets de reconstruction financés par Paris. Pour Emmanuel Macron, souvent critique du colonialisme français passé mais attaché à la présence de la France dans le Pacifique, la difficulté consiste à conduire une « décolonisation d’aujourd’hui » qui ne néglige ni les Loyalistes ni les Kanak.
Au terme de cette première tentative négociée, la feuille de route proposée à Bougival apparaît donc comme un point de départ fragile. Le rejet par le FLNKS relance un travail d’élaboration collective nécessaire pour esquisser une solution politique pérenne, dans un contexte où la mémoire des affrontements de 2024 reste vive et où la question du corps électoral demeure un sujet potentiellement explosif.