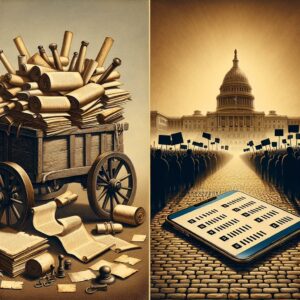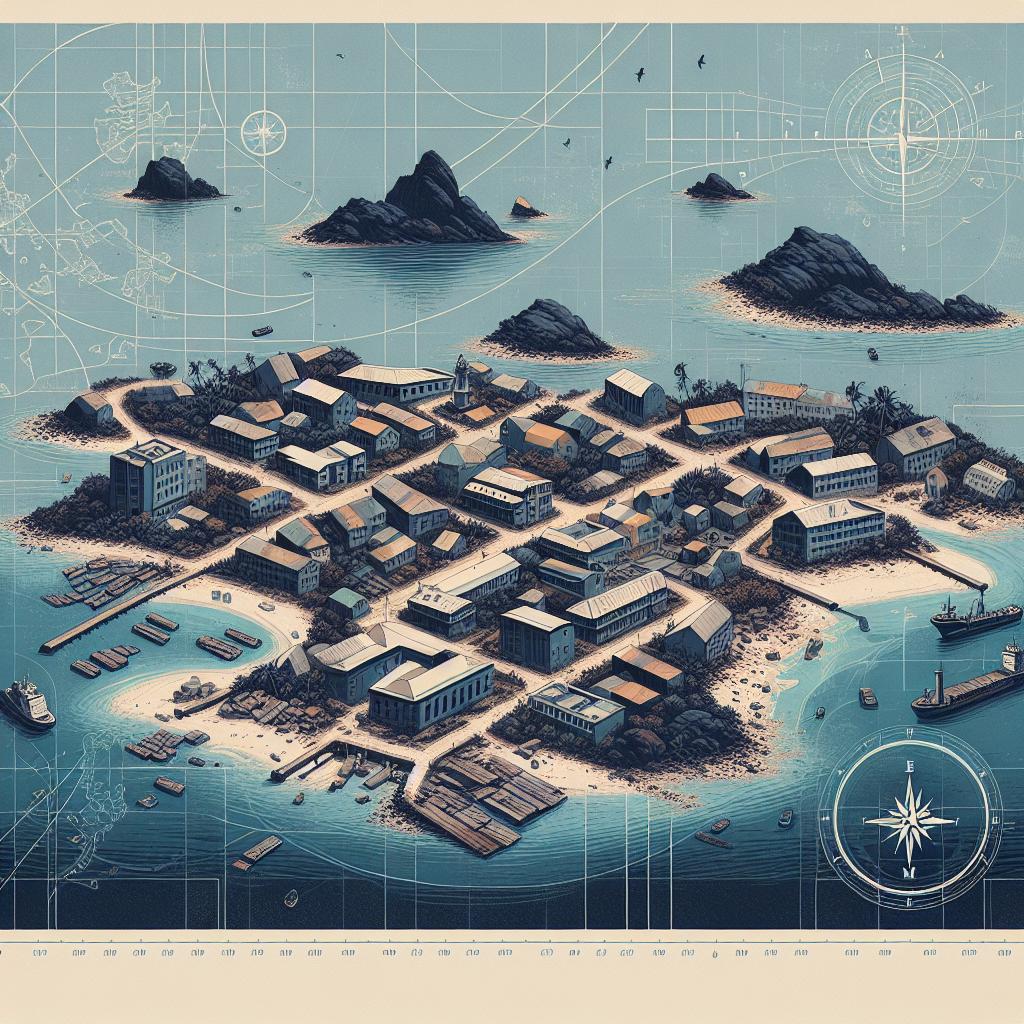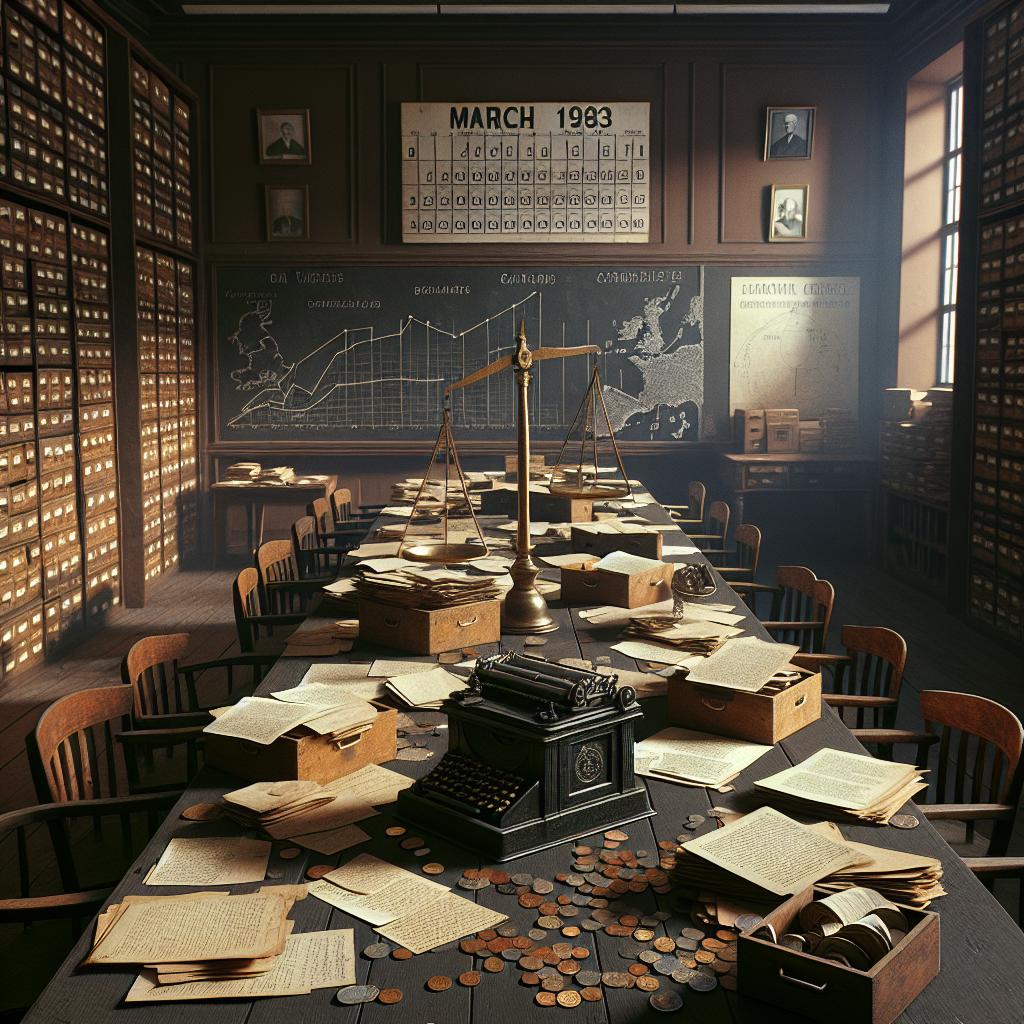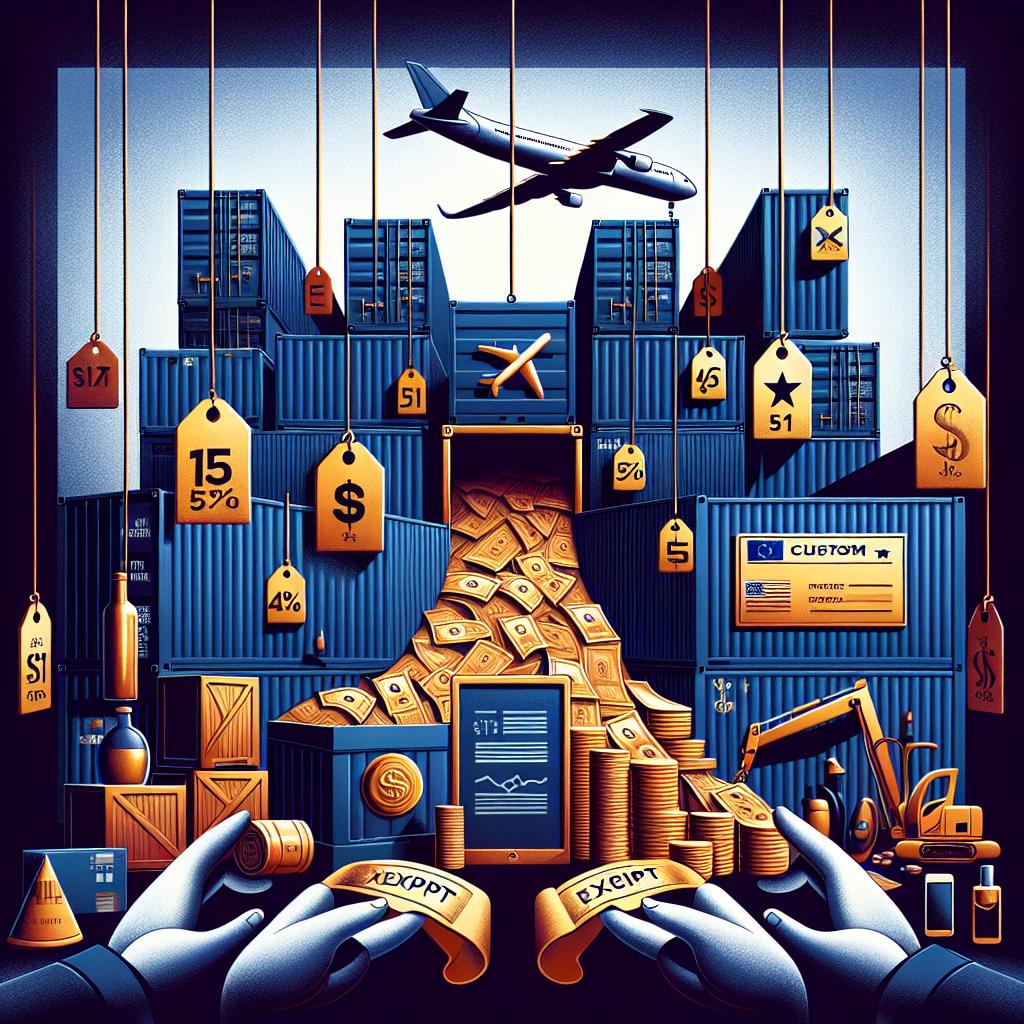La campagne d’explication menée par François Bayrou pour défendre un plan d’ajustement budgétaire de 44 milliards d’euros en 2026 n’a pas dissipé les inquiétudes. Dès lundi 8 septembre, le pays risque de replonger dans une crise politique, quinze mois après la dissolution de juin 2024 et neuf mois après la chute du gouvernement de Michel Barnier, selon le cadre posé par les partisans de la thèse actuelle.
Un pari politique aux lourdes conséquences
Le positionnement de l’exécutif a été perçu par ses opposants comme volontariste, voire provocateur. Pour ne pas reproduire la même issue que son prédécesseur, le président du MoDem a choisi de soumettre son sort au vote de confiance de l’Assemblée nationale, lundi, pari risqué dont l’issue semble incertaine.
Si le vote de confiance devait lui être refusé, l’exécutif s’exposerait à une nouvelle séquence d’instabilité. Les commentateurs rapportent que la manœuvre a pour effet immédiat d’accroître le niveau d’incertitude politique et d’ouvrir des marges de manœuvre aux forces d’opposition qui travaillent à tirer profit de la situation.
Le Rassemblement national, principal bénéficiaire des tensions
Face à la colère sociale et à la défiance politique, le Rassemblement national apparaît comme le premier bénéficiaire du désarroi ambiant. Ni les difficultés judiciaires de Marine Le Pen, ni la jeunesse de Jordan Bardella, ni les revirements stratégiques du parti ne semblent freiner sa dynamique, selon les analyses relayées dans le débat public.
Les dirigeants du RN parviennent à capitaliser sur les faiblesses et les renoncements de leurs adversaires. Pour eux, il suffit d’exploiter des décalages et des hésitations sur l’économie et la sécurité pour consolider un électorat en quête d’alternatives politiques claires.
Évolution de la droite et tentations de rapprochement
La trajectoire de la droite républicaine illustre ces renoncements. Le retrait du principe du « ni ni » par Les Républicains, au profit d’une logique « tout sauf La France insoumise », laisse le champ libre à des accommodements tactiques, notamment en vue des élections municipales de mars 2026.
Des déclarations récentes, attribuées à Nicolas Sarkozy dans Le Figaro du mercredi 2 septembre, évoquant la possibilité d’une dissolution et reconnaissant au RN une place dans l’arc républicain, ont été interprétées comme un signal d’autorisation implicite pour des rapprochements. Ces propos contribuent à désinhiber certains acteurs politiques et économiques qui, jusque-là, se montraient réticents.
La fracture avec le monde patronal
Le monde patronal aussi montre des signes d’évolution. Des voix influentes et des grands groupes ont établi des contacts et des échanges avec le RN, une situation autrefois jugée impensable. La convocation de Jordan Bardella à la rentrée du Medef illustre ce changement d’ambiance.
Par ailleurs, des lettres adressées aux chefs d’entreprise promettant des baisses massives d’impôts et des allègements de normes ont été présentées comme des offres politiques ciblant le patronat. Ces démarches interviennent alors que, en 2011, Laurence Parisot publiait Un piège bleu Marine (Calmann-Lévy, 2011) pour mettre en garde contre un parti nationaliste susceptible de fragiliser l’Union européenne.
La normalisation progressive des échanges entre certaines entreprises et le RN interroge sur la porosité croissante entre sphères économiques et mouvements politiques aux programmes contestés.
Un projet contesté et des tensions institutionnelles
Le cœur du projet porté par le Rassemblement national, la « préférence nationale », continue de susciter des réserves. Ce concept, hérité des traditions de l’extrême droite et critiqué pour son caractère incompatible avec les principes constitutionnels, soulève des inquiétudes sur les tensions qu’il pourrait générer si ses propositions étaient mises en œuvre.
Au moment où les turbulences politiques menacent de reprendre, ces éléments doivent être rappelés pour comprendre les enjeux qui dépassent la seule séquence budgétaire. Les récentes péripéties montrent que la recomposition des alliances politiques et des relations avec le monde économique peut transformer rapidement le paysage démocratique.
La période à venir, marquée par des décisions parlementaires et des réactions de l’opinion, déterminera la portée réelle de ces évolutions et leur traduction dans les choix institutionnels et électoraux.