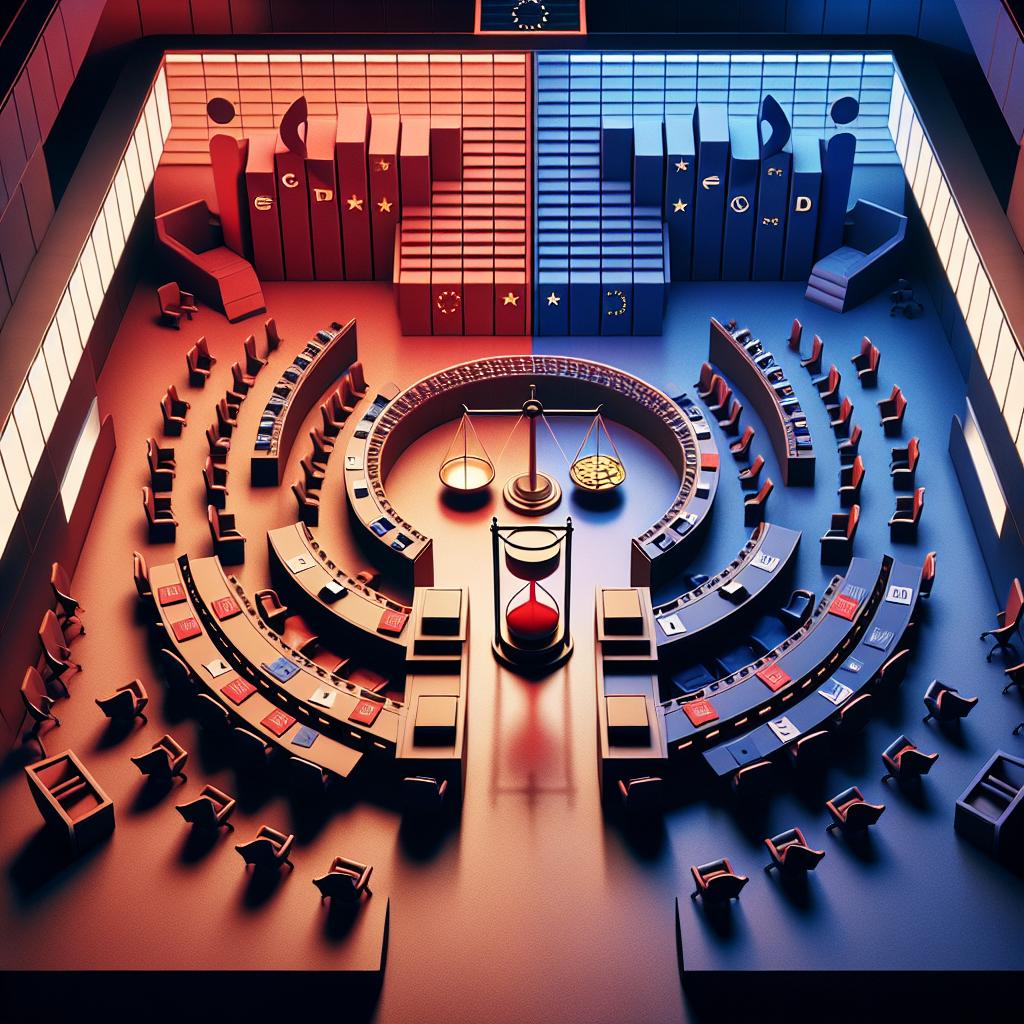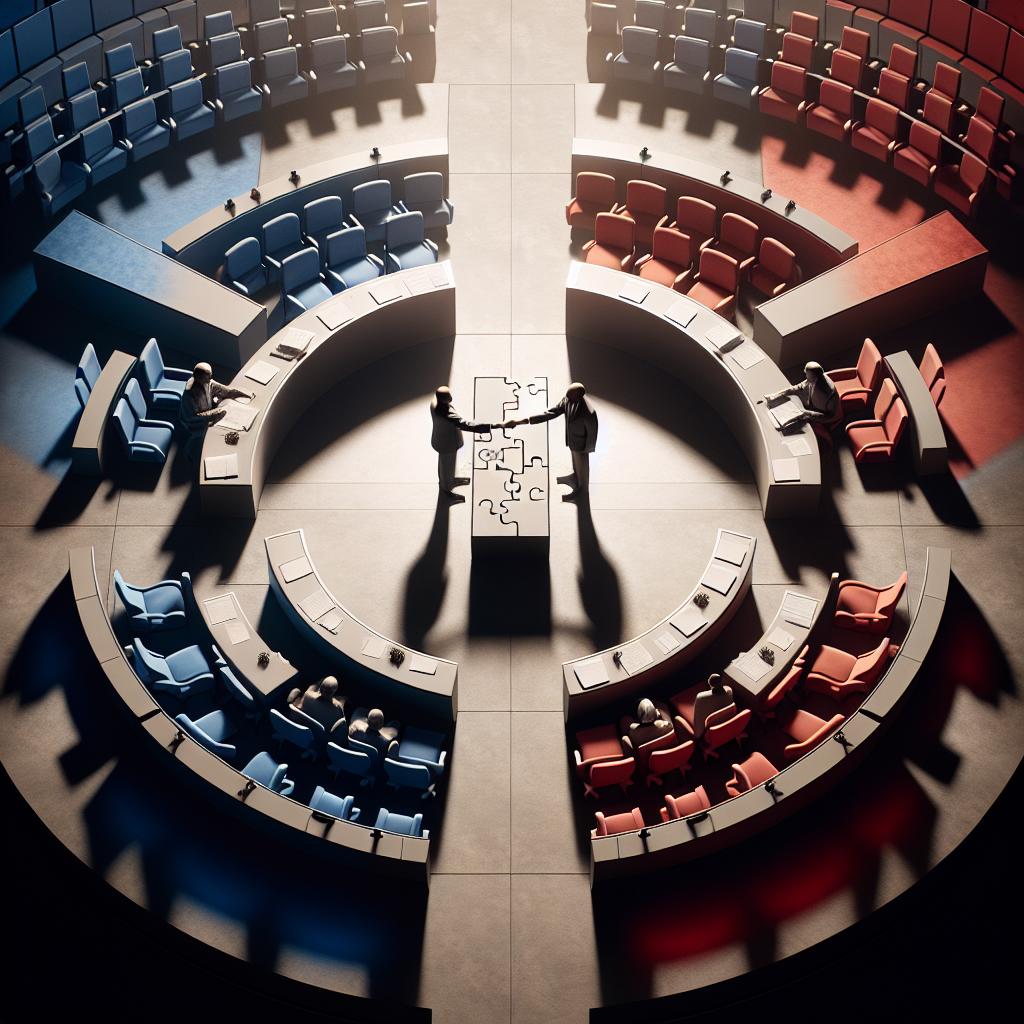Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 novembre 2025, l’Assemblée nationale a rejeté la première partie du projet de loi de finances (PLF) 2026, relative aux recettes, avec un résultat sans précédent sous la Ve République : 1 vote pour, 404 contre et 84 abstentions. Le rejet a rassemblé la quasi-totalité des groupes de gauche, de droite et de l’extrême droite, tandis que le MoDem et une majorité de députés Renaissance ont choisi l’abstention. Cette division nette sur la stratégie budgétaire a des conséquences immédiates sur la procédure parlementaire.
Un vote historique et ses chiffres
Le scrutin a pris une tournure exceptionnelle : la première partie du PLF — qui doit fixer les recettes de l’État pour 2026 — n’a obtenu qu’un unique vote favorable face à 404 voix contraires et 84 abstentions. Ce résultat est qualifié d’« inédit » dans l’histoire de la Ve République, tant par l’ampleur du rejet que par l’unité des oppositions. Les chiffres soulignent une très large hostilité au texte présenté par le gouvernement, mais aussi le choix pour certains députés de ne pas s’engager dans un vote d’opposition frontal en s’abstenant.
Le MoDem et une majorité des députés Renaissance se sont abstenus, précise le compte rendu du vote ; cette position a contribué à modifier la composition du rejet mais n’a pas empêché l’échec du texte.
Conséquences procédurales : la fin des travaux à l’Assemblée
En conséquence du rejet de la partie recettes, l’Assemblée nationale n’examinera pas la seconde partie du projet, consacrée aux dépenses. La procédure budgétaire prévoit que ces deux volets puissent être discutés séparément, mais l’échec du premier empêche la poursuite normale des débats sur l’ensemble du budget à l’Assemblée.
Le gouvernement va renvoyer le texte au Sénat, qui disposera de la première lecture sur le projet de loi de finances. Le passage au Palais du Luxembourg interviendra sans tenir compte des amendements et des quelque 125 heures de travaux réalisés précédemment par les députés, selon le constat relayé par plusieurs élus. Cette situation laisse nombre de députés frustrés : leurs interventions et compromis négociés en commission et en séance n’auront pas d’effet immédiat sur le texte tel qu’il sera examiné par les sénateurs.
Réactions et enjeux politiques
Le rejet massif du volet recettes illustre une crise de confiance entre le gouvernement et une large part des députés. Pour l’opposition, le vote marque un refus catégorique des orientations fiscales proposées. Pour les groupes centristes qui se sont abstenus, la décision traduit plutôt une distance critique : ils n’adhèrent pas au texte mais ne souhaitent pas le porter politiquement.
Politiquement, l’enjeu est double : d’une part, le gouvernement doit convaincre le Sénat et éventuellement négocier de nouveau avec l’Assemblée si le texte revient en nouvelle lecture ; d’autre part, l’exécutif voit sa marge de manœuvre réduite dans l’immédiat, faute d’une majorité claire à l’Assemblée pour valider ses choix sur les recettes.
Un goût amer sans panique généralisée
Plusieurs députés et observateurs parlementaires parlent d’un « goût amer ». Ils déplorent la fin abrupte d’un cycle d’examen parlementaire marqué par plus de 125 heures de débats et d’auditions. Malgré cette amertume, l’événement ne suscite pas, selon certains élus, une inquiétude politique débordante : la procédure constitutionnelle prévoit des étapes qui permettent au texte de poursuivre son parcours au Sénat, puis de revenir éventuellement devant l’Assemblée.
Reste à voir si le gouvernement choisira d’engager une nouvelle stratégie de dialogue politique pour faire adopter au moins des éléments du PLF, ou s’il attendra l’issue des travaux sénatoriaux pour proposer des adaptations. Les prochains jours seront déterminants pour mesurer la capacité de l’exécutif à reconstruire des accords parlementaires autour des grandes orientations budgétaires.
Une séquence politique à suivre
Ce scrutin, par son ampleur et sa valeur symbolique, marque une étape importante de la discussion budgétaire pour 2026. Il révèle des faiblesses de l’alliance majoritaire à l’Assemblée et met en lumière des lignes de fracture entre groupes politiques sur les recettes publiques.
La suite du calendrier dépendra maintenant du calendrier sénatorial et des choix tactiques du gouvernement. Une reprise des discussions est probable, mais elle nécessitera des concessions ou des réorientations pour surmonter l’opposition large observée lors de ce vote initial.