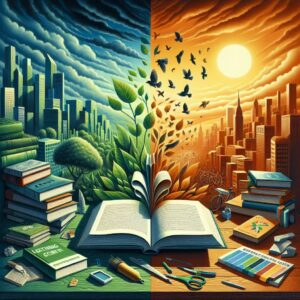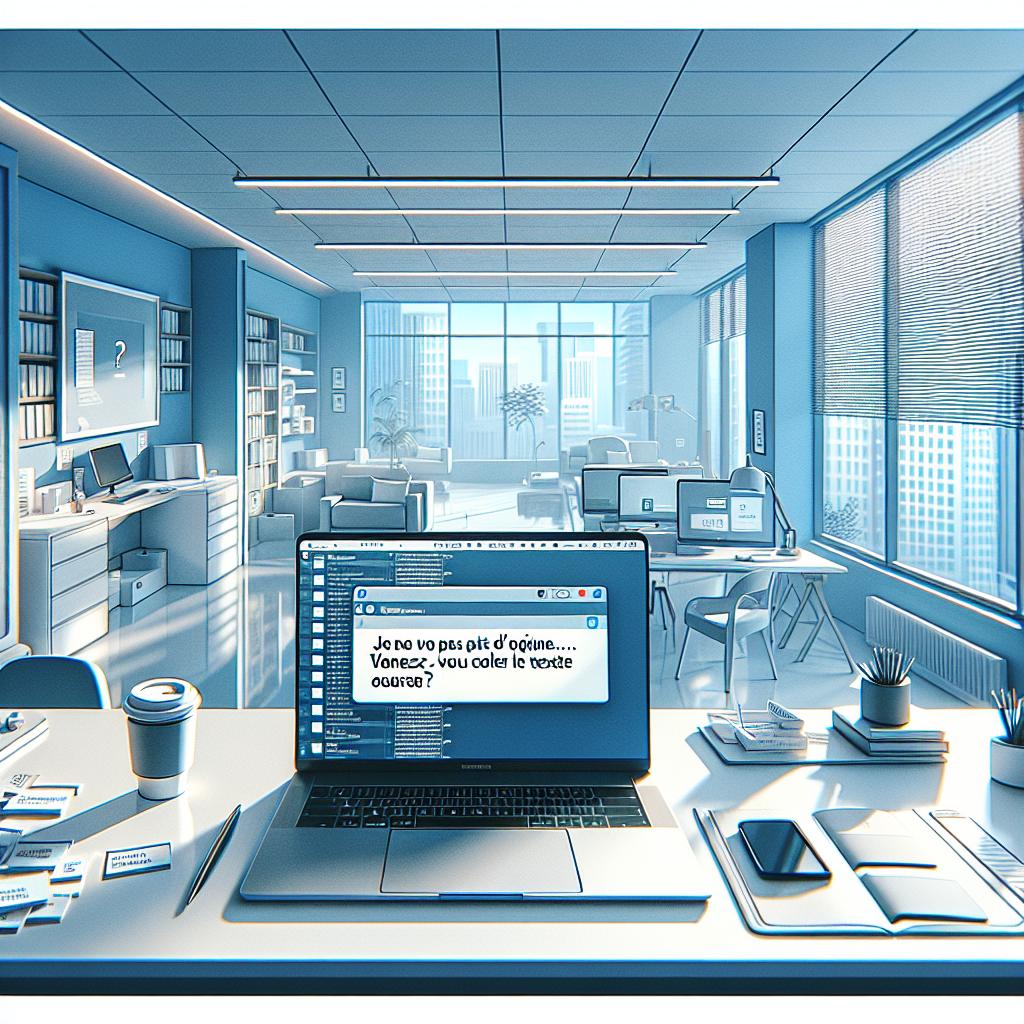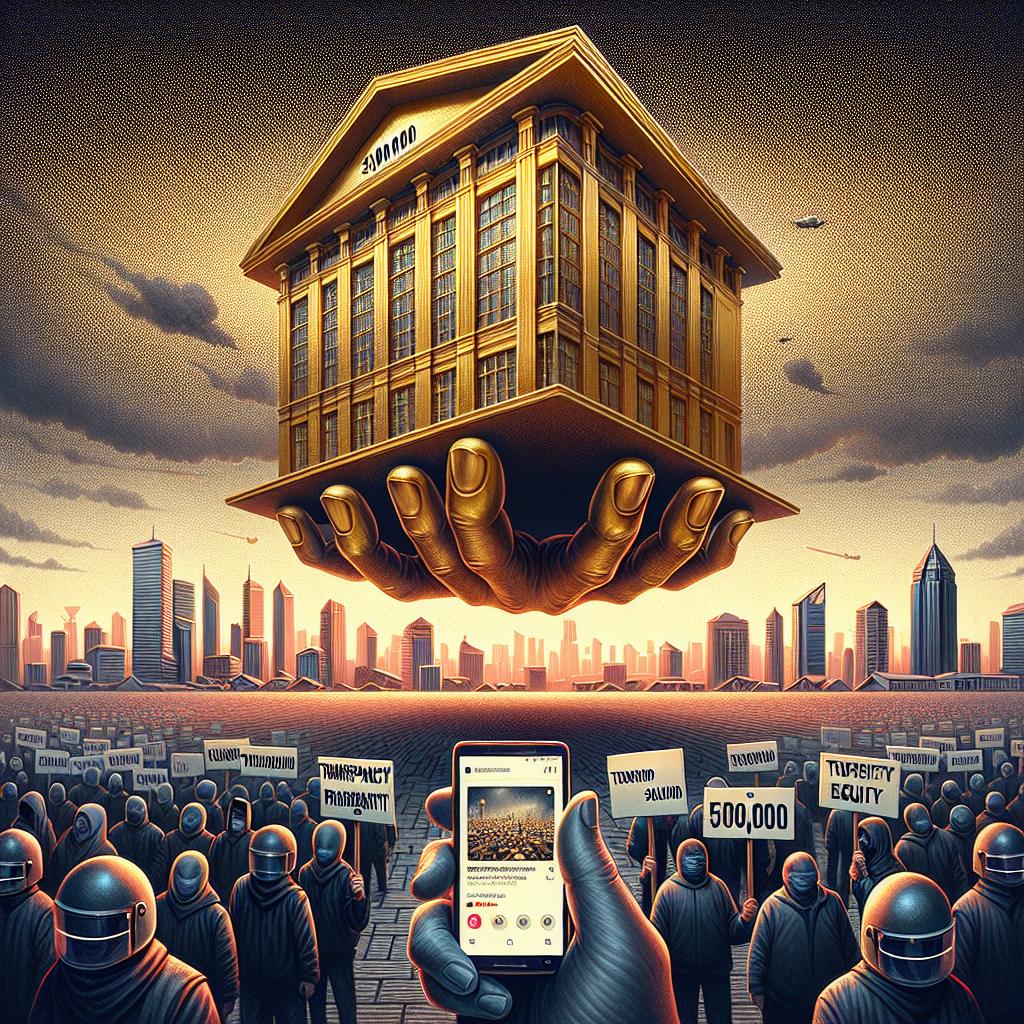À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, plusieurs associations alertent sur l’invisibilisation des violences subies par les femmes exilées. Elles rappellent que ces violences constituent un continuum qui accompagne ces femmes depuis leur pays d’origine, pendant la traversée et après leur arrivée en France.
Un continuum de violences tout au long du parcours migratoire
Selon ces associations, les femmes exilées affrontent des violences de genre spécifiques et répétées à chaque étape de leur trajectoire migratoire. Ces violences incluent des agressions sexuelles, des mariages forcés, des mutilations sexuelles féminines, des violences conjugales et intrafamiliales, mais aussi des formes de discrimination liées au genre et à l’origine.
Les organisations évoquent des conséquences sanitaires lourdes : dégradation de la santé physique, trouble de santé mentale, atteintes à la santé sexuelle et reproductive. Elles soulignent que ces atteintes sont renforcées par l’isolement, le manque d’accès aux soins et les barrières linguistiques et administratives.
Les associations rapportent des chiffres dramatiques pour illustrer l’ampleur du phénomène : « plus de 90 % des femmes qui traversent la Méditerranée ont été victimes de viol », et, toujours selon leurs observations, « la moitié des cadavres retrouvés sont des femmes ». Ces éléments sont présentés par les associations comme le signe de violences sexistes et sexuelles qui jalonnent les routes migratoires.
Des routes migratoires de plus en plus dangereuses
Les intervenantes associatives expliquent que le durcissement des politiques migratoires rend les parcours plus dangereux et plus invisibles. Les traversées se déroulent souvent dans des conditions extrêmes, y compris dans les camps aux frontières de l’Europe et dans les pays de transit, où la protection est insuffisante et les risques élevés.
Dans ce contexte, la formule utilisée par plusieurs associations — « la rue abîme, blesse et tue » — résume la précarité et l’exposition aux violences que subissent de nombreuses femmes exilées lorsqu’elles n’ont pas accès à un logement sûr. Les routes migratoires, soulignent-elles, n’effacent pas les violences subies : elles les prolongent et parfois les aggravent.
Arrivée en France : précarité et violences institutionnelles
Une fois en France, les associations dénoncent des politiques de non-accueil qui enferment nombre de femmes dans une précarité économique et sociale propice aux violences sexuelles. Elles affirment, d’après leurs observations, que « au bout d’un an, 100 % des femmes sans abri sont victimes d’un viol ». Ce chiffre est avancé par les associations pour alerter sur l’extrême vulnérabilité des personnes sans domicile.
Lorsqu’elles trouvent un hébergement informel, relèvent encore ces organisations, certaines femmes subissent des violences sexuelles en échange d’un toit. Ce phénomène s’accompagne de violences administratives et institutionnelles : racisme, disqualification des récits de violence, obstacles à l’accès aux soins, et isolement social et linguistique qui empêchent la reconstruction et le signalement.
Les associations pointent également la difficulté pour ces femmes d’être entendues par des dispositifs d’aide souvent mal adaptés : complexité des procédures d’asile, manque d’interprètes qualifiés, et insuffisance de places d’hébergement spécifiquement destinées aux victimes de violences de genre.
En synthèse, les constats portés le 25 novembre par ces associations décrivent une situation où les violences de genre ne se limitent pas aux frontières mais se prolongent tout au long du parcours migratoire et après l’arrivée en France. Ils mettent en lumière la convergence de facteurs — violences subies en amont, routes dangereuses, précarité d’accueil et obstacles institutionnels — qui accroissent la vulnérabilité des femmes exilées et aggravent les conséquences sanitaires et sociales.