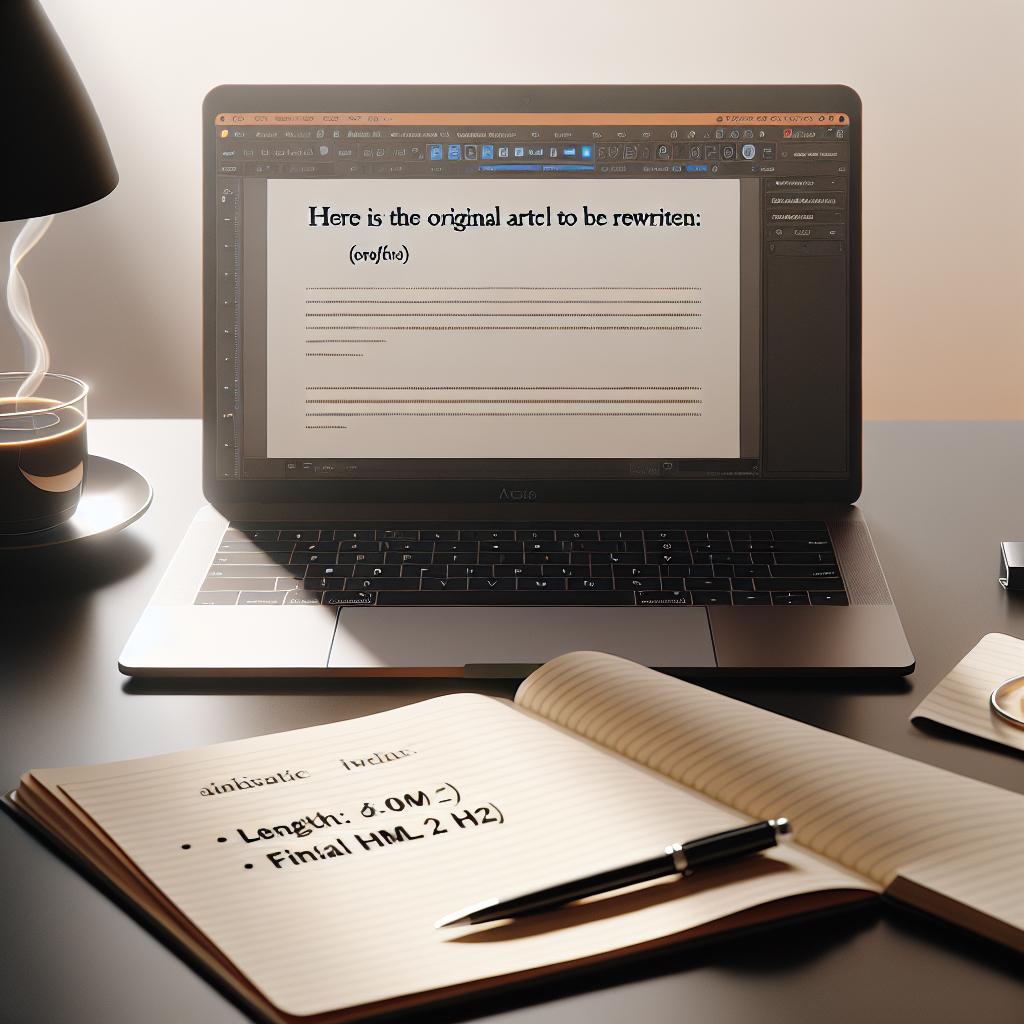Le rapport et ses propositions
Un rapport parlementaire présenté par les députés macronistes Mathieu Lefèvre et Charles Rodwell propose de remettre en cause les dérogations spécifiques prévues par l’accord franco‑algérien de 1968. Selon les auteurs, ces dispositions, qui concernent la circulation, le séjour, l’emploi et la protection sociale des ressortissants algériens, instaurent un « statut unique » pouvant être assimilé à une discrimination entre étrangers de nationalités différentes.
Les auteurs affirment que ce statut « crée une rupture d’égalité qui fragilise notre ordre juridique et entraîne un surcoût important pour nos finances publiques ». Ils avancent une évaluation « de l’ordre de 2 milliards d’euros », tout en précisant que « l’estimation de ces surcoûts pour les finances publiques est imprécise » en raison de « l’absence voire de la rétention de données ». Le rapport plaide pour une clarification juridique et une révision des mécanismes considérés comme dérogatoires.
Ce que prévoit l’accord de 1968
L’accord franco‑algérien signé en 1968, six ans après la fin de la guerre d’Algérie (1954‑1962), instaurait des procédures particulières pour les ressortissants algériens vivant en France. Il permet, notamment, l’obtention accélérée d’un titre de séjour de dix ans. Dans le cadre d’un regroupement familial, les membres de la famille reçoivent également un certificat de résidence de dix ans dès leur arrivée si la personne qu’ils rejoignent détient ce titre.
Pour les rapporteurs, ces mesures spécifiques créent « une situation juridique problématique en ce qu’elles instituent une discrimination entre étrangers de nationalités différentes sur le territoire français ». Ils ajoutent que l’accord « ne présente aucune disposition concernant la partie algérienne ni aucune clause de réciprocité et n’a donc d’“accord” que le nom. Il s’apparente, dans les faits, davantage à une déclaration unilatérale de la France ».
Contexte diplomatique et politique
La remise en cause de l’accord intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Paris et Alger. Le rapport s’inscrit dans une série d’initiatives déjà entamées : en février, un rapport du Sénat avait évoqué la possibilité d’ouvrir la voie à la dénonciation de cet accord. Des responsables politiques, dont l’ancien ministre de l’intérieur Bruno Retailleau, ont publiquement exprimé leur souhait de revoir ces dispositions.
Les auteurs du document estiment néanmoins que la dénonciation de l’accord est possible « sans l’inscrire dans une opposition frontale et directe avec l’Algérie ». Le rapport recommande d’envisager des solutions qui tiennent compte des contraintes diplomatiques tout en remédiant, selon eux, à des « incohérences juridiques » et à des coûts pour l’administration et la protection sociale.
Chiffres et implications sociales
Les Algériens constituent la première nationalité étrangère présente en France selon les chiffres cités dans le texte : 649 991 personnes en 2024. Ils occupent également la deuxième place parmi les bénéficiaires d’un premier titre de séjour. Pour ce qui est des situations irrégulières, le rapport indique que 33 754 Algériens ont été interpellés en 2024 en France.
Le document met en avant un double argument : d’une part, la nécessité de préserver l’égalité entre étrangers sur le territoire ; d’autre part, la question du coût administratif et social associé aux procédures dérogatoires liées à l’accord. Les rapporteurs appellent à une meilleure quantification des dépenses et à un travail statistique plus exhaustif pour fonder toute décision.
Perspectives et limites
Le rapport suggère que la dénonciation ou la modification de l’accord de 1968 reste envisageable, mais il souligne l’absence de données consolidées pour chiffrer précisément les effets financiers et sociaux d’un changement. Les auteurs invitent ainsi les pouvoirs publics à engager des états des lieux documentés avant toute réforme.
Enfin, le texte insiste sur la nécessité d’inscrire toute évolution dans un cadre juridique clair et proportionné, afin d’éviter des conséquences imprévues tant pour les personnes concernées que pour les relations bilatérales entre la France et l’Algérie. Le rapport pose en filigrane la question de l’articulation entre exigence d’égalité juridique et réalités historiques et sociales héritées de la période post‑coloniale.