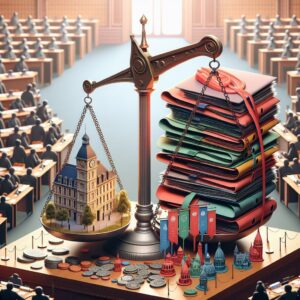Alors que le projet de budget est toujours examiné au Parlement, l’enveloppe destinée aux universités et aux organismes de recherche suscite une attention renouvelée. Un mécanisme comptable en place depuis 2006, rarement mis en lumière, remet en cause la lisibilité des efforts publics : il gonfle artificiellement la dépense affectée aux services publics, dont la recherche et l’enseignement supérieur.
Un « tour de passe-passe » comptable
La pratique contestée consiste à inscrire au budget des sommes qui n’abondent pas directement les missions opérationnelles des ministères concernés. Plutôt que d’être affectés immédiatement à l’éducation, à la police ou à la recherche, ces montants alimentent un compte d’affectation spéciale (CAS) destiné au financement des pensions des fonctionnaires. Ce procédé, en place depuis 2006, crée un effet de trompe-l’œil : la dépense publique apparaît plus élevée qu’elle ne l’est en réalité pour les services concernés.
Selon une étude publiée en juin par l’Institut des politiques publiques (IPP) portant sur des données de 2020, l’investissement réel pour la recherche et l’enseignement supérieur serait inférieur d’environ 10 % à ce que laisse croire le budget voté. Concrètement, l’étude compare 25,8 milliards d’euros votés à 23,1 milliards d’euros effectivement investis.
Impact chiffré et critique d’experts
« Tout est faussé », résume Patrick Aubert, économiste senior à l’IPP et coauteur de la note, pour décrire les conséquences de cette surévaluation sur la perception de la dépense publique et sur l’évaluation du « coût » des fonctionnaires. Au-delà d’un simple ajustement comptable, la méthode influe sur des indicateurs très suivis, notamment la part des dépenses en recherche et développement (R&D) rapportée au produit intérieur brut (PIB).
Un objectif de 3 % du PIB consacré à la R&D a été fixé pour les pays européens. En France, les dernières estimations publiées en juin font apparaître un ratio de 2,18 % pour 2023. Si l’on considère les données de 2020 corrigées par l’IPP — qui estime l’effort public en fait inférieur de 2,7 milliards d’euros — l’indicateur R&D/PIB pour cette année-là « aurait pu être » de 2,16 % au lieu de 2,28 %, selon les calculs présentés par l’institut.
Ces écarts, modestes en apparence, prennent du poids dans les comparaisons européennes et dans l’évaluation de la trajectoire nationale en matière d’innovation et de soutien à la recherche universitaire.
Pourquoi les cotisations « employeur » augmentent-elles ?
Le mécanisme tient à la façon dont sont financées les retraites des fonctionnaires. Leur caisse de retraite fonctionne par répartition et doit rester équilibrée. Pour y parvenir, des cotisations « employeur » sont prélevées et inscrites au budget des administrations. Ces taux ont augmenté au fil des années : 74 % en 2020, puis 82,6 % attendus en 2028, d’après les éléments évoqués par l’IPP.
Ces niveaux sont bien supérieurs aux taux observés dans le secteur privé, cités ici à 16,67 % en 2020. Les autorités expliquent généralement ces différences par des facteurs démographiques : la proportion de cotisants par rapport aux pensionnés est faible, « à peine plus d’un cotisant pour un pensionné », note l’étude. À cela s’ajoute la présence d’une part importante de retraités issus d’entreprises privatisées, comme l’ex-France Télécom, ce qui pèse sur la charge à financer.
Conséquences pour la transparence budgétaire
Le recours à ce CAS rend plus difficile l’identification de la part du budget qui bénéficie effectivement aux missions publiques. Si les montants inscrits sont légitimes en tant que flux de financement des retraites, leur inscription dans les lignes budgétaires des ministères concernés masque la réalité des crédits disponibles pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Au Parlement, ce point suscite des débats sur la transparence et sur la façon d’évaluer correctement l’effort public. Les chiffres cités par l’IPP fournissent une base chiffrée à ces discussions : la différence observée entre montants votés et montants réellement investis illustre la nécessité d’un examen attentif des mécanismes comptables qui structurent le budget de l’État.
En l’état, la convention comptable instaurée en 2006 continue d’affecter la lecture des priorités financières de l’État, en particulier pour la recherche et l’enseignement supérieur, domaines qui restent scrutés à l’aune des objectifs européens en matière d’innovation.