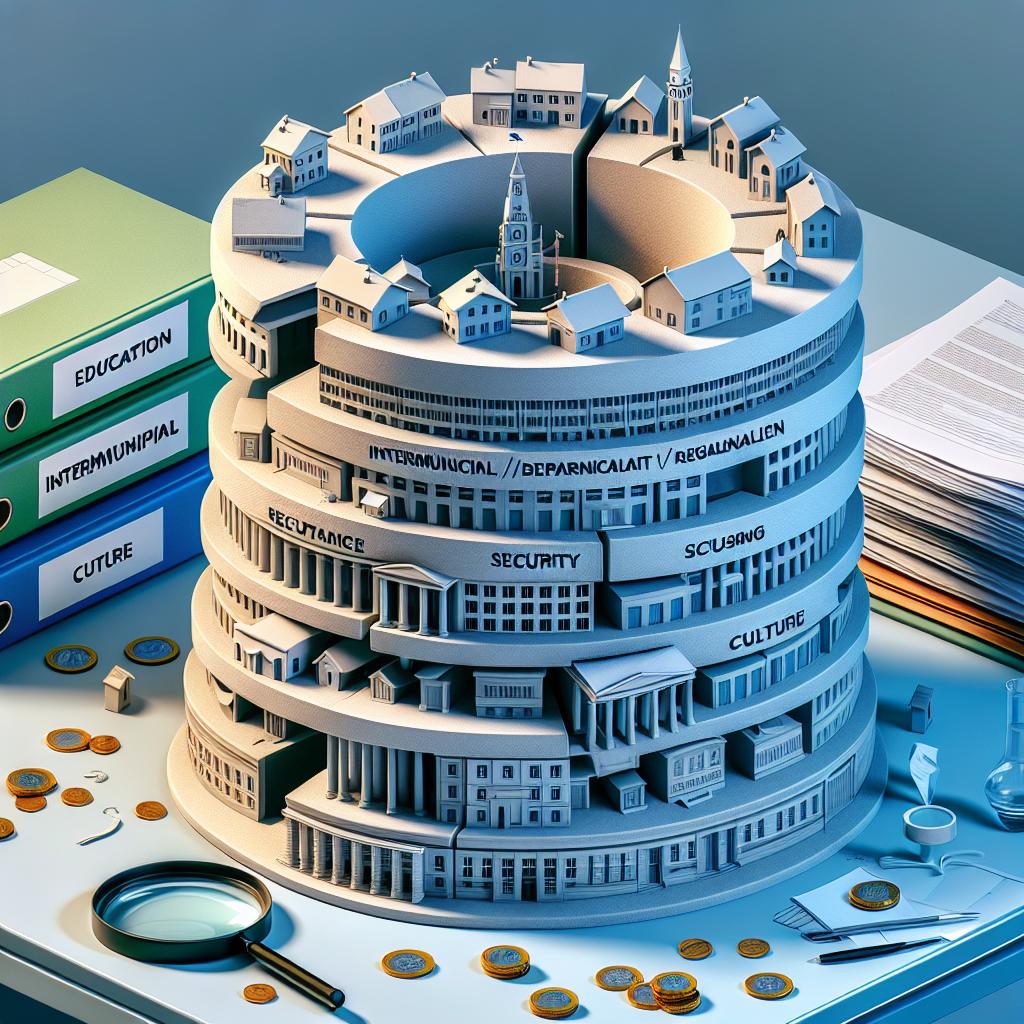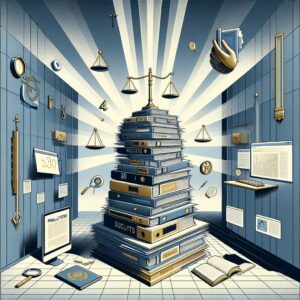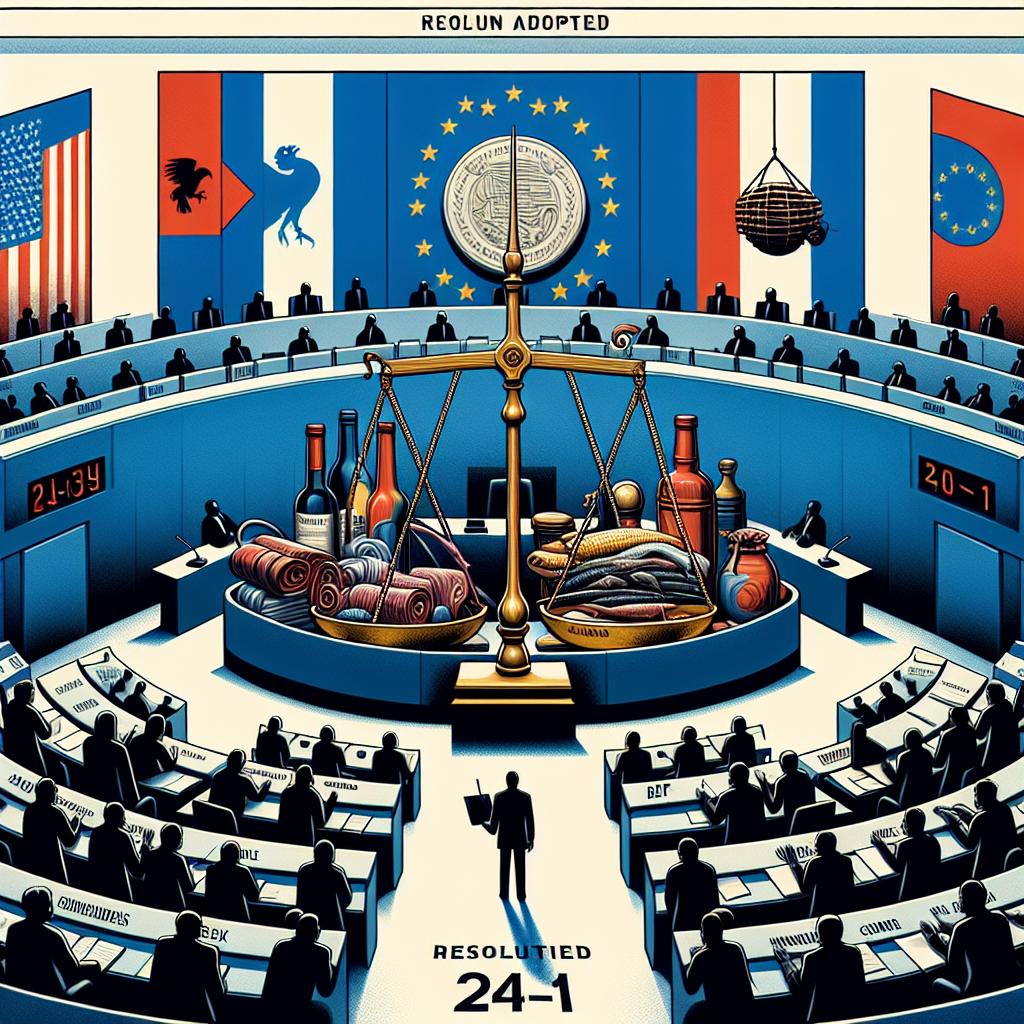« Monsieur le maire, à qui dois‑je m’adresser pour… ? » : cette question revient quotidiennement dans les mairies, traduisant la difficulté des administrés à se repérer dans le millefeuille territorial. Les élus locaux avouent parfois partager cette perplexité. Dans ce contexte, la proposition du Premier ministre, Sébastien Lecornu, visant à réformer l’organisation territoriale pour simplifier la vie des Français et réaliser des économies suscite un accueil favorable chez nombre d’élus et d’observateurs.
Un coût identifié et des exemples locaux
Le rapport publié en mai 2024 par Boris Ravignon (maire Les Républicains de Charleville‑Mézières et président d’Ardenne métropole) avance un chiffre précis : le « millefeuille » coûte chaque année 7,5 milliards d’euros au contribuable. Ce montant sert d’étalon pour illustrer une critique récurrente : multiplications de compétences et chevauchements entraînent des dépenses et complexifient l’action publique.
À l’échelle communale, l’impact est concret. À Zimmerbach (Haut‑Rhin), par exemple, la secrétaire de mairie consacre environ un tiers de son temps de travail à naviguer entre les différentes instances administratives qui interviennent sur des sujets locaux — éducation, eau et assainissement, sécurité, santé, culture, logement, agriculture. Ce témoignage montre que la surcharge n’est pas seulement théorique mais pèse directement sur le fonctionnement des services municipaux.
Entre centralisation et décentralisation : un modèle inachevé
La France demeure, selon les critiques répétées, « au milieu du gué » : elle n’est ni une République pleinement décentralisée, ni un État entièrement centralisé. Le modèle territorial historique, fondé sur le triptyque État‑département‑commune, coexiste désormais avec d’autres configurations, où émergent des acteurs nouveaux — régions renforcées, intercommunalités étendues, et, à un autre niveau, l’Union européenne.
Cette évolution n’a pas fonctionné comme une substitution claire et ordonnée. Les intercommunalités et les régions jouent des rôles utiles, mais la multiplication des niveaux de décision a parfois érodé la proximité du service public. Là où certaines compétences auraient pu être transférées et consolidées, elles se retrouvent partagées entre plusieurs échelons, ce qui accroît l’illisibilité pour les usagers et complique la prise de décision pour les élus.
Supprimer une strate ? Le débat mal posé
Face à ces constats, plusieurs voix réclament la suppression d’au moins une strate administrative. Pourtant, le débat public sur la question est souvent stérile, parce qu’il se concentre sur une formulation trop binaire : faut‑il supprimer la région, le département ou les intercommunalités sur l’ensemble du territoire ?
Cette approche uniforme occulte la diversité des situations locales. Les préférences et les besoins varient selon les territoires : densité démographique, spécialisation économique, maillage des services, ou encore identité locale. Une réforme efficace ne saurait se contenter d’un « couper‑coller » national ; elle doit tenir compte des réalités locales et des missions qui exigent de la proximité.
Vers une réforme pragmatique et différenciée
La nécessité d’un grand projet de réforme apparaît donc claire pour beaucoup d’observateurs : il faut adapter l’organisation territoriale aux enjeux contemporains, renforcer les responsabilités locales là où la subsidiarité est pertinente, et clarifier les compétences entre échelons. L’objectif énoncé par le Premier ministre — simplifier et réduire les coûts — suppose des choix précis et une méthode.
Plutôt qu’un schéma idéologique unique, la réforme devrait reposer sur des critères opérationnels : quelles compétences exigent la proximité ? Quelles fonctions bénéficient d’échelles plus larges ? Comment limiter les doublons administratifs sans fragiliser l’accès aux services ? Les réponses à ces questions conditionneront la nature et l’étendue des suppressions ou des fusions de strates.
Enfin, toute transformation devra tenir compte des ressources humaines et matérielles des collectivités, de la gouvernance locale, et des dispositifs de péréquation. Ces paramètres déterminent la capacité des collectivités à assumer de nouvelles responsabilités ou à absorber des missions transférées.
Le statu quo n’est plus considéré comme une option satisfaisante par de nombreux acteurs. Reste à définir, par une concertation rigoureuse et différenciée, le périmètre d’une réforme qui concilie efficacité, lisibilité et proximité des services publics.