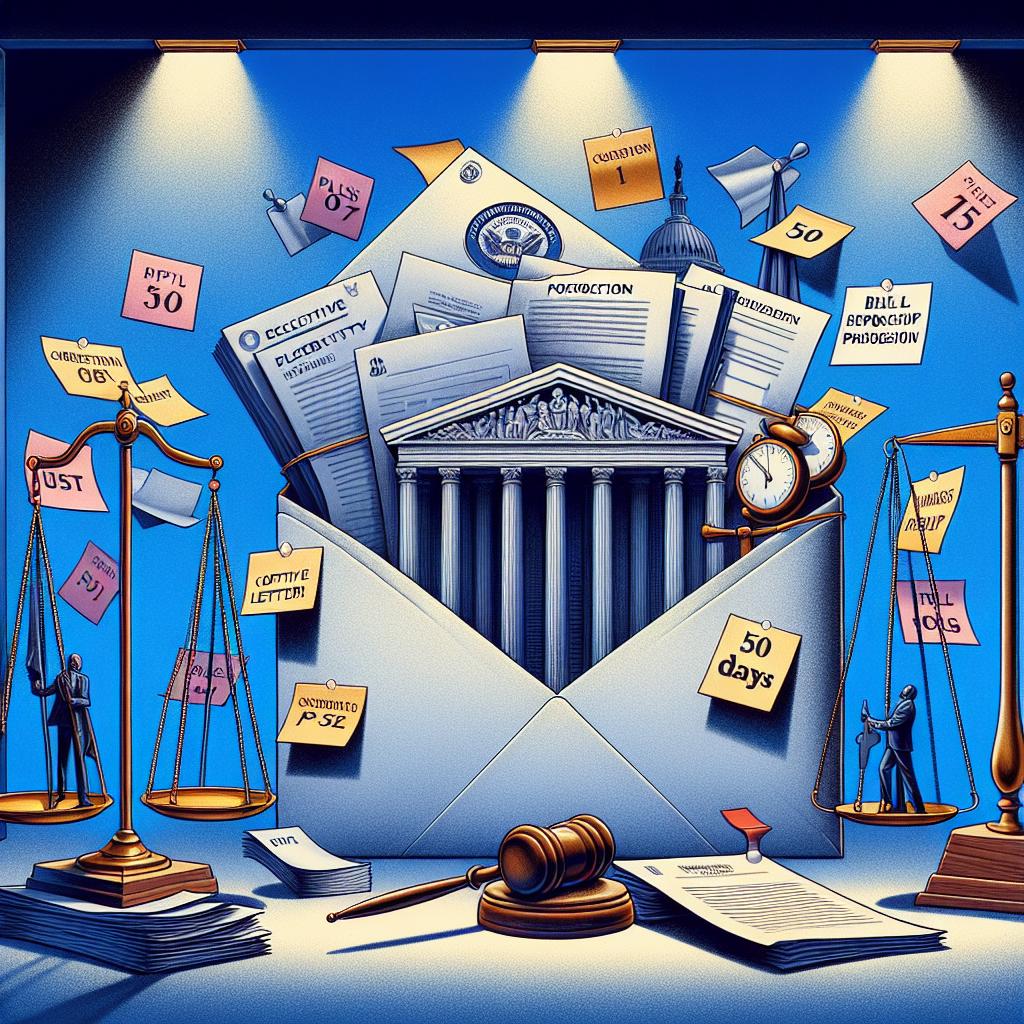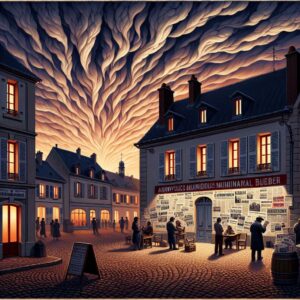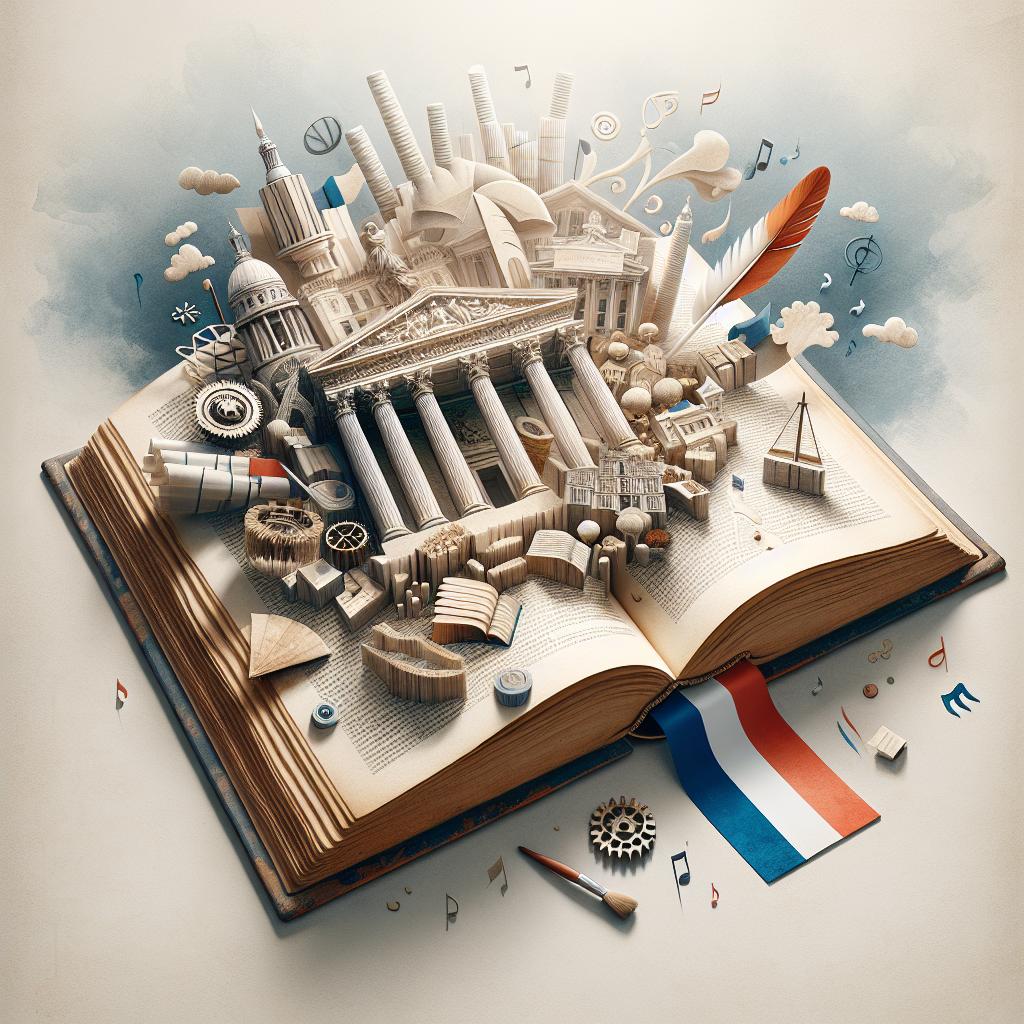La lettre rectificative : une procédure choisie par l’exécutif
Lors de sa deuxième séance des questions au gouvernement, mardi 21 octobre, le ministre chargé des Comptes publics, Sébastien Lecornu, a été immédiatement interrogé sur la suspension annoncée de la réforme des retraites. Il a déclaré dans l’hémicycle que « le conseil d’Etat a été saisi cette nuit d’une lettre rectificative pour ajouter la suspension de la réforme des retraites au budget de la Sécurité sociale, et qu’un conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l’adopter ».
L’usage d’une lettre rectificative permet au gouvernement de déposer un nouveau projet de loi de finances pour la sécurité sociale (PLFSS) intégrant explicitement la suspension de la réforme Borne de 2023. En procédant ainsi, l’exécutif évite le passage par un amendement parlementaire qui, compte tenu des délais serrés liés à l’examen du budget, aurait pu ne pas être discuté.
Par ailleurs, le recours à la lettre rectificative emporte plusieurs conséquences procédurales. Si les parlementaires n’aboutissent pas à un accord sur le budget, le gouvernement rappelle qu’il peut l’adopter par ordonnances : dans ce cas, si la suspension figure dans le texte déposé, elle sera automatiquement portée dans ces ordonnances, ce qui n’aurait pas nécessairement été le cas pour un amendement.
Enfin, la remise d’une lettre rectificative entraîne la réinitialisation du délai légal de débat sur le PLFSS, soit cinquante jours. Cet aspect offre au gouvernement un tempo renouvelé pour la discussion du budget et modifie le calendrier parlementaire.
Interprétations divergentes : suspension, report ou maintien ?
La formulation employée par l’exécutif a suscité des lectures distinctes entre la présidence, le gouvernement et les oppositions. Le président de la République, lors d’une conférence de presse à Ljubljana, a affirmé que des « perspectives de référendum sont possibles » sur les retraites et a nié que l’exécutif ait définitivement acté une « suspension » de la réforme de 2023, parlant plutôt d’un simple « décalage ». Il a précisé qu’une telle consultation « ne pourrait se faire » que sur la base « d’un accord qui serait ainsi scellé », définissant les contours d’un nouveau système.
Ces déclarations contrastent avec l’énoncé de Sébastien Lecornu, qui, dans sa déclaration de politique générale à l’Assemblée le 14 octobre, avait employé le terme de suspension : « Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu’à l’élection présidentielle », avait-il alors déclaré devant les députés.
Réactions politiques immédiates
La présidente du groupe du Rassemblement national à l’Assemblée, Marine Le Pen, a pris la parole dès l’ouverture de la séance de questions pour juger la manœuvre. « Cette suspension ressemble de plus en plus à une fausse promesse. Suspension qui n’est, comme l’a d’ailleurs rappelé le président de la République, qu’un simple report, ou bien la continuation de la réforme Borne », a-t-elle estimé.
Du côté du Parti socialiste, Boris Vallaud a rappelé au premier ministre, depuis la tribune, l’engagement formel qu’il estime avoir été pris. « Il demeure une obligation de résultat, nous jugeons vos actes », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de cohérence entre paroles et actes.
Sébastien Lecornu, répondant aux critiques, a tenu à nuancer son engagement en précisant qu’il s’était engagé sur « la suspension de la mesure d’âge, qui ne serait rien sans la suspension de l’accélération dite Touraine, sur le nombre de trimestres ». Il a également assuré que « le débat devra avoir lieu quoiqu’il arrive ici à l’Assemblée nationale, quoiqu’il arrive avec les partenaires sociaux ».
Un calendrier politique et juridique redéfini
Le choix de la lettre rectificative et la possibilité d’adopter le budget par ordonnances modifient le rapport de forces institutionnel et politique autour de la question des retraites. Si la suspension est formellement inscrite dans le texte présenté par le gouvernement, elle bénéficierait d’une portée juridique différente de celle d’un simple amendement parlementaire.
En pratique, les termes utilisés par les différentes autorités — « suspension », « décalage », « report » — témoignent d’un flou sur l’effet final attendu pour la réforme de 2023. Ce flou alimente les critiques des oppositions et suscite des interrogations sur la manière dont le compromis recherché autour du budget 2026 sera établi, notamment avec le Parti socialiste.
Le dossier reste ainsi à suivre au fil des procédures : saisine du Conseil d’État, réunion du conseil des ministres prévue jeudi matin et, selon l’issue des débats parlementaires, possibilité d’un recours aux ordonnances.