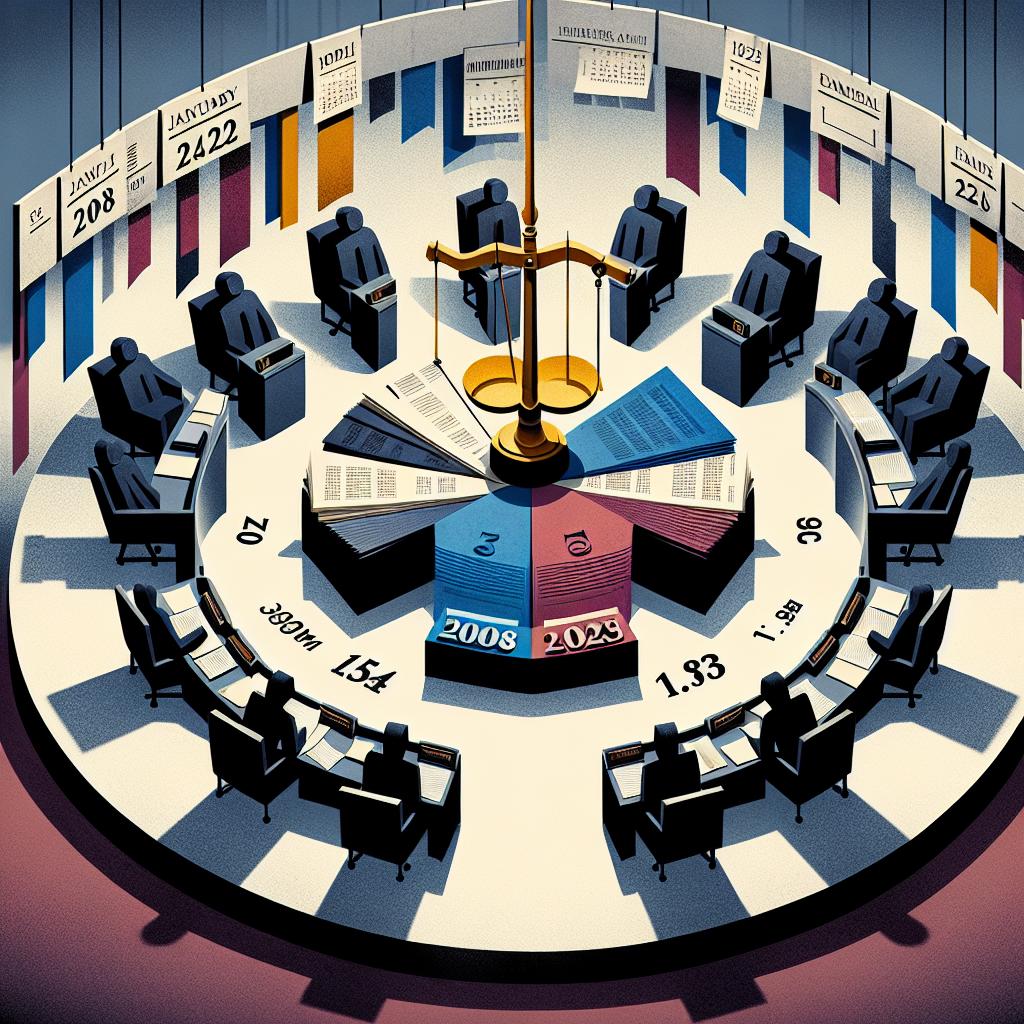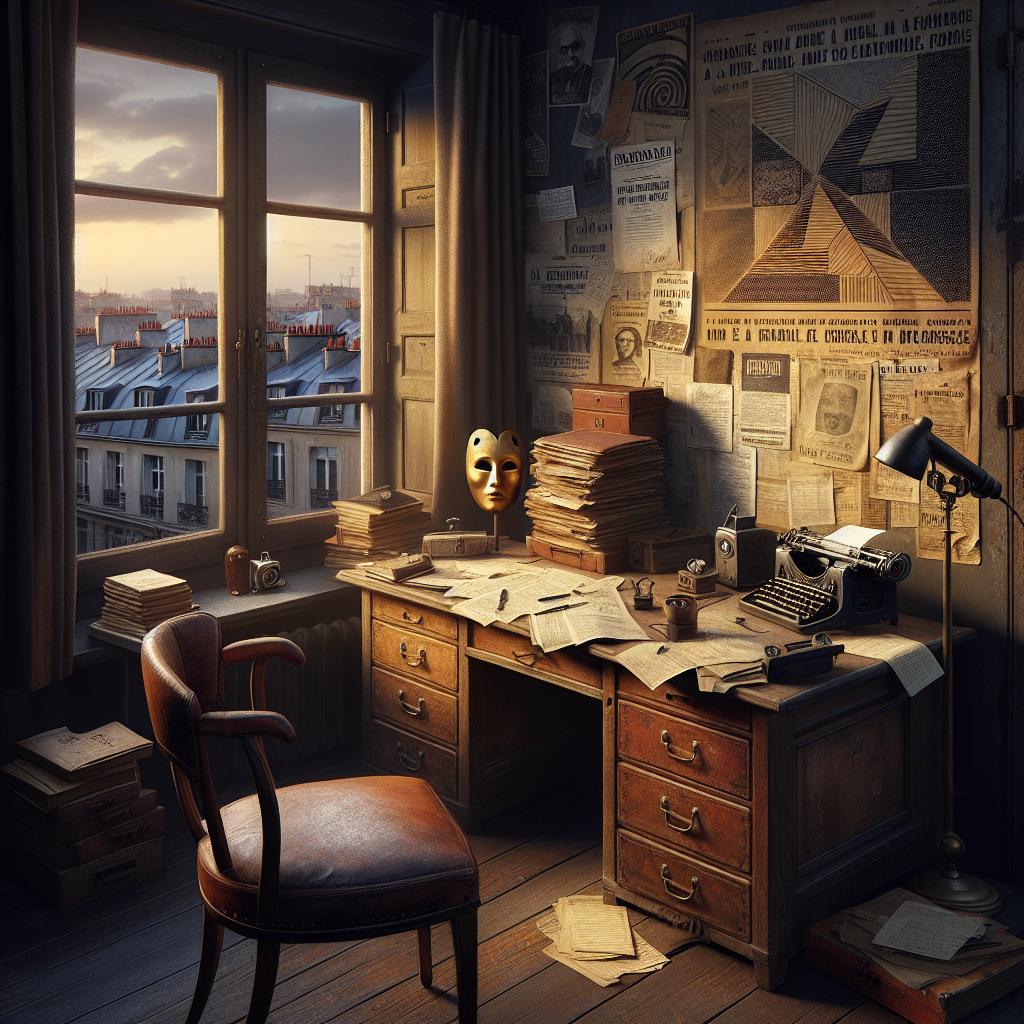Le Parti socialiste (PS) a obtenu une victoire politique notable en obtenant le recul du gouvernement sur la réforme des retraites, une manœuvre qui oblige Emmanuel Macron à revoir son calendrier. Après des négociations serrées avec l’exécutif dirigé par Sébastien Lecornu, le Parlement a voté mercredi 12 novembre, dans un Hémicycle bondé, la suspension du passage à 64 ans par 255 voix contre 146.
Un compromis négocié et ses avancées
Ce résultat résulte d’un compromis que le PS, conduit par Olivier Faure, présentait comme une réponse à trois objectifs. D’abord, réparer la « blessure démocratique » créée, selon le parti, par le recours à l’article 49.3 en mars 2023 pour faire adopter une réforme très impopulaire. Ensuite, contraindre le camp présidentiel qui avait voulu reculer l’âge de départ de deux ans, alors que le projet avait provoqué à plusieurs reprises des mobilisations de plus d’un million de manifestants dans la rue. Enfin, obtenir un bénéfice concret pour une partie des futurs retraités.
Élargie par voie d’amendement gouvernemental aux carrières longues et aux métiers difficiles de la fonction publique, la suspension décidée jusqu’au 1er janvier 2028 devrait permettre à environ 3,5 millions de personnes d’anticiper de quelques mois leur départ à la retraite. Les personnes susceptibles de prendre leur retraite entre 2026 et 2030 pourront faire valoir ce nouveau droit, obtenu dans un contexte politique jugé inédit par les acteurs impliqués.
Failles et fractures au sein de l’espace politique
Le vote de mercredi a d’abord fait voler en éclats le bloc central : des partis se sont répartis entre abstentionnistes, partisans du compromis et défenseurs des 64 ans. La décision a aussi ravivé une fracture nette à gauche. Les écologistes ont salué l’issue comme une avancée, tandis que La France insoumise et le Parti communiste l’ont dénoncée comme une « entourloupe ».
Pour LFI et le PCF, le décalage de quelques mois revient, selon eux, à entériner une retraite à 63 ans et constitue, selon les formules utilisées, « une compromission » ou, au pire, « une trahison » par rapport aux positions défendues en 2022 et 2023. Ces réactions soulignent la persistance des tensions idéologiques entre l’aile radicale de la gauche et son camp plus réformiste, désormais mis en lumière par ce compromis parlementaire.
La division se répercute aussi au sein du monde syndical. La divergence entre syndicats — notamment la CFDT et la CGT — réapparaît, ce qui pourrait affaiblir la capacité d’action collective face à un patronat perçu comme de plus en plus intransigeant.
Conséquences financières et obstacles institutionnels
Si les socialistes se sont indéniablement imposés sur le plan politique, la bataille n’est pas terminée sur le plan institutionnel et budgétaire. Le Sénat, à majorité de droite, dispose d’un levier important et entend peser sur les arbitrages finaux afin d’essayer de restaurer l’âge porté à 65 ans, selon les termes du débat public.
Par ailleurs, le coût de la suspension reste à préciser. À ce stade, il est évalué à 300 millions d’euros pour 2026 et à 1,9 milliard d’euros pour 2027. Ces montants devront être financés, mais les modalités exactes — qui paiera et comment les opérations seront inscrites dans les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2026 et au-delà — restent incertaines.
C’est quand les sources de financement seront identifiées que l’on pourra réellement mesurer les gagnants et les perdants de cette mesure, et évaluer si le compromis constitue une avancée durable ou une solution temporaire aux tensions politiques et sociales.
Les socialistes ont, pour l’instant, remporté une manche en contestant une réforme présentée comme purement paramétrique et critiquée pour son manque de dialogue social. Reste à démontrer que l’accord obtenu répond à une attente profonde, dans un contexte où la question du pouvoir d’achat prime pour une large part de l’opinion.