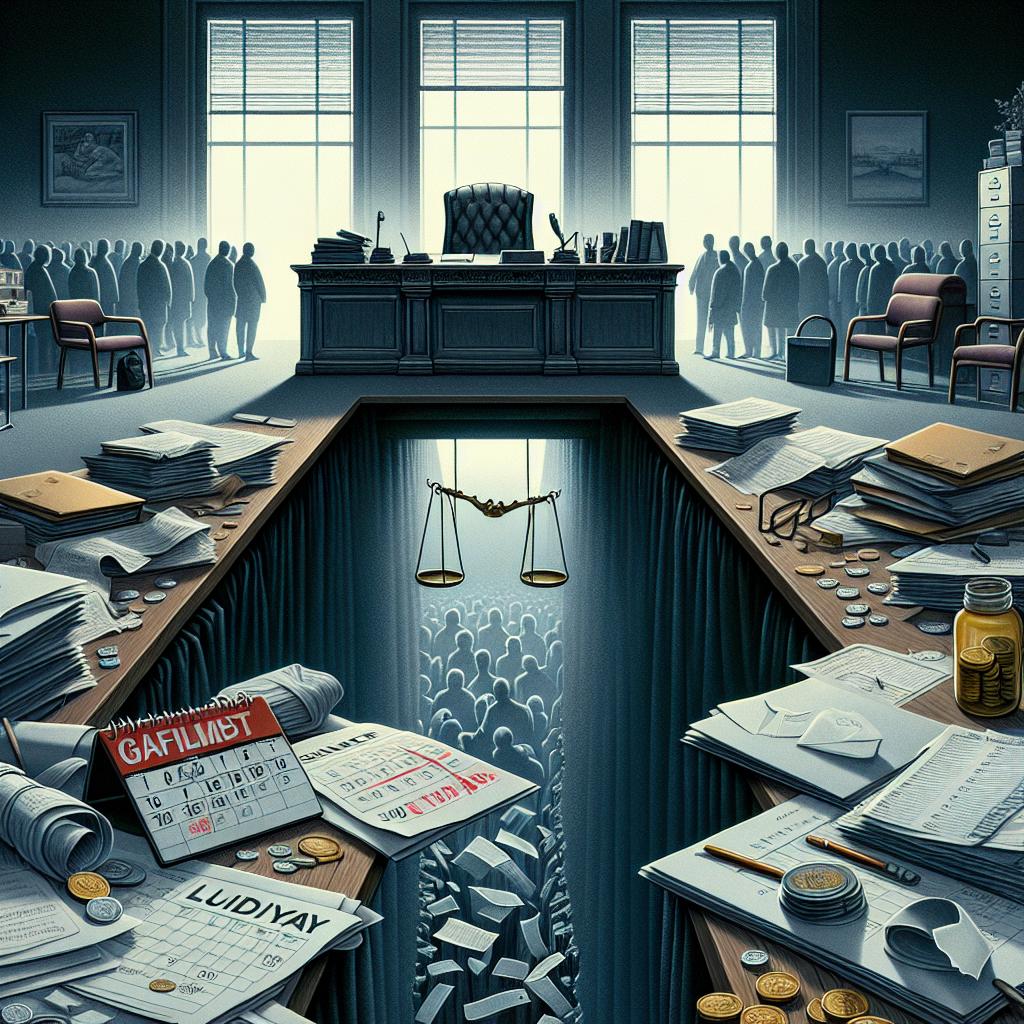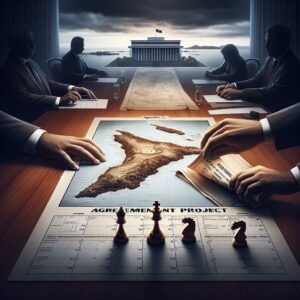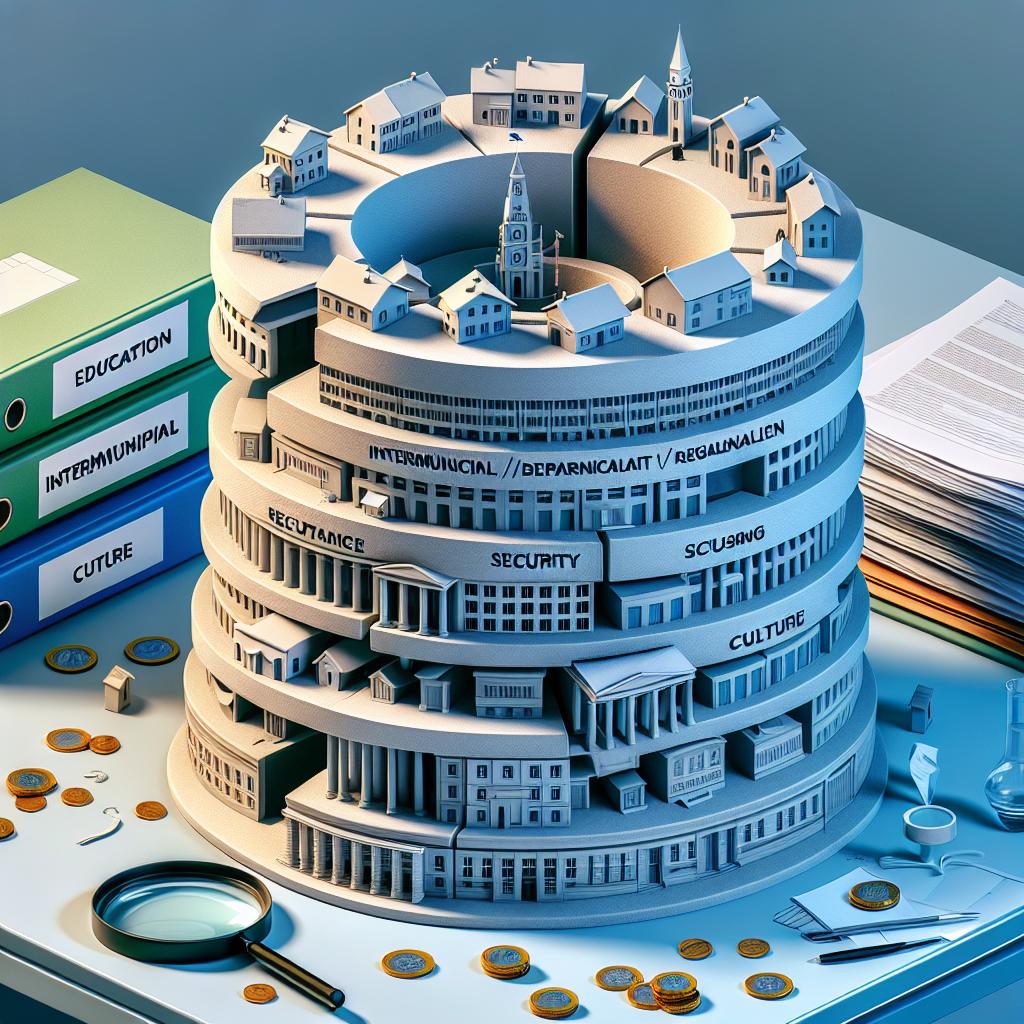La nomination, mardi 9 septembre 2025, de Sébastien Lecornu à la tête du gouvernement n’a guère produit d’effet d’onde dans une France tendue mais loin d’avoir rompu avec l’exécutif. Elle intervient comme la cinquième prise de fonction de Premier ministre depuis le début du second mandat d’Emmanuel Macron et le troisième changement à Matignon depuis la dissolution controversée de 2024.
Une entrée en scène discrète
Le communiqué laconique de l’Élysée annonçant la désignation du ministre de la Défense démissionnaire et la brièveté du discours tenu par le nouveau chef du gouvernement, mercredi 10 septembre 2025, lors de la passation des pouvoirs traduisent une perte d’envergure des deux institutions. La cérémonie s’est déroulée sous une surveillance policière renforcée, en raison du mouvement « Bloquons tout », ce qui a souligné la fragilité du contexte politique.
À peine trois jours après la chute du gouvernement Bayrou, les marges de manœuvre offertes à celui qui doit « recoller les morceaux » paraissent étroites. Le socle commun — l’alliance fragile entre macronistes et droite — est fragilisé, et le profil du nouvel homme fort de Matignon ne rassure pas tous les partenaires politiques.
Un profil qui ne rassure pas
Sébastien Lecornu, élu normand de 39 ans, issu des rangs de l’UMP avant de se rapprocher du chef de l’État, demeure peu connu du grand public. Sa proximité avec Emmanuel Macron est fréquemment soulignée, mais elle n’apparaît pas suffisante pour rassembler. À gauche, certaines prises de position et rencontres — des dîners évoqués avec Marine Le Pen sont régulièrement rappelés — alimentent des suspicions de compromission et compliquent toute tentative d’apaisement.
Sur la ligne politique, rien dans le profil de Lecornu ne semble a priori susceptible d’amadouer facilement le Parti socialiste, devenu incontournable pour faire adopter le budget. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a néanmoins laissé ouverte la possibilité de discussions serrées, en contraste net avec la position de Jean‑Luc Mélenchon, qui maintient une stratégie plus disruptive, tandis que le Rassemblement national, donné favori dans certains sondages, plaide pour une nouvelle dissolution.
Écoute, modestie et le mot « rupture »
Dans sa courte déclaration, le nouveau Premier ministre a employé le terme « rupture », promettant « des ruptures et pas que sur la forme ». Cette évocation vise d’abord à marquer une autonomie vis‑à‑vis de l’Élysée, en soulignant la marge de manœuvre laissée par le chef de l’État pour ouvrir de larges discussions, sans calendrier imposé, avec les forces politiques et les partenaires sociaux prêts à s’inscrire dans cette logique.
Le message était aussi un constat critique implicite sur le style de François Bayrou, dont la pédagogie répétée sur la dette a, selon ses détracteurs, achevé de creuser l’impopularité du précédent gouvernement et de froisser les interlocuteurs censés négocier. À un stade de défiance comme celui‑ci, l’écoute et la modestie apparaissent comme des postures utiles, sinon suffisantes.
Les conditions d’un compromis budgétaire
La question centrale reste toutefois l’application concrète de la « rupture » au projet budgétaire hérité du cabinet précédent. Lecornu devra préciser s’il entend infléchir l’esquisse budgétaire fortement rejetée dans sa forme actuelle. La droite, avec laquelle il cherche à resserrer les liens, demeure ferme sur les questions fiscales ; de leur côté, les socialistes conditionnent leur participation à un processus de non‑censure à l’obtention d’inflexions réelles, en particulier sur la fiscalité des patrimoines les plus élevés.
Aux yeux des Français, la consolidation des comptes publics n’ira que si elle est perçue comme juste. Aujourd’hui, elle est jugée inéquitable : la suppression envisagée de deux jours fériés cristallise la colère, car elle est interprétée comme une demande faite aux actifs — y compris les plus précaires — de travailler davantage pour un moindre gain. Si l’objectif est de redonner une chance au compromis, la copie budgétaire devra être profondément remaniée et accompagnée d’une communication claire sur l’équité des efforts demandés.
À court terme, la nouvelle équipe de Matignon fait face à un dilemme simple mais contraignant : construire des ponts sans trahir les engagements fiscaux attendus par la droite, et convaincre la gauche qu’une rupture annoncée ne signera pas une capitulation des droits sociaux. Le chemin vers un accord paraît étroit et exige des concessions tangibles plus que des promesses de forme.