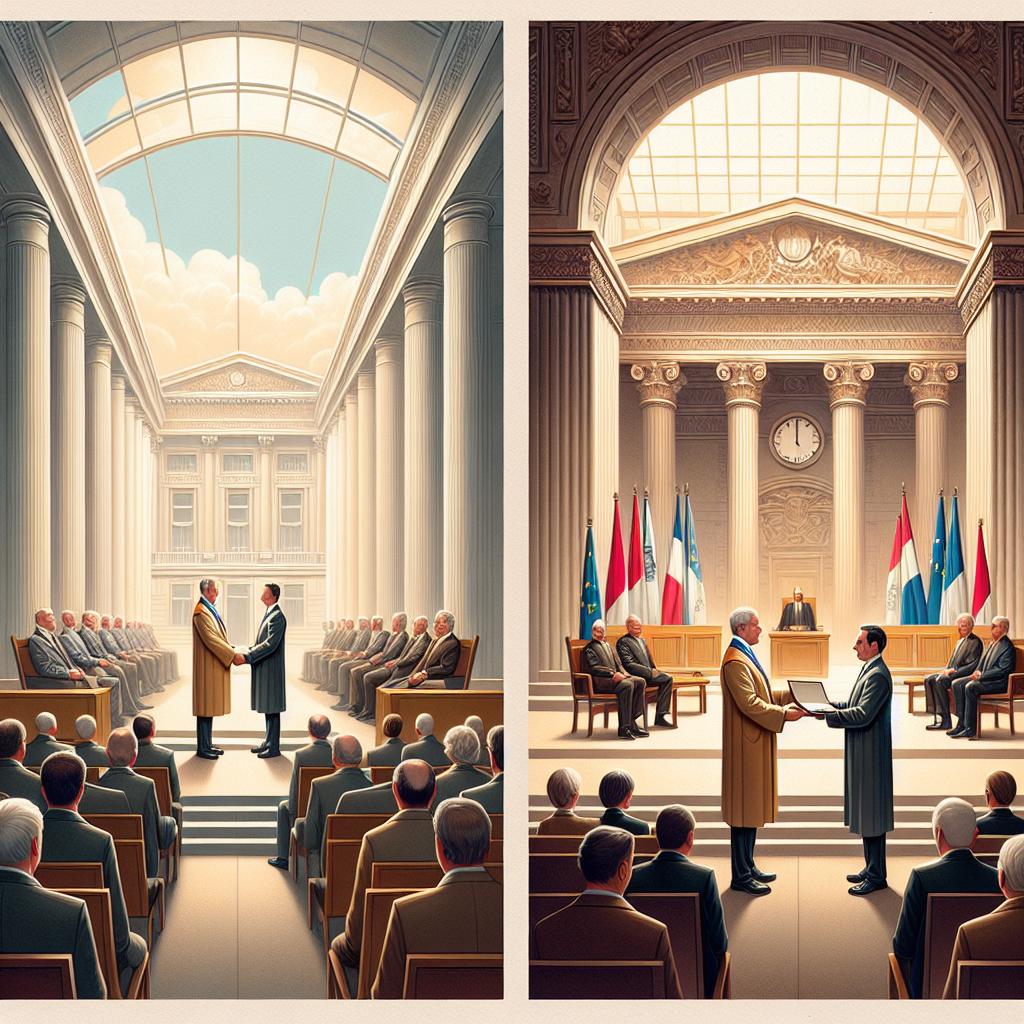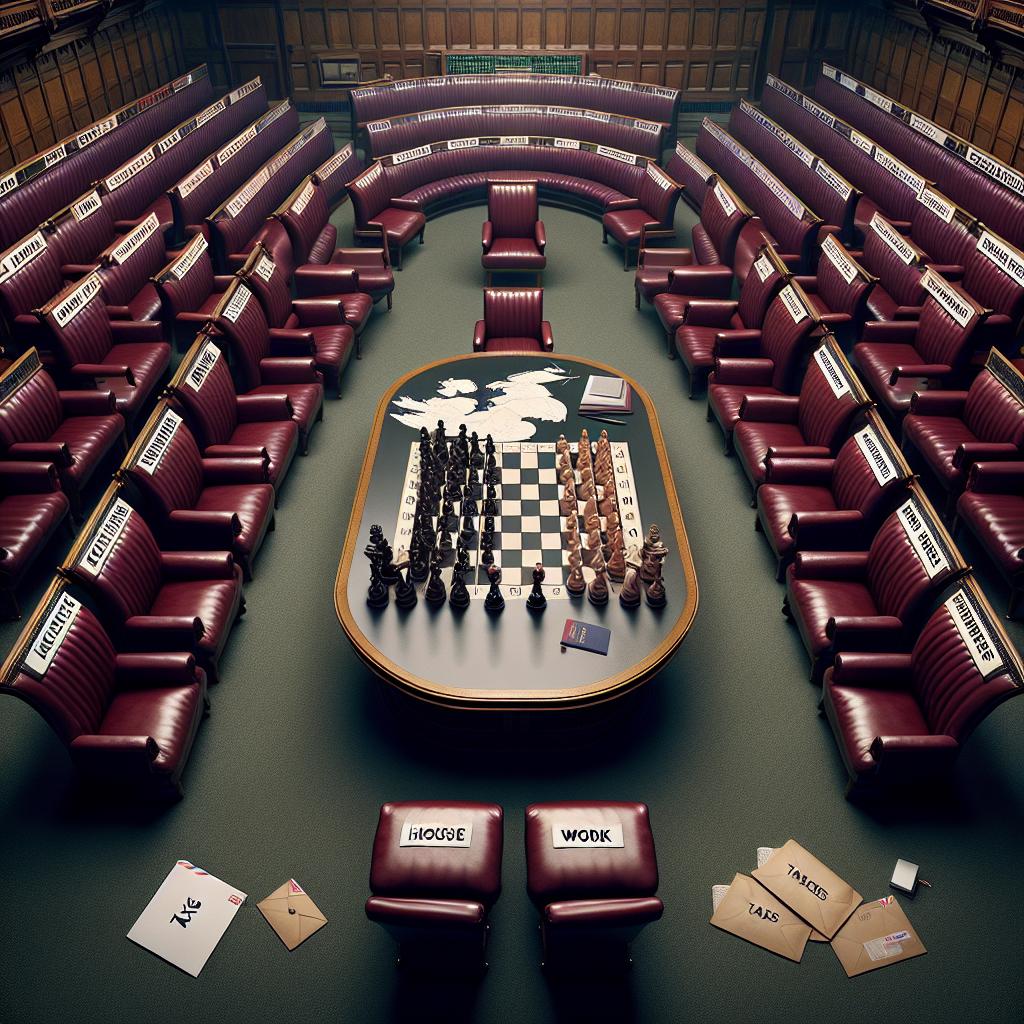Le 16 novembre, un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale proposait que « les soins, actes et prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques ne donnent plus lieu à remboursement », en invoquant l’absence de « validation scientifique » de la Haute Autorité de santé. Il ne s’agit pas d’un ajustement ponctuel, mais de l’exclusion annoncée d’un champ théorique — et de toutes les pratiques susceptibles d’en être « inspirées ».
Une frontière difficile à tracer
La formulation retenue par l’amendement pose une première difficulté pratique : comment définir précisément ce qui serait interdit de prise en charge ? L’expression « se réclamant de la psychanalyse » ouvre une large zone d’indétermination. Cette imprécision risque d’affecter des pratiques très diverses qui ne se présentent pas nécessairement comme psychanalytiques.
Au-delà des étiquettes, la psychanalyse a diffusé des modalités d’accompagnement désormais courantes. Parmi elles : l’écoute centrée sur la personne, l’attention portée au discours, la prise en compte de l’histoire subjective et la valorisation du temps de la parole. Ces éléments sont intégrés dans des dispositifs variés et parfois transversaux.
Un paysage thérapeutique hybride
On retrouve ces postures dans la psychiatrie, les psychothérapies intégratives, les thérapies cognitivo-comportementales, ainsi que dans le secteur médico-social. Elles irriguent aussi des pratiques institutionnelles et des relations d’aide non spécialisées. Ce constat ne prétend pas établir la supériorité d’une approche sur une autre ; il souligne que le champ contemporain du soin psychique est hybride et poreux.
Tracer une limite nette entre ce qui relèverait encore du remboursement et ce qui en serait exclu paraît donc compliqué. Une séparation tranchée serait susceptible d’apparaître arbitraire dès lors que des techniques ou postures cliniques circulent d’un cadre à l’autre et se combinent dans la pratique.
La question de la scientificité
Si l’amendement s’appuie sur l’argument de la scientificité, il est utile de rappeler ce qu’implique une démarche scientifique cohérente. Quand un champ est discuté ou insuffisamment documenté, la réponse usuelle de la recherche n’est pas la suppression mais l’investigation : on finance des études, on met en place des protocoles, on élabore des méthodologies adaptées à l’objet étudié.
Cette approche est la norme pour des thérapies émergentes ou des pratiques expérimentales. La logique scientifique privilégie l’évaluation et l’amélioration continue plutôt que l’exclusion systématique. Appliquer ce principe aux pratiques psychanalytiques, ou à des pratiques partiellement inspirées par elles, impliquerait des dispositifs d’examen et des recherches ciblées.
Or, l’amendement ne propose aucune voie d’examen, aucun financement de recherche, ni aucun dispositif d’évaluation. Il retire une possibilité d’aide sans instruire le dossier et sans prévoir de mécanisme destiné à vérifier les effets ou l’efficacité des pratiques visées.
Cette absence de processus d’évaluation soulève des questions d’ordre éthique et opérationnel. Elle interroge aussi les conséquences concrètes pour des professionnels et des usagers dont les modalités de prise en charge reposent, partiellement ou entièrement, sur des outils et des postures que l’amendement pourrait rendre impossibles à financer.
En l’état, la mesure telle que formulée transforme un débat méthodologique en une décision de nature administrative et budgétaire. La discussion porte moins sur des éléments de preuve que sur la portée d’une exclusion appliquée à un ensemble théorique et à ses héritages cliniques.
Reste que toute évolution de la couverture par l’assurance maladie mérite d’être accompagnée d’une évaluation rigoureuse. Si l’objectif est de garantir la qualité et l’efficacité des soins, la voie la plus cohérente consiste à financer la recherche et à définir des critères d’évaluation clairs, plutôt qu’à repousser à l’extérieur du système des pratiques en partie intégrées au paysage de soin actuel.