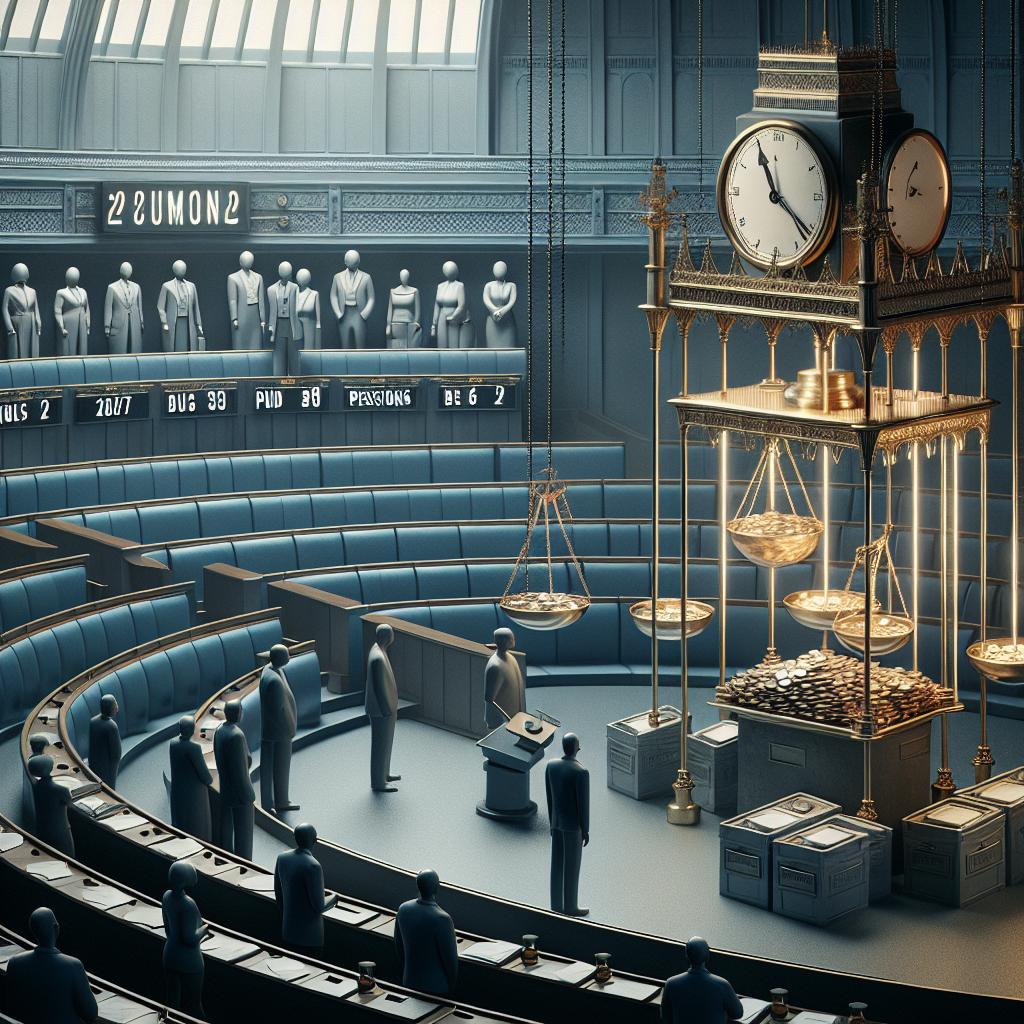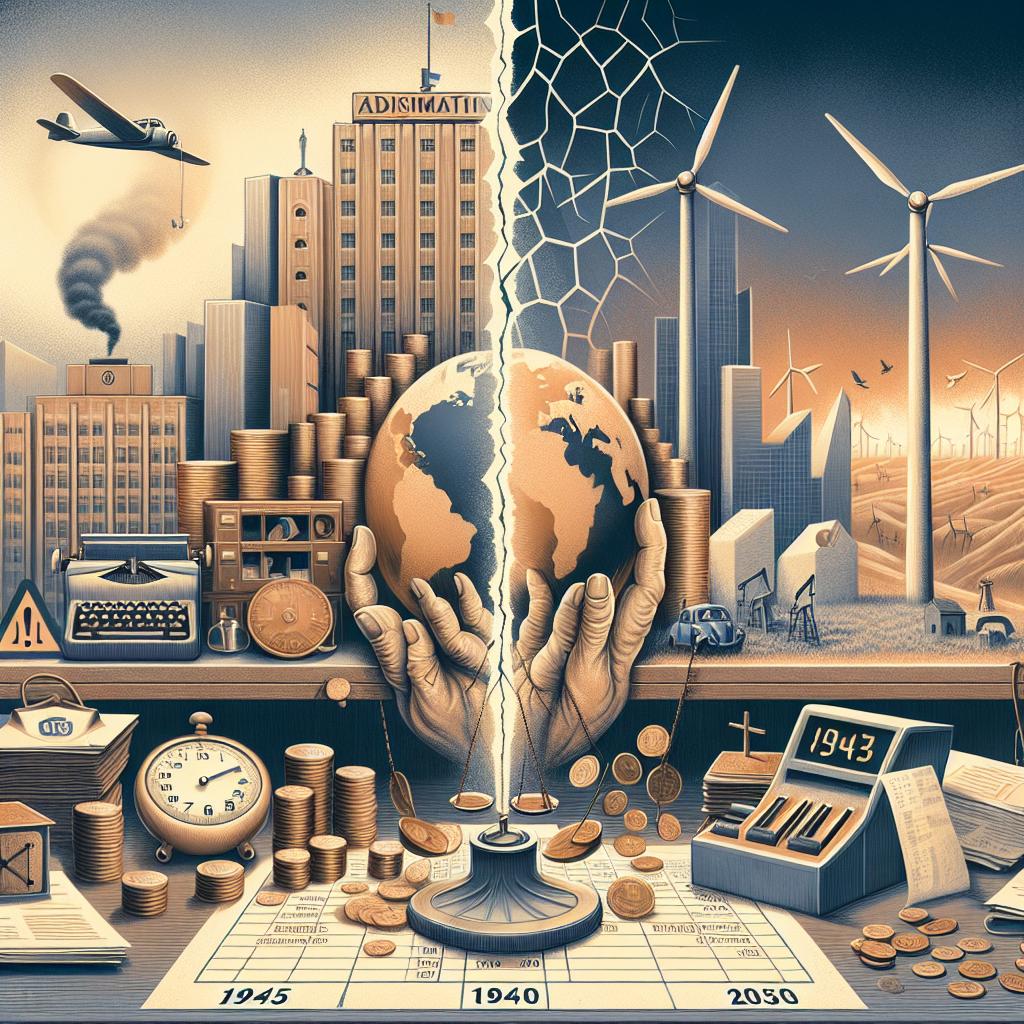Le Sénat alerte sur un décalage persistant entre les annonces gouvernementales et la réalité vécue dans les territoires ultramarins de l’Atlantique. Alors qu’ils sont régulièrement invités à renforcer leurs échanges avec leur voisinage régional, ces territoires restent majoritairement tournés vers Paris et Bruxelles, constate la délégation aux outre-mer.
Un constat adopté à l’unanimité
La délégation aux outre‑mer a adopté à l’unanimité, jeudi 6 novembre, un rapport d’information consacré aux départements et collectivités de l’Atlantique — Guyane, Antilles, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Le document souligne que ce lien quasi‑exclusif avec la métropole et les institutions européennes pèse sur les possibilités d’intégration régionale et, plus largement, sur l’avenir économique et social de ces territoires.
Selon le rapport, ce verrouillage géopolitique et institutionnel n’est pas sans incidence sur le coût de la vie local, un des facteurs régulièrement cités pour expliquer la fragilité sociale et économique de ces collectivités. Le Sénat met en garde contre les risques d’un modèle de développement trop centré sur les relations avec Paris et Bruxelles.
Des progrès mais des limites
Le rapport note toutefois quelques avancées sur le plan de la coopération régionale. Il relève l’ouverture d’une ambassade française au Guyana, la signature de nouveaux accords dans le domaine de la sécurité et le lancement d’une initiative internationale française visant à lutter contre les sargasses. Ces actions traduisent, d’après les rapporteurs, une volonté de mieux intégrer les outre‑mer dans leur environnement régional.
La corapporteuse, la sénatrice (Les Républicains, LR) du Val‑d’Oise Jacqueline Eustache‑Brinio, résume cette évolution en ces termes : « La Caraïbe est redevenue un espace géopolitique très sensible et, grâce à nos territoires d’outre‑mer, la France est présente, stable et crédible dans cette région. »
Pour autant, le rapport souligne que ces progrès restent partiels. Les coopérations bilatérales et multilatérales peinent à renverser des décennies d’habitudes institutionnelles. Les collectivités d’Amérique française demeurent souvent perçues par leurs partenaires régionaux à travers le prisme de l’histoire coloniale et de leur appartenance au régime communautaire européen, une perception qui freine parfois leur intégration.
Enjeux politiques et économiques
Le rapport met en lumière plusieurs enjeux interconnectés. D’abord, la dimension géopolitique : la région caribéenne a regagné en sensibilité stratégique, ce qui renforce l’intérêt pour une présence française active et crédible. Ensuite, les aspects économiques et sociaux : l’insuffisante ouverture régionale peut limiter les opportunités commerciales, les échanges de main‑d’œuvre et les coopérations en matière de développement durable.
Enfin, sur le plan institutionnel, les auteurs évaluent que les réserves des organisations régionales à l’égard de l’intégration des collectivités françaises s’estompent progressivement, mais qu’elles restent présentes. Ces réticences sont en partie liées à l’histoire et au statut particulier des collectivités françaises d’Amérique.
La délégation rappelle par ailleurs son travail antérieur : un rapport similaire a déjà été réalisé pour les territoires de l’océan Indien. Elle annonce la poursuite de cette démarche pour les collectivités du Pacifique, prévue début 2026. Cette feuille de route vise à dresser un panorama complet des relations entre la France et ses collectivités ultramarines dans les différentes zones océaniques.
Le texte adopté au Sénat appelle à des réponses plus nuancées et adaptées aux réalités locales. Il recommande de préserver la spécificité des liens institutionnels avec Paris tout en multipliant les partenariats régionaux, afin de réduire la dépendance excessive et de favoriser des dynamiques de coopération locale.
Sans détailler de mesures précises dans le résumé public cité ici, le rapport insiste sur la nécessité d’un double mouvement : renforcer la présence et l’action de la France dans la région tout en donnant aux collectivités davantage de marges de manœuvre pour tisser des liens durables avec leurs voisins.
Le constat porté par la délégation aux outre‑mer souligne enfin que l’équilibre entre relations métropole‑outre‑mer et intégration régionale reste fragile. Les décisions politiques à venir, tant à Paris qu’au niveau local, seront déterminantes pour transformer les progrès récents en gains durables pour les populations des territoires atlantiques.