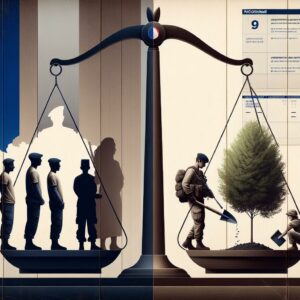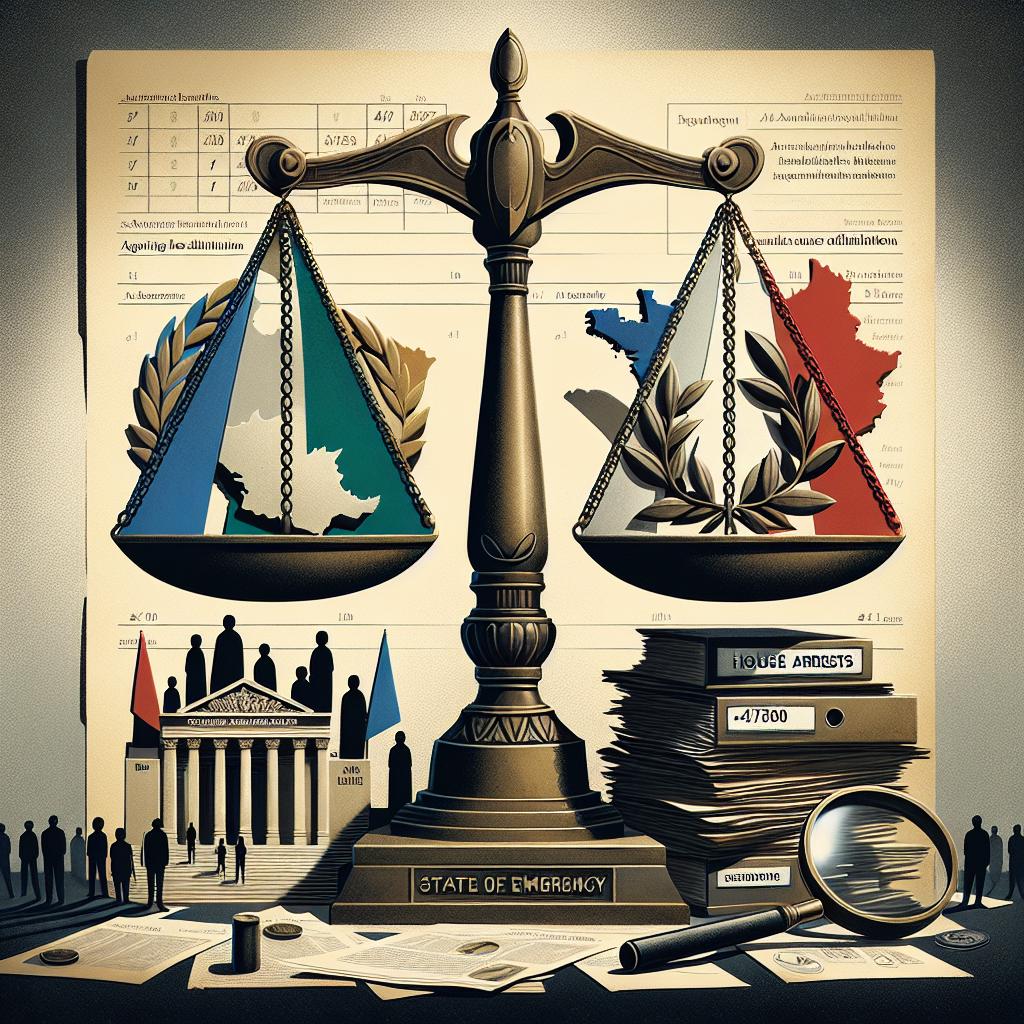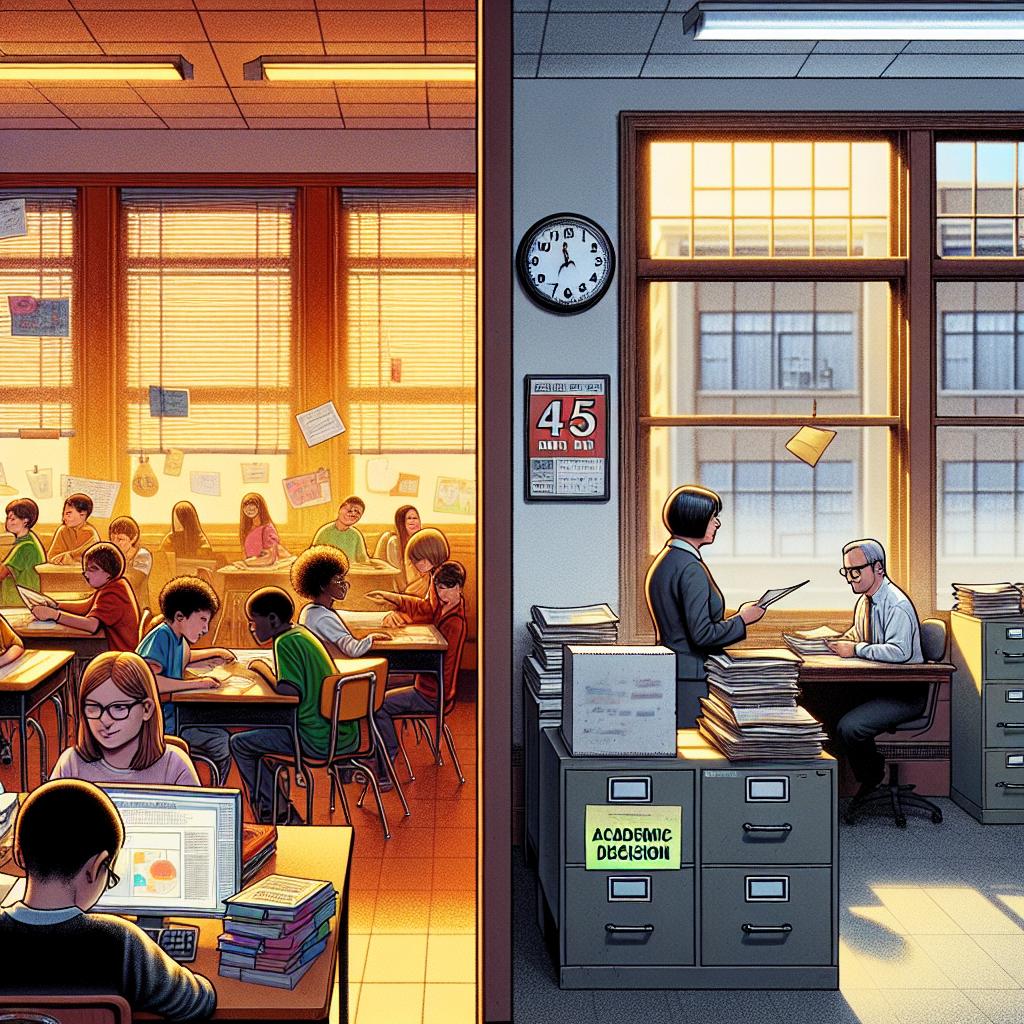Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 27 novembre 2025 à Varces‑Allières‑et‑Risset (Isère), la création d’un « service national » militaire volontaire destiné aux jeunes majeurs. Présenté comme « purement militaire » et limité à dix mois, ce dispositif repose sur le volontariat et, selon le président, s’exercera sur le territoire national. L’annonce marque une inflexion significative dans la manière dont la France organise la participation citoyenne à la défense, plus de vingt‑cinq ans après la suspension du service militaire décidée par Jacques Chirac.
Un contexte géopolitique invoqué
Le gouvernement situe cette décision dans un contexte européen et international changé : l’invasion russe de l’Ukraine et un rééquilibrage des engagements des États‑Unis poseraient, selon l’exécutif, de nouvelles questions sur le lien entre la nation et ses forces armées. Le président a insisté sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un retour à la conscription obligatoire mais d’un renforcement de la contribution des citoyens à l’effort de défense, aux côtés d’un développement des réserves et de l’armée professionnelle.
Cette logique n’est pas inédite en Europe : plusieurs pays ont récemment renforcé la place des volontaires et des réservistes dans leurs dispositifs militaires, dans un climat d’incertitude sécuritaire. L’annonce peut ainsi être lue à la fois comme une réponse politique au « bellicisme » exercé par Moscou et comme un signal de solidarité envers des voisins confrontés aux mêmes défis.
Objectifs affichés et questions pratiques
Sur le plan opérationnel, plusieurs éléments restent au centre du débat : comment sélectionner et former les quelques milliers de volontaires attendus, comment articuler ce service avec les dispositifs existants (classes de défense, journées défense et citoyenneté) et quel suivi sera assuré après la fin des dix mois. L’armée recrute déjà massivement : des études et articles publics rappellent que chaque année environ 90 000 jeunes se présentent aux tests de recrutement, ce qui fait de la défense un des principaux employeurs pour les jeunes en France.
Le chiffre élevé des candidatures soulève deux défis concrets. D’une part, la sélection devra être adaptée aux besoins opérationnels des armées pour éviter un hiatus entre formation et emploi effectif. D’autre part, il faudra prévoir un accompagnement des volontaires, notamment pour leur insertion à l’issue du service et pour la coordination avec les autres dispositifs de préparation à la défense.
Débats politiques et pédagogie
L’annonce présidentielle intervient dans un contexte politique tendu. Certains observateurs relèvent la dimension rassembleuse recherchée par un chef d’État dont la popularité est mise à l’épreuve ; d’autres rappellent que la sécurité nationale est une question d’intérêt public nécessitant un débat approfondi au‑delà des logiques politiciennes.
Le président a cherché à apaiser les inquiétudes en précisant la portée territoriale du service, après la polémique suscitée par des propos récents du chef d’état‑major des armées, le général Fabien Mandon, qui avait évoqué la nécessité pour le pays d’être « prêt à accepter de perdre ses enfants » dans l’hypothèse d’un conflit majeur. Ces déclarations ont ravivé la nécessité d’une pédagogie renforcée et d’un dialogue public sur les enjeux réels de la défense et sur les contraintes humaines que celle‑ci implique.
Références aux dispositifs antérieurs et leçons à tirer
Le nouveau service national est souvent rapproché du service national universel (SNU) lancé en 2019. Ce dernier avait visé des objectifs variés — mixité sociale, engagement civique, sensibilisation à la défense — mais a suscité des critiques sur l’ambiguïté de ses finalités et sur son coût. Plutôt que de reprendre les mêmes mécanismes, l’exécutif devra préciser les finalités militaires du nouveau dispositif et démontrer son adéquation avec les besoins des forces.
Par ailleurs, des études sociologiques rendues publiques en 2024 par la politiste Anne Muxel montrent un regain d’intérêt des jeunes pour l’engagement et une diminution de l’antimilitarisme. Ces travaux indiquent aussi que, chaque année, environ 90 000 candidats se présentent aux tests de recrutement des armées et qu’une part importante de la jeunesse se dit prête à s’engager en cas de conflit. Cette réalité sociale est l’un des éléments qui rend possible, sur le papier, le recrutement d’un contingent volontaire.
Enjeux à court et moyen terme
À court terme, l’exécutif devra clarifier le calendrier, les modalités de sélection, la rémunération, et les objectifs chiffrés du dispositif. À moyen terme, l’articulation avec la montée en puissance annoncée des réserves et la modernisation des forces déterminera si ce service national contribue réellement à la résilience défensive du pays.
L’annonce de fin novembre ouvre donc une nouvelle séquence de discussion publique sur la défense. Au‑delà des intentions présidentielles et des campagnes de communication, la réussite du projet dépendra de sa traduction opérationnelle, du rapport coûts‑bénéfices et de la capacité des pouvoirs publics à conduire une pédagogie claire auprès des jeunes et de la société.