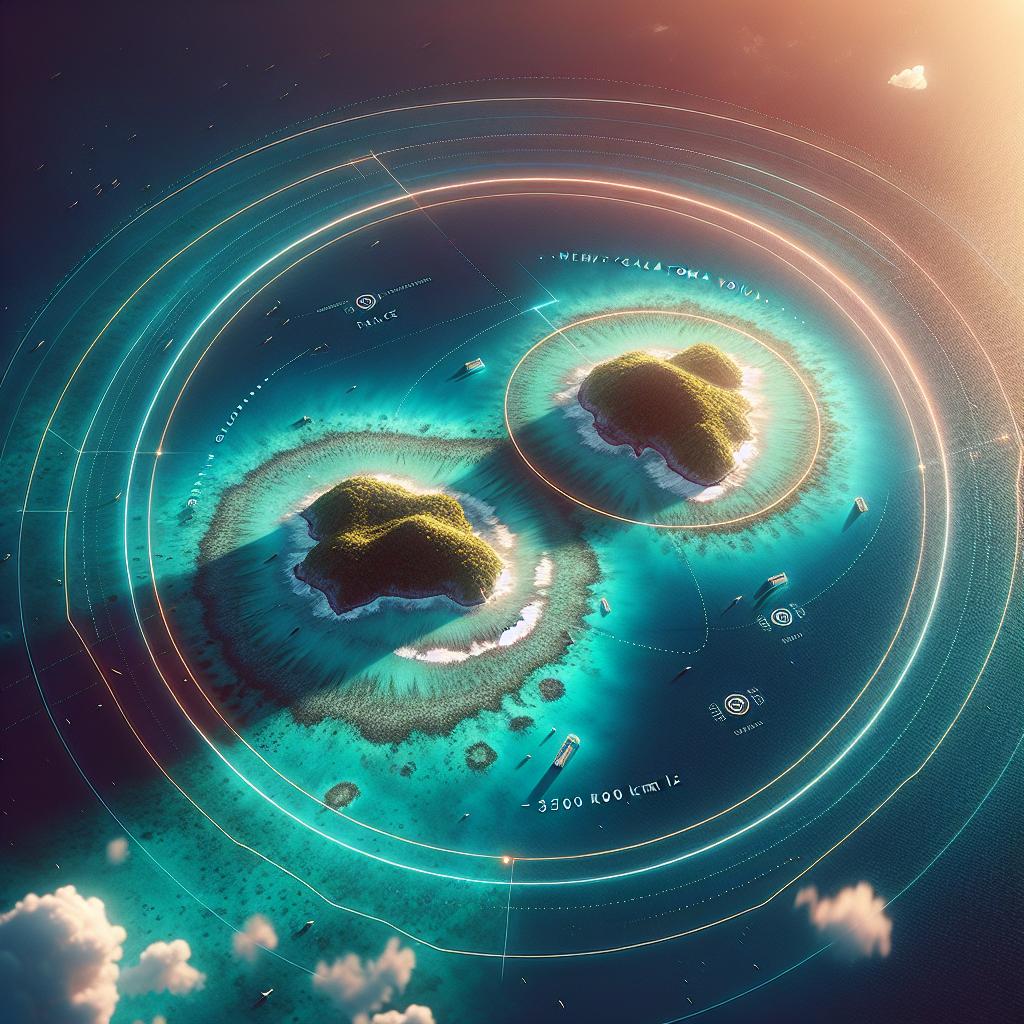Lors d’une interview récente sur BFM Business, Eric Coquerel, président (La France insoumise) de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a éprouvé des difficultés à expliquer le mécanisme dit de « taxe Zucman ». Sa prise de parole a donné l’impression qu’il ne maîtrisait pas complètement le dispositif, utilisé depuis par les opposants à cette proposition fiscale.
Le principe de la taxe Zucman
La taxe imaginée par l’économiste Gabriel Zucman vise à instaurer un impôt plancher sur les patrimoines très élevés. Concrètement, il s’agit de taxer à hauteur de 2 % les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. L’argument central est que certains ultra‑riches peuvent recourir à des mécanismes d’optimisation fiscale — légalement permis — qui rendent, à partir d’un certain seuil, l’impôt régressif.
Les partisans du dispositif soulignent qu’une part infime des contribuables, estimée à 0,1 % des plus fortunés, paierait en réalité un taux d’imposition inférieur à celui des ménages plus modestes. Le but affiché est donc de rétablir une progressivité plus conforme à l’objectif redistributif de l’impôt.
Le cas Mistral AI mis en avant
La discussion a pris une tournure concrète lorsqu’un cas particulier a été évoqué : celui d’un des fondateurs de Mistral AI, présenté comme un « champion français de l’intelligence artificielle » et valorisé, selon l’exposé, à 12 milliards d’euros malgré des pertes d’exploitation. Interrogé sur ce point, Eric Coquerel a répondu : « Si son entreprise ne gagne pas d’argent, elle ne produit pas de patrimoine. Il ne paiera pas cette taxe, parce que cela ne concerne que les gens qui gagnent de l’argent. »
Cette réponse heurte la logique du mécanisme original. La taxe Zucman entend fiscaliser le patrimoine professionnel, y compris lorsqu’il se compose d’actions d’une société non cotée et peu liquides. Autrement dit, une valorisation sur papier — fondée sur une levée de fonds ou une estimation du marché — peut entraîner une imposition même si l’entreprise n’est pas encore bénéficiaire et que la richesse ne s’est pas matérialisée en liquidités.
Dans ce contexte, les fondateurs de Mistral pourraient, selon le raisonnement du dispositif, être amenés à verser au fisc plusieurs millions d’euros chaque année alors que leur fortune reste, pour l’instant, essentiellement une promesse de valeur future.
La proposition de céder des actions comme solution
Pour répondre à l’objection selon laquelle certains contribuables n’ont pas les liquidités nécessaires pour s’acquitter de la taxe, Gabriel Zucman propose un mécanisme de conversion : ceux qui manquent de trésorerie pourraient céder des actions à l’État ou à leurs salariés pour payer l’impôt.
Cette solution soulève toutefois plusieurs questions pratiques et juridiques. D’abord, la cession d’actions entraîne une dilution du capital et peut remettre en cause le contrôle exercé par les fondateurs. Ensuite, elle touche au droit de propriété et aux accords actionnariaux existants, qui ne sont pas neutres et peuvent nécessiter des renégociations longues.
Un autre point important est l’affectation du produit de ces cessions. Si les actions cédées sont logées dans un fonds souverain ou redistribuées aux salariés, le rendement effectif pour le budget de l’État peut être très différent de ce que promettent les partisans de la taxe. Autrement dit, l’impôt transformé en titres ne génère pas nécessairement une rentrée de trésorerie directe permettant de combler un déficit public.
Enjeux politiques et techniques
Au-delà des débats de principe, le dossier met en lumière un arbitrage complexe entre objectifs redistributifs et contraintes pratiques. La taxation d’actifs illiquides pose des problèmes d’évaluation, de trésorerie et de droits des actionnaires qui exigent des réponses techniques précises, au risque sinon d’engendrer des effets pervers pour l’investissement et la gouvernance des entreprises innovantes.
La controverse illustre aussi le rôle des porte‑parole politiques : toute approximation dans l’explication d’un dispositif fiscal détaillé peut fragiliser sa défense publique et renforcer les critiques. Le débat autour de la taxe Zucman demeure donc à la fois économique, juridique et politique, et il nécessitera des développements normatifs et opérationnels avant toute éventuelle mise en œuvre.