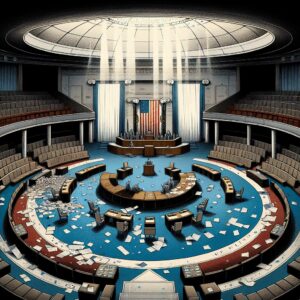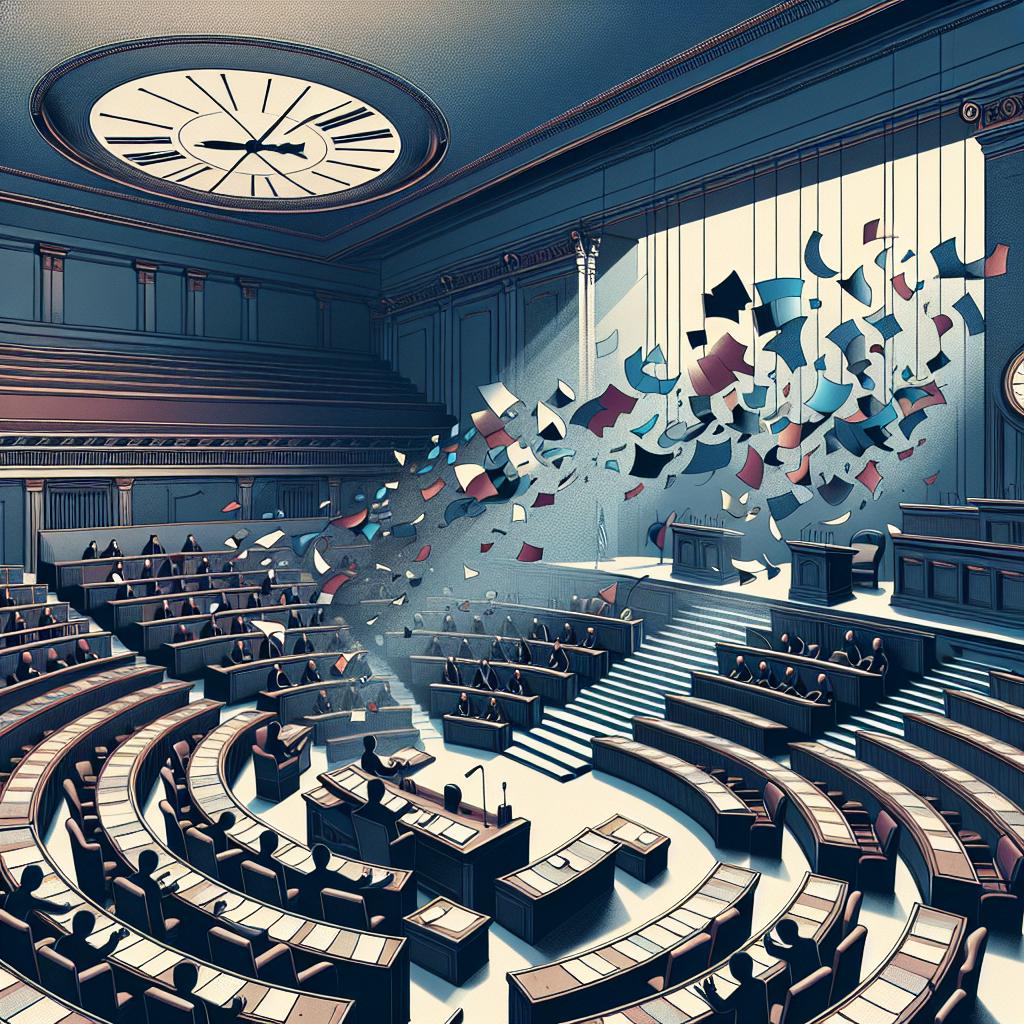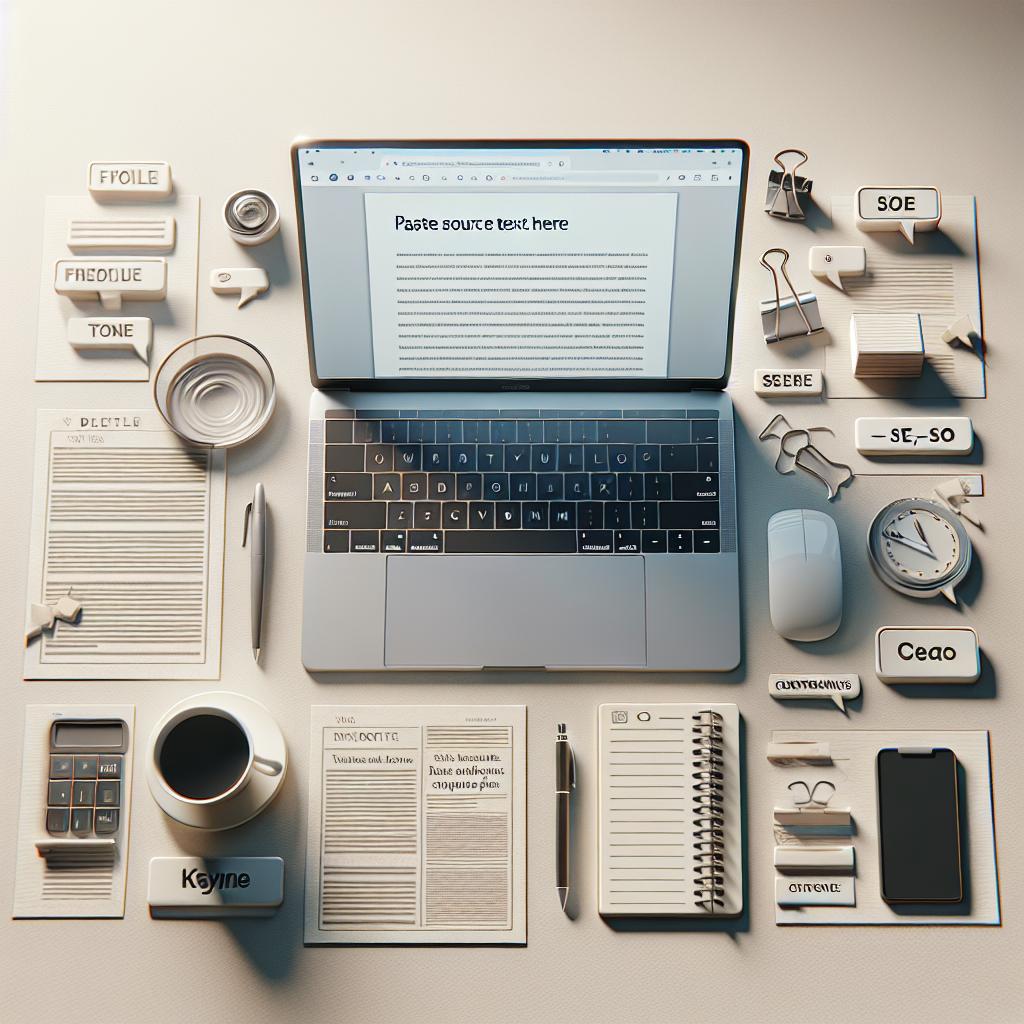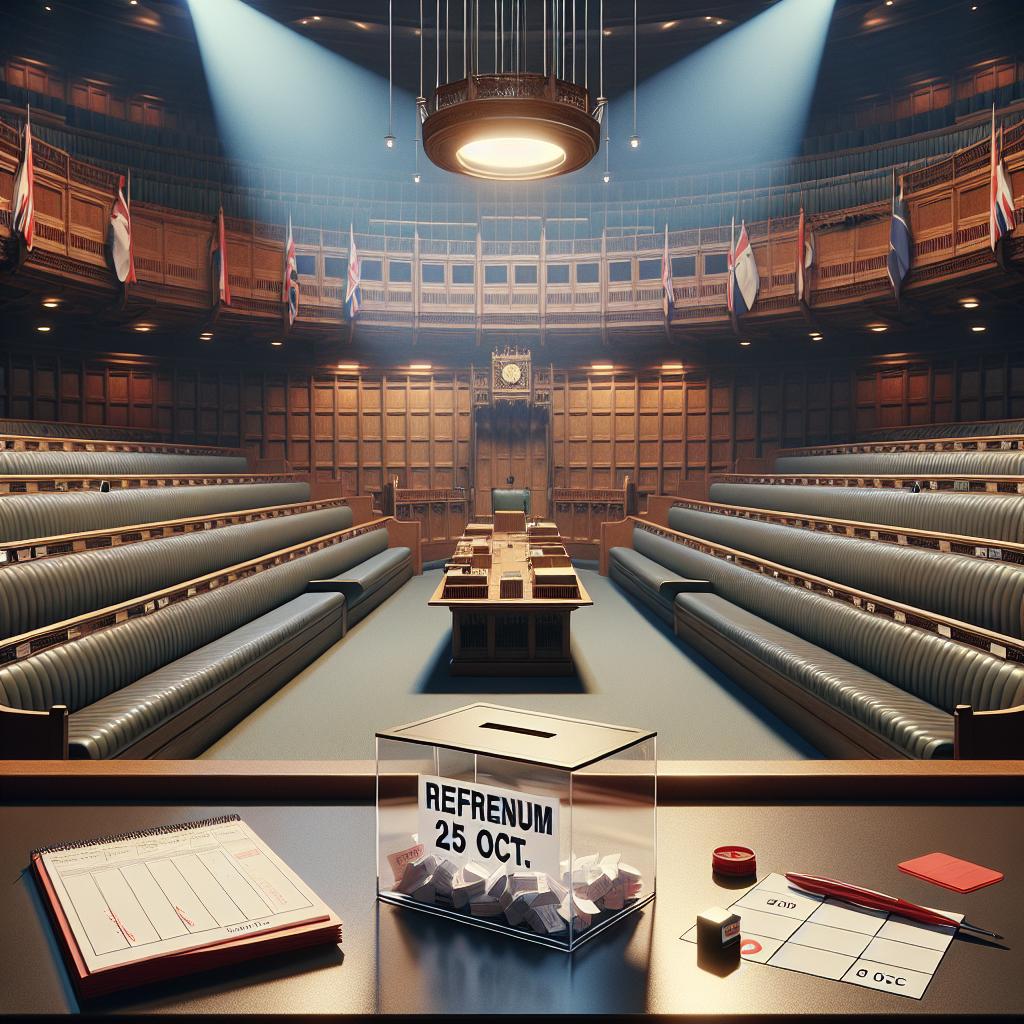La taxe dite « Zucman » — du nom de Gabriel Zucman (économiste, professeur à l’Ecole normale supérieure et directeur de l’Observatoire européen de la fiscalité) — visant les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros est au centre des discussions budgétaires. Un rendement annuel de 20 milliards d’euros est régulièrement avancé par ses promoteurs. Ce chiffrage mérite toutefois une lecture critique : il surestime, selon plusieurs analyses, le montant effectivement recouvrable.
Réactions comportementales et rendement effectif
La principale limite au rendement apparent de la taxe est liée aux réactions des contribuables. Face à une imposition nouvelle ou renforcée, les détenteurs de très gros patrimoines peuvent modifier leurs comportements via l’évasion fiscale ou l’optimisation (déplacements de revenus ou d’actifs au sein des possibilités légales ou quasi-légales) ou par l’exil fiscal (relocation de personnes ou d’actifs hors du ressort fiscal). Ces ajustements réduisent sensiblement les recettes attendues lorsqu’on passe d’un calcul « mécanique » à des recettes effectives observées à long terme.
Des études empiriques portant sur des réformes antérieures de la fiscalité du capital — qui touchaient des assiettes plus larges et des taux plus faibles que ceux envisagés pour la taxe Zucman — concluent qu’un euro prélevé mécaniquement ne se traduit, à long terme, que par environ 0,25 euro de recettes effectives. Cette estimation structurelle rend compte des comportements d’optimisation et d’exil observés après des changements fiscaux.
Un rapport du Conseil d’analyse économique publié en juillet confirme, pour la France, l’importance de l’exil fiscal parmi ces réponses comportementales. Même si les effets agrégés sur la croissance ou sur le produit intérieur brut restent modérés, ils sont en revanche très significatifs par rapport aux montants de recettes attendues : des pertes relatives importantes peuvent résulter de mouvements de capitaux ou de personnes au sein d’un petit groupe de contribuables très riches.
De 20 milliards annoncés à 5 milliards plausibles
En appliquant le ratio observé entre recettes mécaniques et recettes effectives (0,25), le rendement potentiel de la taxe Zucman se réduit fortement. Sur la base d’un scénario mécanique donnant 20 milliards d’euros par an, la traduction en recettes effectives à long terme conduirait plutôt à environ 5 milliards d’euros annuels.
Dans cette perspective, la taxe Zucman ne permettrait pas d’opérer une compression aussi importante du déficit structurel qu’annoncé si l’on se fonde sur le seul calcul mécanique. En d’autres termes, l’effet sur le solde public serait moindre que le chiffre brut avancé initialement.
Limites, incertitudes et prudence dans les estimations
Il convient de souligner les incertitudes qui entourent toute projection de recettes nouvelles. La taxe Zucman serait un instrument inédit par sa concentration sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Il est donc difficile d’affirmer avec certitude que les comportements observés lors de réformes passées se reproduiraient exactement dans ce contexte nouveau.
Plusieurs facteurs peuvent modifier le rendement réel : la conception précise de la taxe (assiette, exemptions, modalités de déclaration), la coordination internationale ou l’absence de celle-ci, la capacité de l’administration fiscale à contrôler et à réprimer l’évasion, ainsi que les délais avant que des ajustements comportementaux ne se manifestent pleinement. Ces éléments peuvent atténuer ou renforcer l’écart entre recettes « mécaniques » et recettes « effectives ».
Face à ces incertitudes, il paraît plus prudent pour les prévisions budgétaires de fonder les estimations de recettes sur des hypothèses incluant des réactions comparables à celles observées lors de réformes antérieures, plutôt que de retenir un chiffrage purement mécanique. Cette approche permet de calibrer les attentes et d’évaluer plus précisément la contribution potentielle de la taxe au financement des dépenses publiques ou à la réduction du déficit.
En résumé, si la taxe Zucman représente une piste politique pour taxer les très hauts patrimoines et répondre aux questions d’équité fiscale, son rendement réel est susceptible d’être nettement inférieur à l’estimation brute de 20 milliards d’euros. Une projection prudente et fondée sur l’expérience historique oriente plutôt vers un ordre de grandeur proche de 5 milliards d’euros par an, sous réserve des choix de conception et de la réaction effective des contribuables.