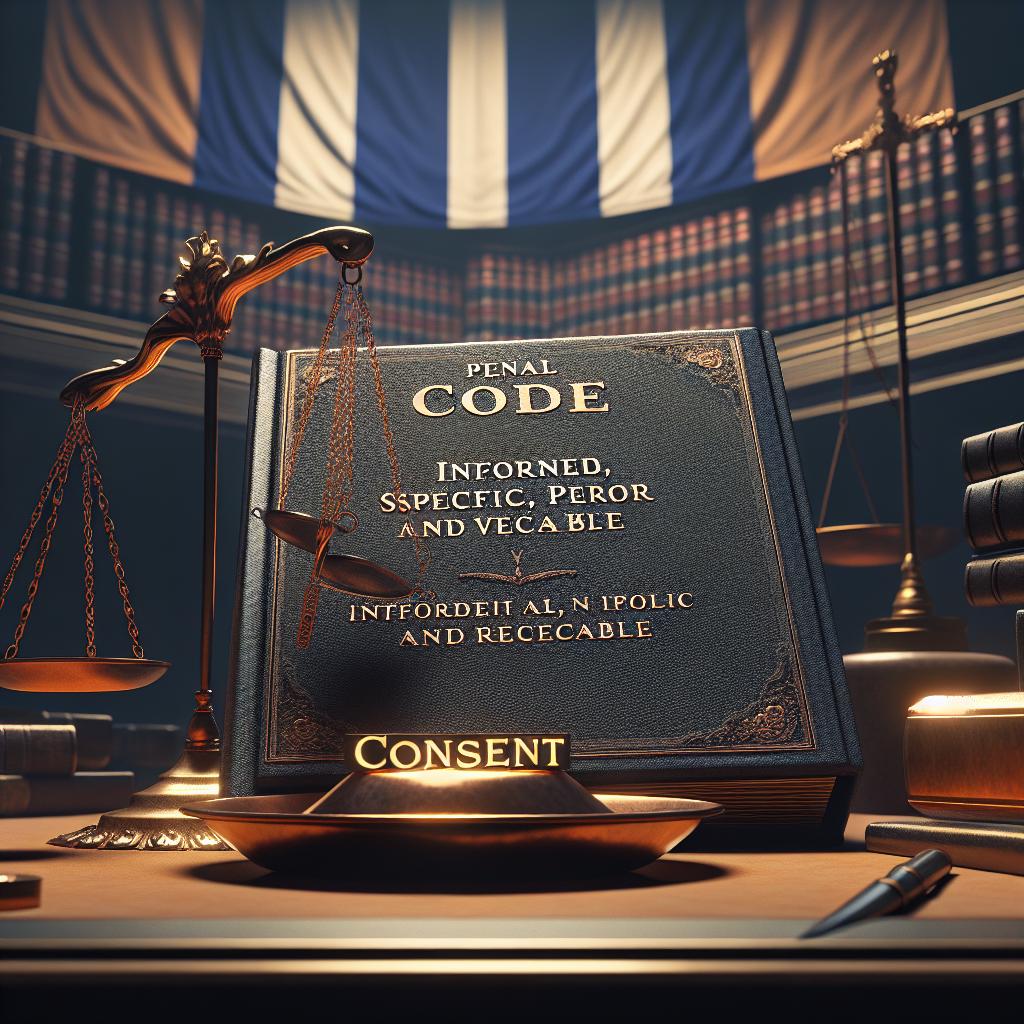Le Sénat a adopté définitivement, mercredi 29 octobre 2025, un texte inscrivant explicitement la notion de consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Le vote s’est déroulé à une large majorité : 327 voix pour et 15 abstentions. Désormais, tout acte sexuel non consenti est juridiquement considéré comme un viol ou une agression sexuelle selon la nouvelle rédaction du Code pénal.
Ce que précise la loi
Le texte introduit une définition du consentement formulée ainsi : « éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Le consentement ne peut, selon la loi, « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Parallèlement, le projet conserve les quatre critères jusqu’ici utilisés en France pour caractériser le viol et les agressions sexuelles. Le texte rappelle que « il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Ces éléments restent donc pertinents pour qualifier les faits lorsque des violences ou des pressions sont avérées.
Une évolution législative encadrée par des traités
La réforme vise à placer le consentement au cœur de la définition pénale des violences sexuelles, et à aligner la France sur des standards internationaux déjà adoptés par plusieurs pays européens. La France s’inscrit ainsi dans la logique de la Convention d’Istanbul, adoptée par le Conseil de l’Europe le 11 mai 2011, qui exige des États parties qu’ils incriminent et répriment « tout acte sexuel non consenti » et mettent en œuvre des enquêtes et poursuites effectives.
Selon le texte de la Convention, l’article 36 stipule que le viol et tout acte sexuel sans consentement mutuel sont considérés comme des infractions. Une quinzaine d’États, dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Suède, avaient déjà intégré la notion de non-consentement dans leur droit interne bien avant la France. Plus récemment, la Norvège a modifié sa législation en juin 2025 pour inscrire le consentement comme critère central.
Un débat européen et national
L’intégration du consentement dépasse le seul cadre national et a alimenté un débat européen long et complexe. Les négociations sur une directive européenne relative à la lutte contre la violence envers les femmes ont buté notamment sur la définition des violences sexuelles. La vice-présidente de la commission des Droits de femmes et de l’Égalité des genres du Parlement européen, Frances Fitzgerald, avait exprimé son regret après l’annonce d’un accord en février 2024 : « Nous n’avons pas pu obtenir une définition commune du viol, c’est une grande déception », avait-elle déclaré. Malgré ces désaccords, elle estimait que le texte en discussion pourrait « faire changer les choses en matière de prévention ».
Au sein du Conseil de l’Union européenne, neuf États membres — la Belgique, la Croatie, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Suède — avaient déjà indiqué leur regret de ne pas disposer d’une définition commune au niveau européen. Certains gouvernements avaient invoqué des contraintes juridiques, en particulier l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour expliquer la difficulté d’harmoniser les incriminations pénales à l’échelle de l’UE.
Origines et portée de la réforme en France
Le changement législatif en France est le résultat d’un long combat porté par les associations de défense des droits des femmes et par des élus. Le texte entend clarifier la loi et faciliter la reconnaissance des situations où le consentement fait défaut, sans pour autant supprimer les moyens d’appréciation existants lorsque des violences matérielles ou morales sont manifestes.
Concrètement, cette évolution devrait influencer les enquêtes et les poursuites en donnant une assise juridique plus explicite à l’absence de consentement. Le texte maintient toutefois les voies d’investigation habituelles lorsqu’il s’agit d’établir des violences, des menaces ou des pressions.
La réforme constitue une étape majeure dans l’encadrement juridique des violences sexuelles en France. Elle inscrit la reconnaissance du consentement éclairé comme principe explicite du Code pénal, tout en conservant les définitions et critères qui permettent d’apprécier les faits dans la pratique judiciaire.