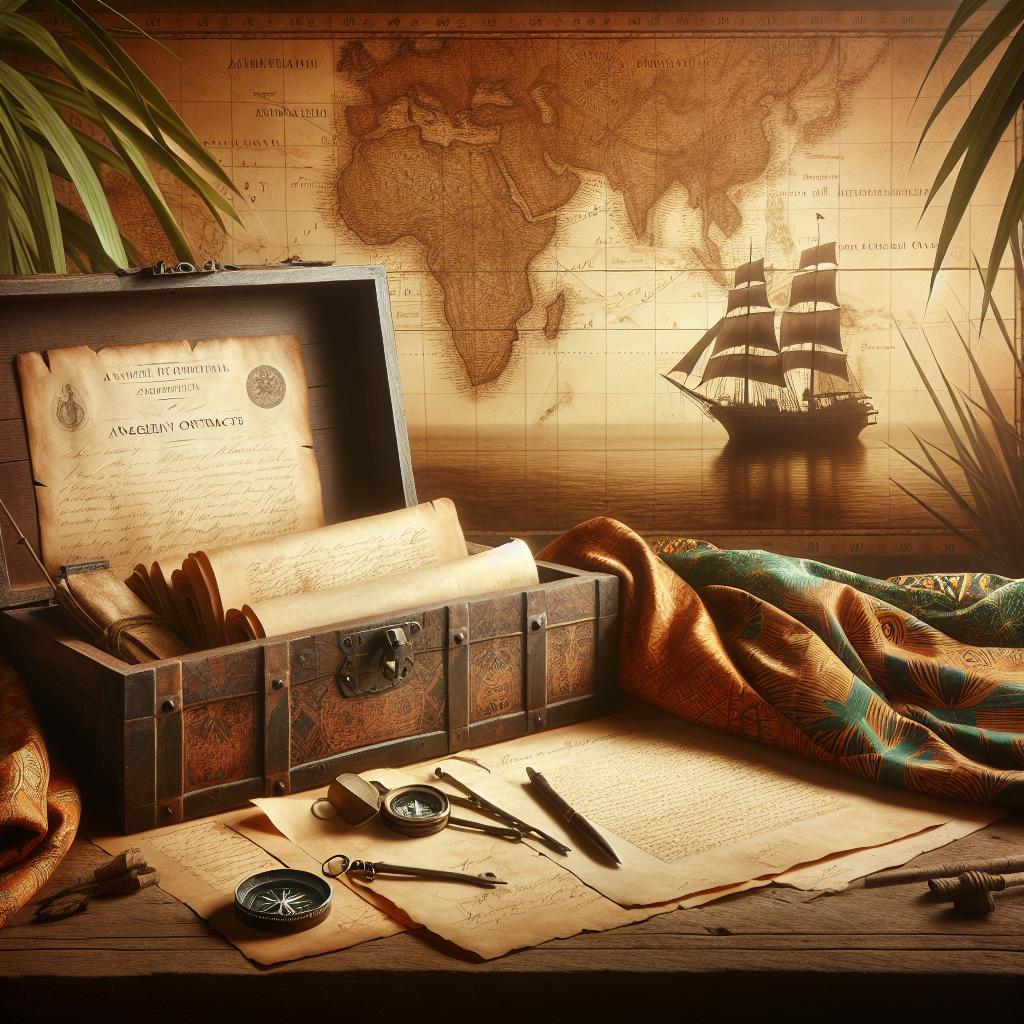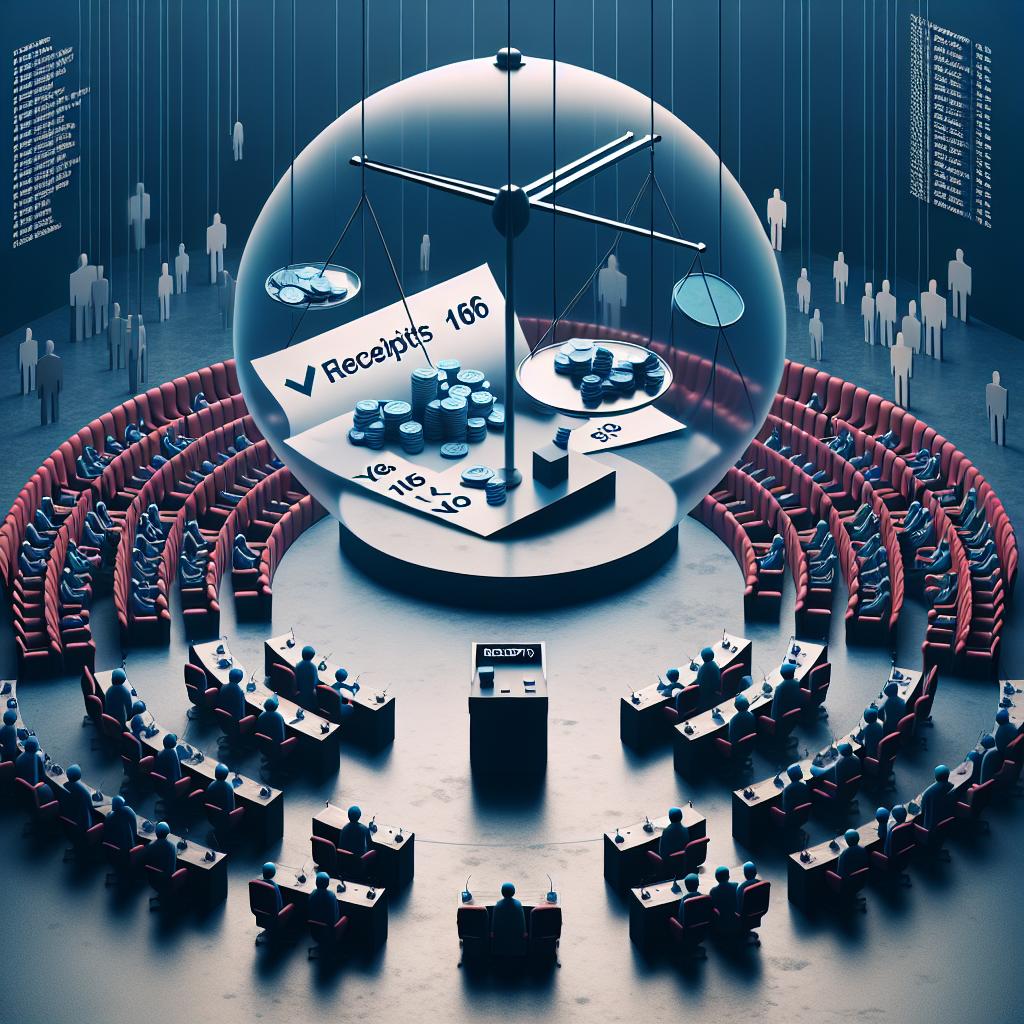Au XIXe siècle, l’engagisme a entraîné l’un des plus importants transferts de population de l’ère coloniale : « au moins cinq millions de personnes déplacées à travers les océans », venues principalement d’Asie et d’Afrique, sont parties travailler dans des conditions qualifiées d’inhumaines au sein des plantations, des usines et des chantiers des empires coloniaux.
Un mouvement massif et peu commémoré
Ce phénomène historique, présenté ici sans dramatisation, a été l’un des principaux moyens pour les puissances coloniales d’assurer une main-d’œuvre servile et bon marché après la fin de l’esclavage. Le terme « engagisme » désigne ces contrats de travail forcé ou fortement contraint qui permirent le transfert d’une main-d’œuvre nombreuse et souvent vulnérable sur de longues distances.
Les chiffres cités — « au moins cinq millions » — soulignent l’ampleur du mouvement mais n’excluent pas des marges d’incertitude liées aux archives incomplètes et à la dispersion des sources. Les personnes concernées provenaient majoritairement d’Asie et d’Afrique, ce qui explique les empreintes culturelles et démographiques laissées dans de nombreuses anciennes colonies.
La Réunion : un recours important après 1848
À La Réunion, l’engagisme a pris une place particulière. La colonie française figure, selon le texte d’origine, parmi les territoires qui y ont le plus eu recours : elle est décrite comme « la colonie française et le dixième territoire au monde à y avoir recouru le plus ».
Ce recours massif s’explique, selon le récit, par deux facteurs clairement avancés : l’abolition de l’esclavage, en 1848, et les besoins considérables en main-d’œuvre imposés par l’expansion de l’industrie sucrière. Après 1848, les planteurs et les industriels cherchèrent à compenser la disparition de la main-d’œuvre asservie par des contrats d’engagés, lesquels ont profondément influencé le peuplement et la composition sociale de l’île.
« Les engagés du sucre » : une exposition pour raconter cette page du peuplement
C’est cette page de l’histoire de La Réunion — qualifiée de « jadis étouffée, encore méconnue et peu enseignée dans les établissements scolaires » — que propose de restituer l’exposition « Les engagés du sucre ». L’événement a obtenu la mention « d’intérêt national » du ministère de la Culture et a été ouvert au public « samedi 15 novembre », au musée Stella Matutina, à Saint‑Leu, à La Réunion.
L’exposition est présentée comme un récit collectif, mettant en lumière la manière dont ces mobilités contraintes ont participé à la formation d’une société multiculturelle. Elle vise à documenter des trajectoires individuelles et communautaires longtemps absentes des récits officiels et scolaires, et à rappeler la dimension humaine derrière des statistiques et des termes juridiques.
Une mémoire à réinscrire dans l’espace public
Le choix muséal et la reconnaissance institutionnelle soulignent une volonté de rendre visible un passé qui a pu être occulté pour des raisons variées, notamment l’émotion sociale liée aux héritages de l’esclavage et aux pratiques coloniales. Raconter l’engagisme, dans ce cadre, revient à reconstituer des histoires familiales, des circulations culturelles et des transformations économiques.
Si l’exposition apporte un cadre visible à cette histoire, le texte signale aussi des lacunes persistantes dans la transmission scolaire. Cette observation invite à poursuivre les recherches historiques et pédagogiques, ainsi qu’à diversifier les supports de mémoire pour que ces récits trouvent une place plus régulière dans l’enseignement et la médiation culturelle.
En restituant des chiffres, des dates et des lieux — sans prétendre combler toutes les zones d’ombre — l’initiative muséale contribue à un travail de clarification et de reconnaissance. Le parcours proposé au musée Stella Matutina se présente comme une étape dans la réinscription de l’engagisme et de ses conséquences dans la conscience collective de l’île.