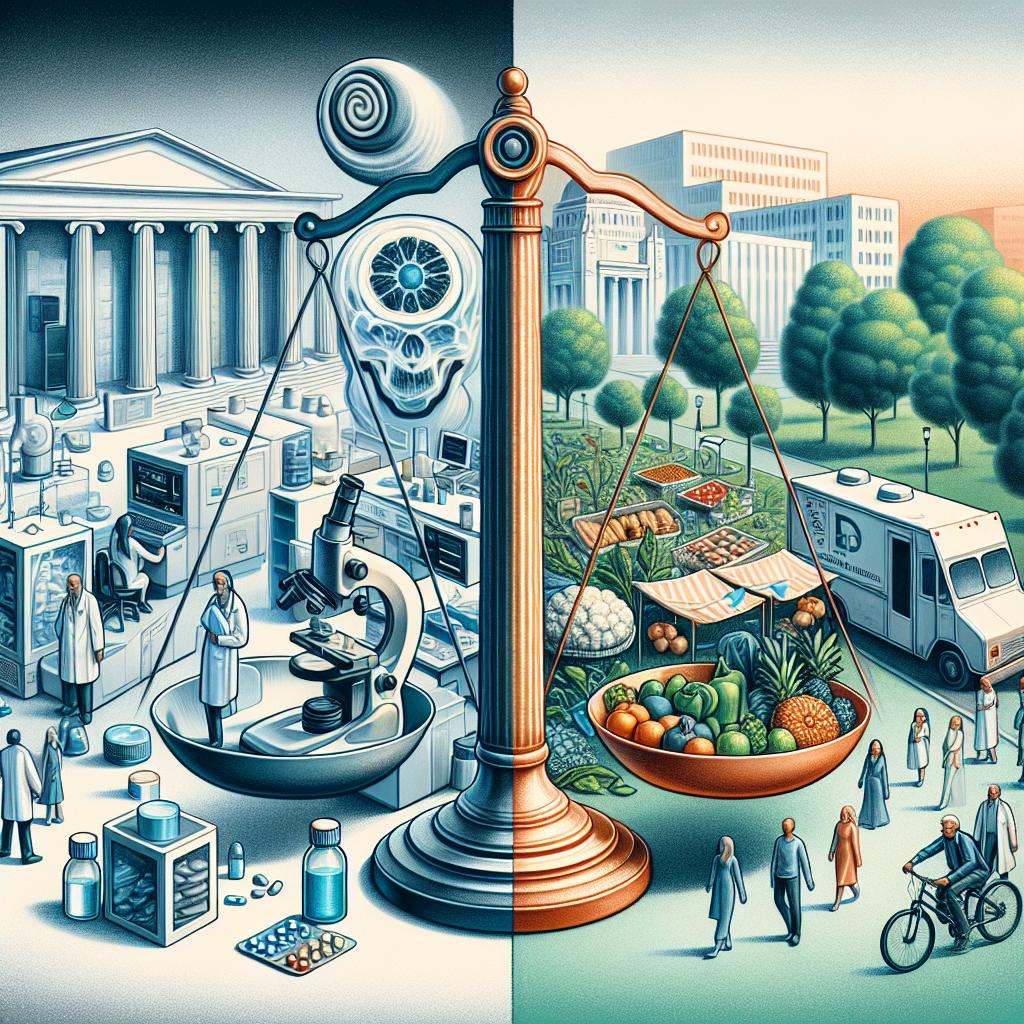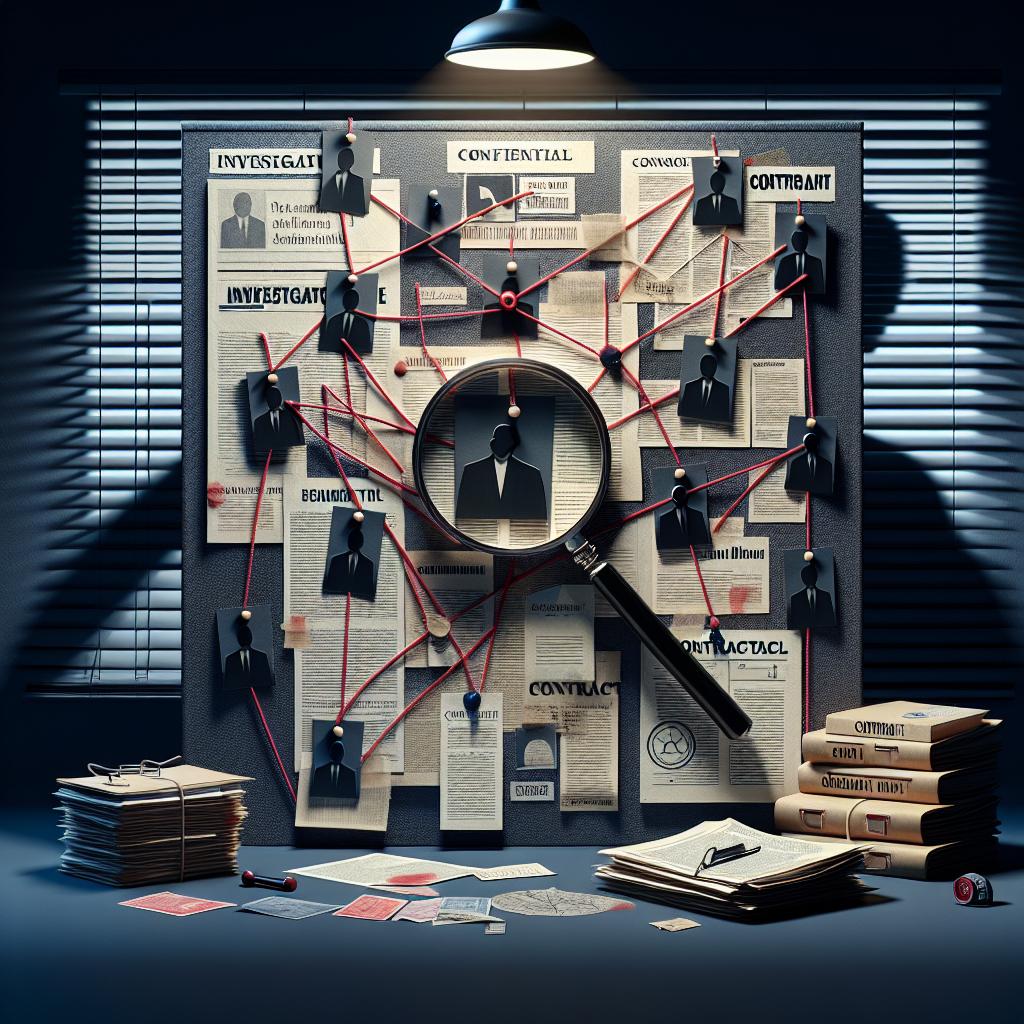Les trêves politiques estivales offrent un moment propice au recul et à la synthèse. Celle de 2025 a été particulièrement attendue après six mois de vie publique marqués par un rythme intense, au point que beaucoup d’observateurs ont souligné l’importance centrale de la présidence de Donald Trump dans le tempo politique international et national. À l’issue de cette période, plusieurs tendances commencent à se dégager, et l’une d’elles mérite une attention soutenue : la polarisation des démocraties entre elles-mêmes.
De la confrontation externe à la division interne
Pendant une grande partie du début du XXIe siècle, l’ordre politique mondial a souvent été décrit comme structuré par un affrontement entre démocraties et régimes autoritaires. Cette lecture reposait sur une cartographie relativement claire : des États fondés sur l’État de droit d’un côté, et des gouvernements illibéraux, autoritaires ou dictatoriaux de l’autre — souvent identifiés comme chinois, russe, iranien, turc ou indien.
Ce cadre classificatoire, même s’il reconnaissait l’érosion progressive de certains acquis démocratiques, permettait encore de distinguer des familles de régimes et d’en mesurer la dynamique. Ces distinctions semblent aujourd’hui en train de perdre de leur netteté : la ligne de fracture se déplace au sein même des démocraties, non plus exclusivement entre elles et leurs rivaux autoritaires.
Un « schisme démocratique » incarné par des trajectoires variées
Plusieurs événements récents illustrent cette mutation. La condamnation, en mars, de Marine Le Pen, reconnue coupable de détournement de fonds publics, a suscité des réactions politiques et sociales qui ont mis en lumière des désaccords profonds sur la nature de la justice et des institutions républicaines en France. De même, l’actualité politique italienne autour de la figure de Giorgia Meloni et, selon les sources évoquées dans le débat public, l’investiture du président polonais Karol Nawrocki, font partie d’un ensemble d’éléments signalant des inflexions dans les discours et les pratiques politiques.
Aux États-Unis, le clivage est particulièrement net et souvent pris comme référence pour décrire ce que certains nomment un « schisme démocratique » ou l’émergence de « démocraties parallèles ». D’un côté, le mouvement MAGA — pour « Make America Great Again » — défend une lecture de la souveraineté populaire où la volonté du peuple ne doit pas être entravée par des contre-pouvoirs. Cette sensibilité dénonce fréquemment ce qu’elle qualifie d’« État profond » et revendique une liberté d’expression très large, y compris face aux institutions indépendantes.
De l’autre, une lecture qualifiée de libérale insiste sur la nécessité de contre-pouvoirs effectifs, sur le respect de l’indépendance judiciaire, et sur la protection des droits individuels et des minorités. Dans ce schéma, la liberté d’expression est une valeur centrale, mais ses contours et ses limitations relèvent du droit et des institutions.
Ces deux modèles opposés n’existent pas en vase clos ; ils se rencontrent, se heurtent et se recomposent différemment selon les contextes nationaux. La confrontation porte autant sur des questions institutionnelles (indépendance de la justice, rôle des médias, séparation des pouvoirs) que sur des enjeux culturels et médiatiques (vie publique, discours sur l’« ennemi intérieur », interprétations de la souveraineté populaire).
Enjeux et perspectives
La polarisation interne des démocraties a des implications concrètes : elle peut affaiblir la confiance dans les institutions, radicaliser des pans entiers de l’opinion publique et rendre plus difficiles les compromis politiques. Elle soulève également la question de savoir si les cadres juridiques et constitutionnels existants sont suffisants pour gérer des désaccords qui portent moins sur des politiques publiques spécifiques que sur la légitimité même des règles du jeu démocratique.
Les réactions aux décisions judiciaires, les usages du pouvoir exécutif, et les campagnes électorales traversent désormais des registres où s’entremêlent la contestation des institutions et la mise en scène d’une représentation populaire sans médiation. Cette évolution n’est pas uniformément négative ou positive : elle reflète aussi des demandes de renouvellement de la vie publique. Mais elle pose la question de la capacité des démocraties à maintenir un même cadre normatif lorsqu’une part significative de leurs citoyens se reconnaît dans des visions opposées de ce cadre.
À l’heure où de nombreux dirigeants et électorats s’inscrivent dans des trajectoires diverses — recherches de légitimité directe, affirmation du rôle des institutions, restauration de l’ordre face à l’affaiblissement perçu des mécanismes de contrôle —, l’été 2025 offre surtout l’occasion de mesurer l’étendue et la profondeur de ces tensions.
La suite dépendra en grande partie des choix politiques et juridiques qui seront faits dans chaque pays, et de la capacité des sociétés civiles et des institutions à préserver l’espace du débat démocratique tout en garantissant l’application des règles communes. Pour l’heure, la ligne de fracture ne semble plus strictement externe : elle traverse les démocraties elles-mêmes, et invite à repenser ce que signifie gouverner et débattre au XXIe siècle.