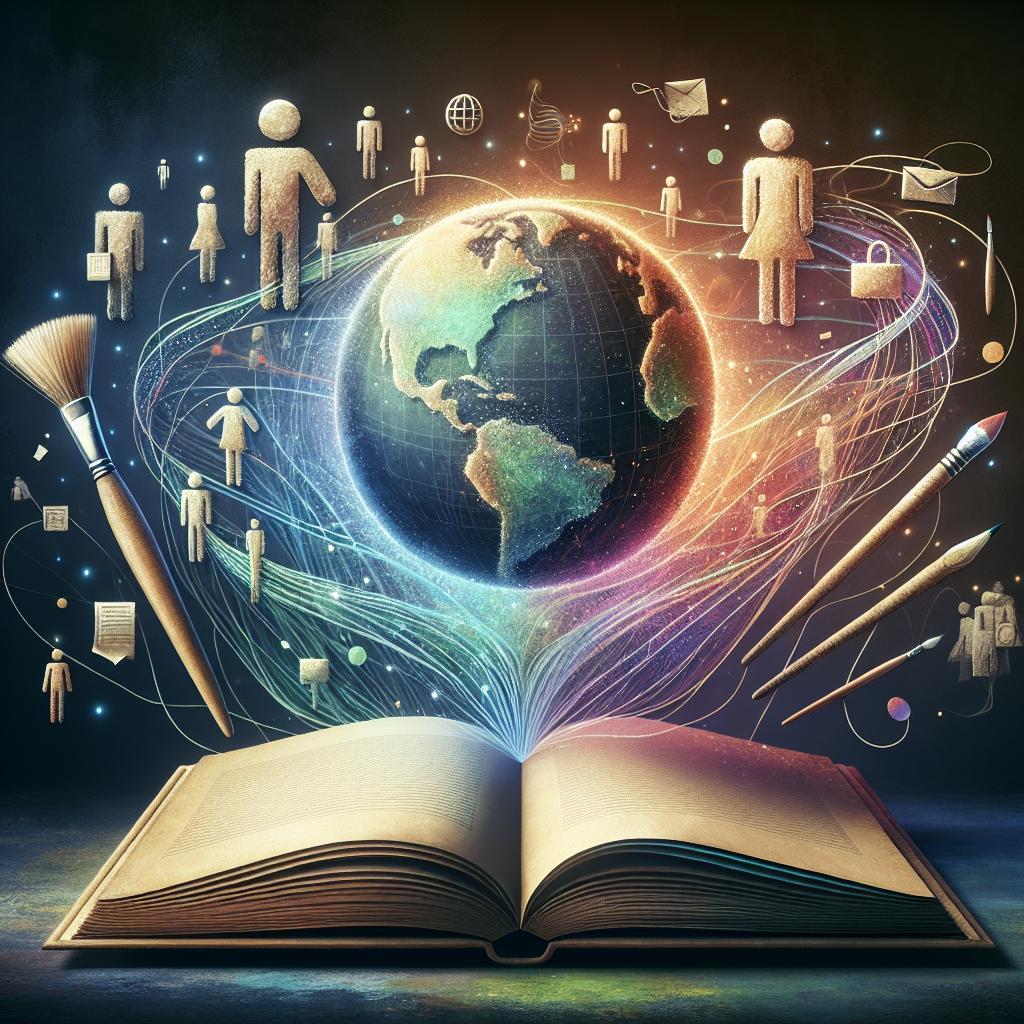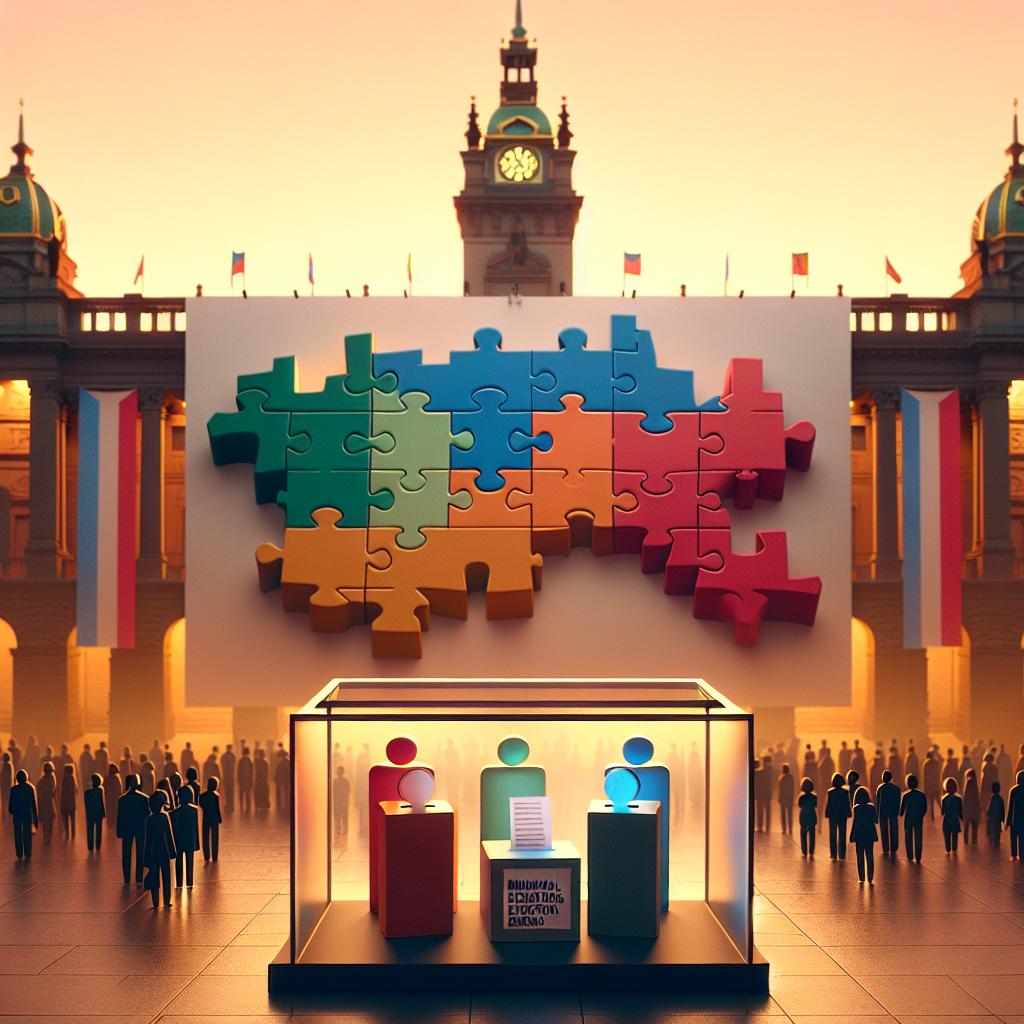Juillet 2024. Dans une cuisine, Cécile Duflot épluche des carottes. À quelques centaines de mètres de là, dans les coulisses des négociations entre les partis de gauche, son nom circule comme une solution possible pour incarner le gouvernement du Nouveau Front populaire. Elle, cependant, ignore que sa candidature est presque unanimement soutenue par plusieurs formations. Cette dissonance entre gestes quotidiens et tractations politiques résume la singularité de la période.
Un nom largement apprécié, mais pas unanime
Selon le récit d’un émissaire écologiste présent aux discussions, l’idée d’un rôle pour Cécile Duflot a séduit autant les écologistes que les socialistes et les communistes. « Mais les “insoumis” mettent leur véto », se remémore David Cormand, l’un des envoyés des Verts. Les oppositions exprimées venaient officiellement d’un lien supposé à l’ancien mandat ministériel de François Hollande et d’un rapprochement considéré comme trop marqué par certains acteurs.
Cormand rapporte toutefois une autre raison invoquée en privé : la perspective que ce poste ouvre un boulevard à une candidature présidentielle en 2027 pour Duflot. « Ils ne voulaient pas d’une concurrente », affirme-t-il. Cette remarque, placée au cœur des négociations, illustre la manière dont les enjeux personnels et les ambitions nationales peuvent peser sur des choix gouvernementaux qui, en apparence, relèvent de l’intérêt collectif.
Une posture publique distante
Interrogée par Le Monde à l’époque, Cécile Duflot se contente de déclarer qu’elle « ne fait plus de politique » et que seule l’ONG Oxfam, dont elle est la directrice générale pour la France, occupe désormais sa vie. Cette réponse publique contraste avec les propositions réelles qui lui ont été faites, et avec l’attention dont elle a fait l’objet dans les arcanes des partis.
Qualifier cette minimisation de « galéjade », comme le fait le texte d’origine, revient à noter l’écart entre sa parole publique et les sollicitations privées. Sans remettre en cause la sincérité de ses propos, il est pertinent d’observer que les acteurs politiques agissent parfois à la fois sur le plan des convictions et sur celui de la stratégie.
Propositions répétées et refus
Un mois avant juillet 2024, les écologistes avaient proposé à Cécile Duflot de se porter candidate dans la 5e circonscription de Paris. Cette circonscription était alors liée à Julien Bayou, récemment retiré de la vie politique. Duflot a décliné cette offre.
Par ailleurs, un an plus tôt, un petit groupe d’amis au sein du mouvement écologiste l’avait encouragée à se présenter aux élections européennes. Elle a longuement hésité. Dans la suite de ces échanges, elle a sondé son ancienne collaboratrice Marine Tondelier, devenue secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts, ainsi que David Cormand, pour jauger les appuis et les conditions d’un engagement réactivé.
Les écologistes n’étaient toutefois pas favorables à une liste de rassemblement portée par Duflot. Ils ont préféré faire cavalier seul et, pour marquer leur reconnaissance mais aussi leur préférence stratégique, ont proposé à l’ancienne ministre la quatrième place sur la liste. Cette proposition, jugée « vexante » dans le texte d’origine, résume le malaise : assez de reconnaissance pour l’inviter, mais pas assez pour lui confier la tête d’une liste commune.
Ce que révèle la séquence
La chronologie — encouragements, offres locales, puis proposition de place sur une liste nationale — montre une double réalité. D’une part, Cécile Duflot conserve une aura et un capital politique reconnus par une partie de la gauche. D’autre part, des considérations de stratégie interne, d’ego partisan et de calculs électoraux ont limité la traduction de cette aura en investiture.
Les éléments rapportés — citations de David Cormand, offres précises (5e circonscription de Paris, 4e place sur la liste) et la fonction actuelle de Duflot à Oxfam — sont préservés et replacés dans leur chronologie. Ils permettent de comprendre pourquoi un nom consensuel sur le papier n’a pas nécessairement débouché sur un engagement formel.
En l’état des informations disponibles dans le texte original, il reste délicat d’aller au-delà des témoignages et des refus mentionnés sans recourir à des sources supplémentaires. Reste que cette séquence illustre les arbitrages délicats qui président aux recompositions politiques : prestige personnel, calculs d’appareil et ambitions présidentielles se rencontrent souvent au moment de choisir qui représentera la gauche dans des fonctions exécutives.