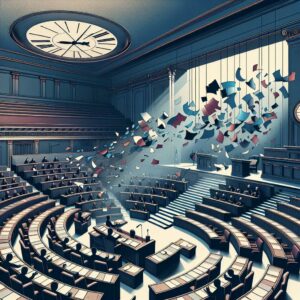Dans la presse anglophone, l’expression « lame ducks » — littéralement « canards boiteux » — a été utilisée ces derniers jours pour décrire le président français, perçu comme affaibli sur les scènes nationale et internationale. Le Times écrit sans détours : « C’est un canard boiteux, clopinant jusqu’à la fin de son mandat prévu en 2027, sans même être sûr de vivre assez longtemps pour le voir arriver à son terme ». L’agence Bloomberg ajoute : « Macron le canard boiteux est désormais également un canard assis [une proie facile] ».
Signification politique du terme
Dans le vocabulaire politique, « lame duck » désigne, au sens large, un élu qui demeure en fonction mais dont l’autorité et l’influence se sont nettement affaiblies. La métaphore ornithologique suggère un responsable « qui a laissé des plumes » : il conserve le titre, mais il a perdu une partie de ses leviers de décision et souvent la confiance d’une partie de l’opinion ou de partenaires internationaux.
Le mot est surtout ancré dans le bestiaire politique américain où il qualifie fréquemment un président à la fin de son mandat, en attente de son successeur. Pendant cette période, la capacité d’initiative du chef de l’État se trouve souvent réduite, tandis que des oppositions internes ou externes peuvent chercher à tirer parti de cette fragilité.
Exemples historiques et repères chronologiques
L’usage du terme remonte aux États-Unis au XIXe siècle. La période séparant une élection et l’investiture suivante est un moment classique de « lame duck ». Après l’élection présidentielle du 5 novembre 2024 et jusque l’investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025, Joe Biden a ainsi incarné la figure du « lame duck ». De même, lorsque Barack Obama a perdu la majorité au Congrès à mi‑mandat, en novembre 2014, il a été qualifié de « lame duck » dans le sens où ses marges de manœuvre législatives se sont réduites.
Le passé américain fournit également des exemples plus dramatiques. Entre l’élection d’Abraham Lincoln en novembre 1860 et son investiture en mars 1861, sept États du Sud ont fait sécession de l’Union. Le président sortant, James Buchanan (1791‑1868), avait choisi de ne pas s’opposer vigoureusement aux sécessionnistes, ce qui contribua à l’aggravation de la crise et, in fine, conduisit à la guerre de Sécession.
La période dite de « lame duck » reste donc politiquement périlleuse : des adversaires peuvent accélérer des initiatives, des décisions importantes peuvent être reportées, et la crédibilité internationale d’un État peut en pâtir.
Origines linguistiques et attestations
Sur le plan lexical, l’expression s’est implantée dans la langue politique américaine au cours du XIXe siècle. On trouve, selon certaines sources, une première occurrence attestée en 1926 ; cette datation mérite toutefois prudence et peut varier selon les corpus consultés. Le sens courant — celui d’un élu affaibli en fin de mandat ou privé de soutien majoritaire — s’est imposé ensuite dans les débats politiques et dans la presse internationale.
Transférée au contexte européen ou français, la locution conserve sa charge métaphorique mais peut recouvrir des réalités différentes : en régime parlementaire, la notion de « canard boiteux » peut s’appliquer à un gouvernement minoritaire, tandis qu’en régime présidentiel elle renvoie plus directement à la figure du chef de l’État en fin de mandat.
Conséquences et ambiguïtés
Être qualifié de « lame duck » n’implique pas nécessairement une incapacité totale d’agir. Selon les circonstances institutionnelles, un dirigeant affaibli peut encore prendre des décisions importantes, surtout sur des sujets exécutifs ou internationaux. En revanche, sa marge de manœuvre politique, sa capacité à négocier et son pouvoir d’influence restent souvent plus limités.
Enfin, l’emploi de l’expression dans la presse internationale relève parfois d’une stratégie rhétorique : elle synthétise une impression de vulnérabilité et facilite la lecture d’une situation politique complexe. Lorsque la qualification provient de titres influents, comme le Times ou Bloomberg, elle contribue à façonner la perception internationale du dirigeant visé — ici, le président français — sans toutefois constituer, en elle‑même, une évaluation objective et exhaustive de ses capacités à gouverner.