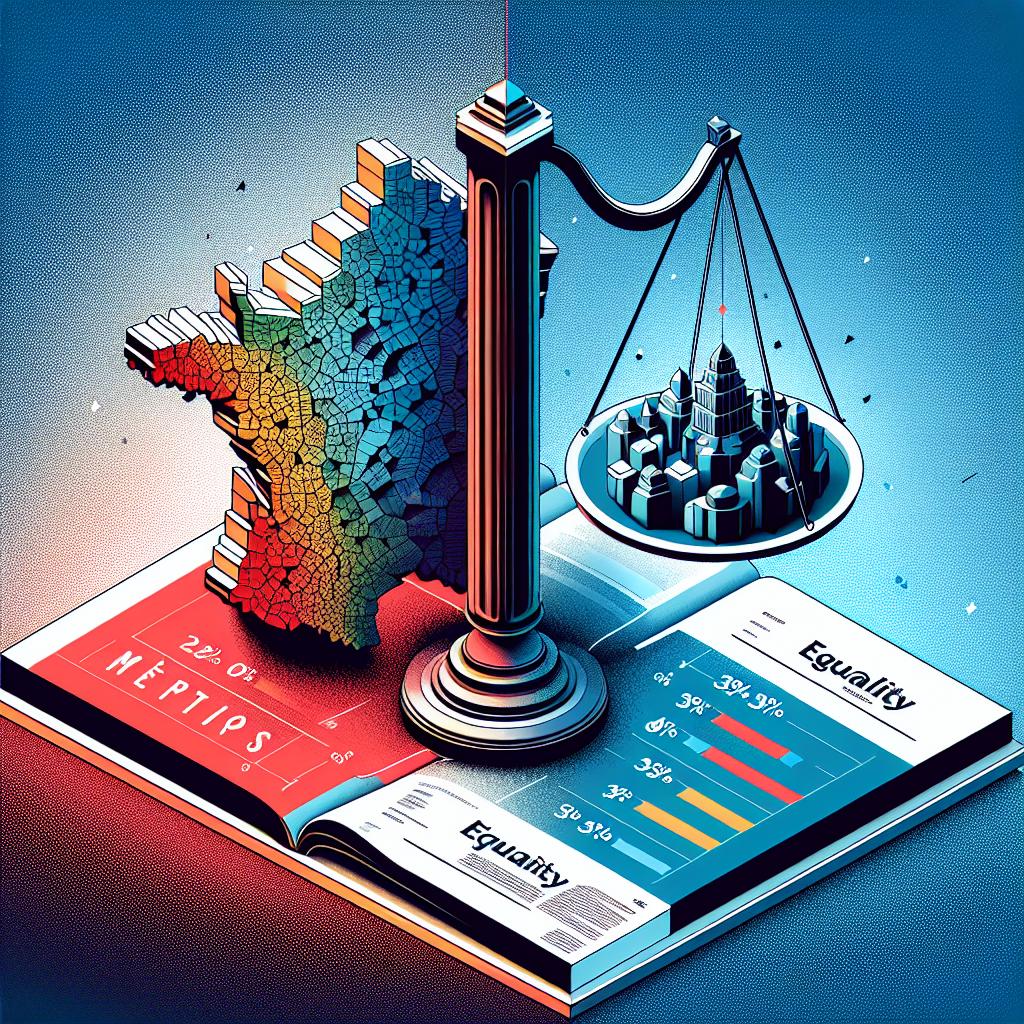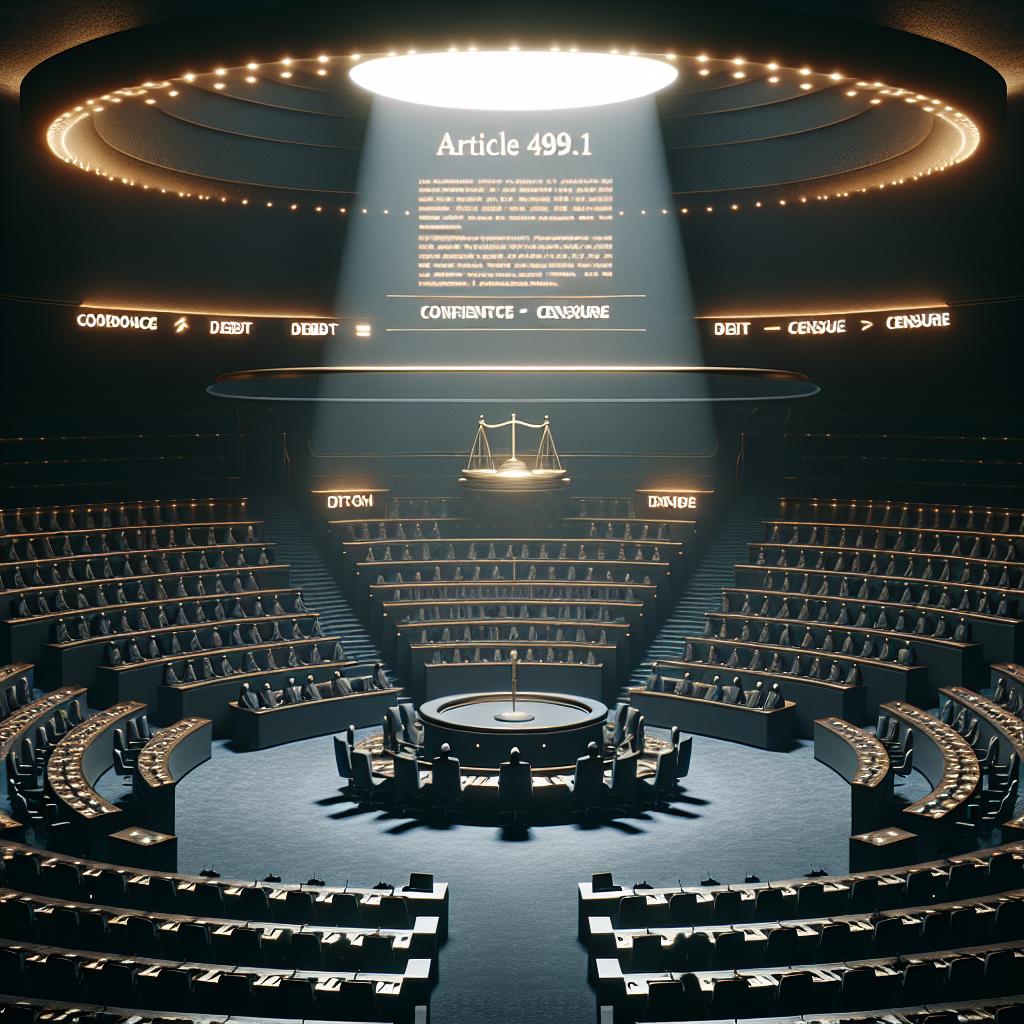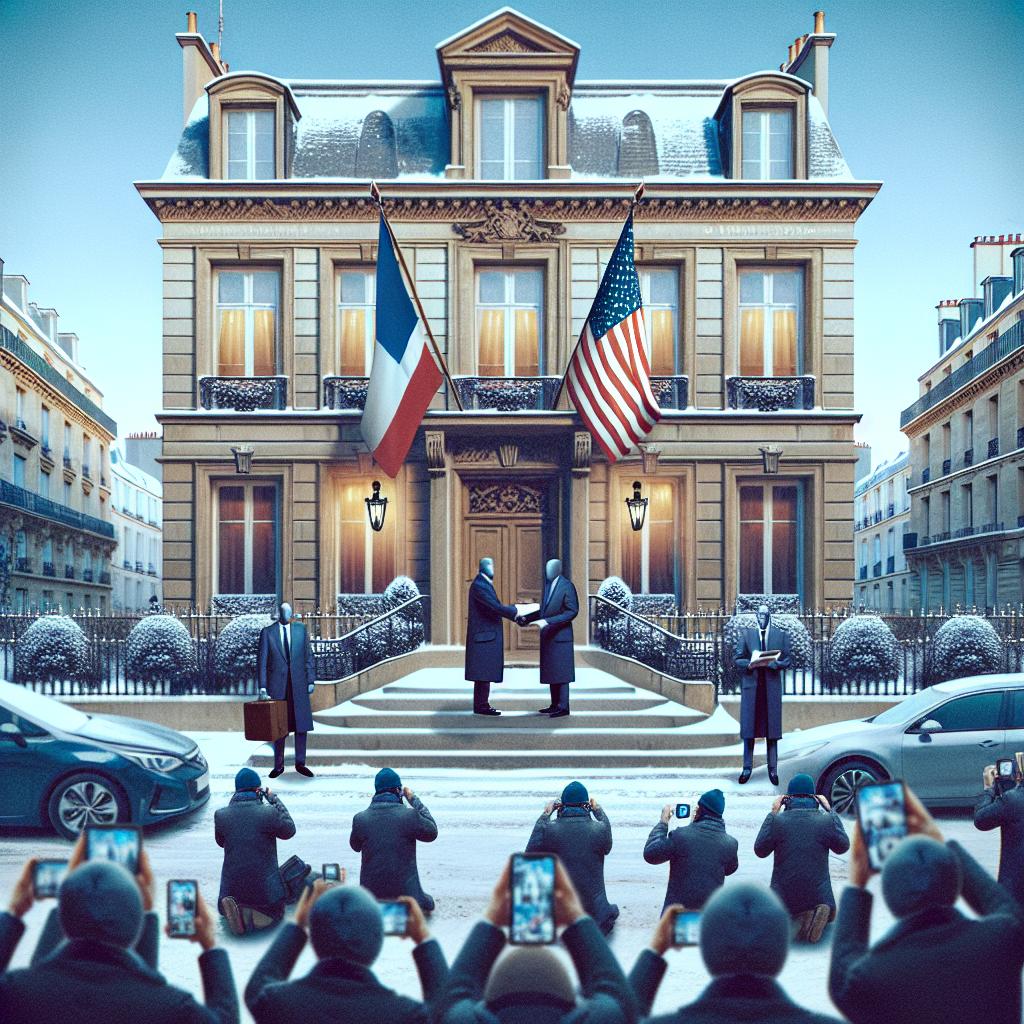En tant que juriste ultramarin, j’ai observé que des mots peuvent blesser autant que des lois. Le terme « métropole », encore employé dans de nombreux textes officiels, en est un exemple. Il participe, selon ses détracteurs, à une représentation hiérarchisée de la France qui place les territoires d’outre‑mer en marge, alors que la Constitution affirme une République « une et indivisible ».
Un vocabulaire qui heurte l’idéal républicain
La tension entre l’unité proclamée et le vocabulaire administratif mérite d’être posée clairement. Le Petit Robert définit « métropole » comme « le territoire d’un État par rapport à ses colonies », une entrée lexicale que certains jugent anachronique en 2025. Employer ce mot pour désigner la France continentale, écrivent-ils, prolonge une logique post‑coloniale en distinguant un centre et des périphéries au sein d’une même nation.
Ce débat n’est pas uniquement sémantique. Les mots construisent des représentations et peuvent contribuer à légitimer des pratiques. L’usage institutionnel d’un terme à connotation hiérarchique pose une question de cohérence entre le principe d’égalité et la réalité du langage public.
Des chiffres et des situations concrètes
Plusieurs études mettent en lumière des inégalités vécues par les populations ultramarines. Selon l’Observatoire des inégalités (2023), 32 % des personnes ultramarines déclarent avoir subi des discriminations, proportion qui atteint 33 % pour celles résidant en « métropole ». Par ailleurs, une enquête du Défenseur des droits (2019) indique que 40 % des ultramarins estiment être traités défavorablement dans l’accès aux services publics ou à l’emploi.
Ces chiffres s’accompagnent d’exemples concrets parfois évoqués dans les travaux et témoignages : refus de scolarisation, difficultés administratives répétées, ou obstacles dans les démarches professionnelles. Le langage officiel, quand il tend à séparer plutôt qu’à inclure, peut renforcer ces perceptions et leur donner une légitimité symbolique.
Comparaisons européennes : des choix terminologiques différents
La France n’est pas la seule à devoir penser la relation entre le territoire national et ses outre‑mers. Le Royaume‑Uni a modifié son vocabulaire dès 2002 en privilégiant l’expression « British Overseas Territories », traduisible par « territoires britanniques d’outre‑mer », formulation destinée à atténuer la connotation coloniale du terme « colonie ». L’Espagne qualifie les îles Canaries et les Baléares de « communautés autonomes », statut pleinement intégré au cadre constitutionnel espagnol.
Aux Pays‑Bas, une réorganisation institutionnelle entamée en 2010 a abouti à des statuts variés : Aruba et Curaçao sont désignés comme « pays autonomes » au sein du Royaume‑des‑Pays‑Bas, tandis que Bonaire occupe le statut de municipalité spéciale, sans référence explicite à une « mère‑patrie ». Ces exemples montrent que des choix lexicaux et statutaires différents existent et produisent des effets symboliques et juridiques distincts.
Remplacer « métropole » par « Hexagone » est présenté par certains comme une mesure symbolique visant à afficher l’égalité de tous les territoires français. Cette substitution linguistique vise d’abord à supprimer une connotation hiérarchique perçue et à renforcer l’idée d’une appartenance égalitaire à la République.
Un changement de vocabulaire demeure toutefois essentiellement symbolique s’il n’est pas accompagné d’analyses et d’actions sur les inégalités concrètes relevées par les enquêtes. Les mots importent ; ils participent à la construction des représentations et au climat institutionnel. Mais ils ne suffisent pas, à eux seuls, à corriger des discriminations identifiées par les organismes de mesure et contrôle.