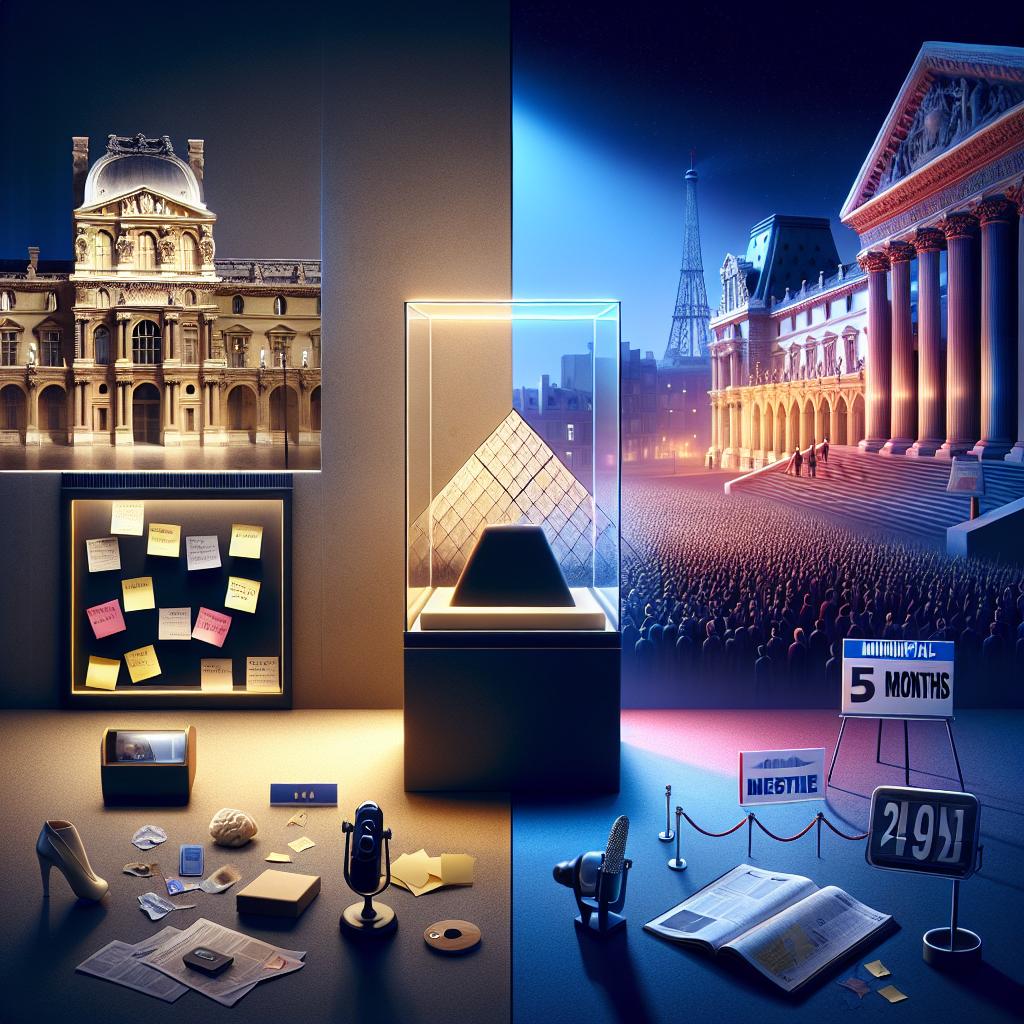Les partis politiques français jouissent aujourd’hui de prérogatives accrues, notamment après les élections législatives de 2022 et de 2024. Pourtant, leur image reste très dégradée : seulement 10 % des Français déclarent leur faire confiance, score le plus faible parmi les 20 institutions testées.
Un niveau de confiance historiquement bas
Le constat principal de la treizième vague de l’enquête « Fractures françaises » est net et quantifié. Avec 10 % de confiance, les partis se situent 58 points derrière les maires, et leur crédibilité a encore reculé par rapport à 2022, perdant 8 points.
Ce faible niveau de confiance contraste avec l’influence politique effective attribuée aux formations, renforcée par les scrutins législatifs récents. L’enquête souligne ainsi une disjonction entre le pouvoir institutionnel des partis et l’adhésion des citoyens à leur égard.
Une « extrême droitisation » des préférences partisanes
La treizième vague va au-delà d’une mesure abstraite de confiance et examine l’image de chaque parti. Interrogés sur le parti dont ils se sentent « le plus proche ou le moins éloigné », les Français désignent prioritairement le Rassemblement national (RN). Le RN apparaît nettement en tête, les autres formations se situant très loin derrière.
Cette configuration est résumée par les auteurs de l’enquête comme une « extrême droitisation » des préférences partisanes. L’analyse compare volontairement ces résultats à ceux recueillis cinq ans plus tôt, soit à 500 jours de la présidentielle de 2022, afin d’éclairer l’évolution du paysage politique à 500 jours du scrutin présidentiel de 2027.
Que mesure exactement cette enquête ?
La question posée aux répondants vise la proximité sentimentale à un parti — « le plus proche ou le moins éloigné » — et ne se confond pas automatiquement avec une intention de vote. Elle reflète davantage des ancrages, des perceptions et des affinités générales que des choix électoraux concrets.
En comparant deux moments identiques du cycle électoral (chaque fois à 500 jours du tour présidentiel), l’enquête offre un repère utile pour repérer des tendances structurelles. Elle montre notamment une concentration de la proximité partisane vers le RN, sans toutefois indiquer dans ce seul indicateur l’ampleur des reports de voix ou la dynamique des autres partis.
Limites et enseignements
Les résultats doivent être interprétés avec prudence. L’indicateur de « proximité » synthétise une perception qui peut varier selon le contexte médiatique, les campagnes, ou l’actualité. De plus, une faible confiance globale n’empêche pas une capacité des partis à peser sur les institutions, comme l’ont illustré les élections législatives de 2022 et 2024.
Le rapport ne prétend pas établir une causalité unique à l’origine de cette évolution. Il éclaire cependant un double phénomène : d’une part, une défiance marquée des Français envers leurs organisations partisanes ; d’autre part, un resserrement des préférences partisanes vers des positions situées à droite de l’échiquier, tel que mesuré par la proximité déclarée aux formations politiques.
Enfin, la comparaison avec la situation cinq ans plus tôt (500 jours avant la présidentielle de 2022) donne au diagnostic une dimension temporelle utile. Elle permet d’observer non seulement un niveau de confiance plus faible, mais aussi une recomposition de l’espace partisan telle qu’elle ressort des réponses aux mêmes questions posées à deux moments comparables du cycle politique.
En somme, la treizième vague de « Fractures françaises » dresse le portrait d’un système partisan puissant institutionnellement, mais fragilisé face à l’opinion publique. À 500 jours de l’élection présidentielle de 2027, ce paysage met en évidence une polarisation marquée des proximités partisanes, avec le Rassemblement national comme point de référence dominant dans les réponses recueillies.