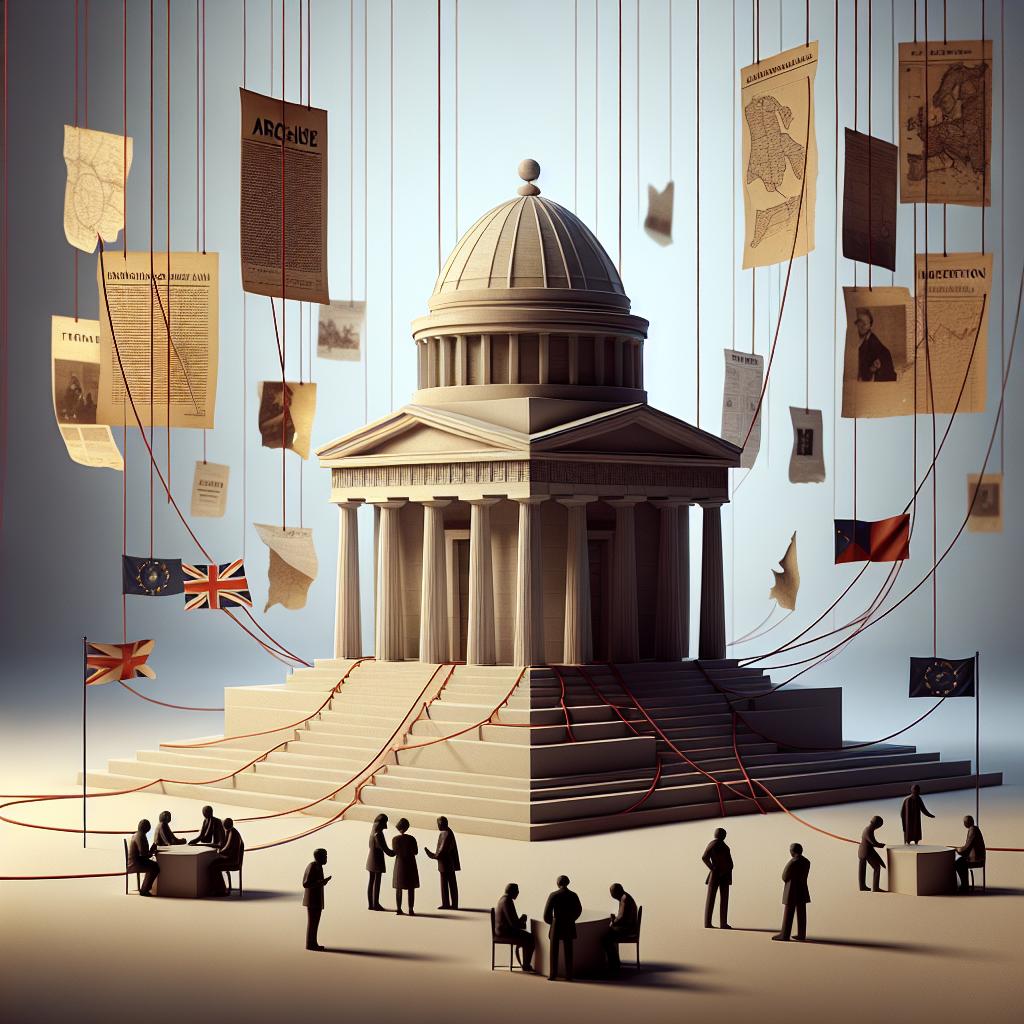En 2025, l’image du président Emmanuel Macron en train de boxer, biceps tendu et veines saillantes, a circulé sur le compte Instagram de la photographe de l’Élysée, attirant l’attention sur la mise en scène de son physique. Cet été, le même compte a publié des images de lui courant au pied des Rocheuses, en amont du G7, puis une photo le montrant pensif dans l’avion du retour, la main à l’épaule et le biceps droit mis en évidence.
La mise en scène du corps en politique
Le spectacle du corps n’est pas nouveau, mais il a pris une place plus visible dans la communication politique récente. « Entre 2017 et 2025, le président a cherché à passer ‘du corps maigre qu’on associe aux énarques, aux élites bureaucratiques de la République, à un corps musclé, symbole de masculinité hégémonique’ », observe François Hourmant, professeur à l’université d’Angers et auteur de Pouvoir et beauté. Le tabou du physique en politique (PUF, 2021).
Le phénomène dépasse l’Élysée. Jordan Bardella, figure montante du Rassemblement national, reconnaît avoir changé de taille de costume grâce à la pratique sportive régulière. Louis Sarkozy, identifié par certains médias comme proche des accents trumpistes, s’est montré torse nu dans une vidéo de ju-jitsu brésilien diffusée par le site du Figaro. Le sénateur communiste Ian Brossat, pour sa part, partage avec la presse des images de ses séances dans une salle Fitness Park.
Ces exemples montrent que la quête d’une image corporelle travaillée traverse l’échiquier politique, depuis la droite jusqu’à la gauche. Les formes varient — affichage de discipline sportive, photos de détente ou de « défis » physiques — mais l’intention est souvent comparable : donner à voir une vigueur qui complète ou remplace d’autres attributs politiques.
Le muscle comme réponse aux incertitudes
Plusieurs observateurs relient cette mise en valeur du corps à un contexte d’incertitude sociale et géopolitique. « Derrière l’attrait du muscle, il y a cette idée simpliste qu’on gagnera un débat avec une claque ou un coup plutôt qu’avec son esprit, ce qui est pourtant la tradition française depuis les Lumières », analyse Guillaume Vallet, professeur à l’université Grenoble-Alpes et auteur de La Fabrique du muscle (L’Echappée, 2022).
Pour certains responsables, le développement d’une image musclée fonctionne comme une valeur refuge : elle renvoie une image de maîtrise, de vitalité et d’autorité face à des publics inquiets. Le message est double : il s’adresse aux adversaires politiques, mais aussi à des électeurs qui associent force physique et capacité à protéger ou décider.
Cette logique montre combien l’esthétique et la performativité corporelle sont devenues des instruments de communication politique, au même titre que les discours et les programmes. L’image encodée par une photo peut parfois produire un effet immédiat plus puissant que la démonstration argumentée.
Entre stratégie et symbolique
La diffusion de photographies sportives ou viriles n’est pas dépourvue de calcul. François Hourmant note que la diffusion de l’image de Macron en train de boxer a été interprétée par certains comme une réponse symbolique à Vladimir Poutine. La publication intervenait alors qu’Emmanuel Macron faisait l’objet de campagnes de trolls russes, après avoir évoqué la possibilité d’un envoi de troupes occidentales en Ukraine ; l’ancien président russe Dmitri Medvedev était allé jusqu’à le qualifier de « trouillard zoologique » avant le déplacement du président français à Kiev.
Ces coïncidences de calendrier alimentent les lectures politiques : pour une partie de l’opinion et des analystes, la mise en scène du corps devient un moyen de répondre, par l’image, à des attaques extérieures ou à des mises en cause de la crédibilité.
Reste que l’usage politique du corps soulève des questions sur la nature du leadership et la place accordée à l’apparence dans le jugement public. Les gestes, les tenues et les postures viennent désormais compléter — parfois remplacer — la rhétorique traditionnelle, transformant le corps en surface de communication au même titre que les mots.
La tendance observée ne permet pas d’en tirer des conclusions définitives sur ses effets électoraux ou sociaux. Elle illustre en revanche une évolution nette des codes politiques : la performance physique se dépouille peu à peu de son statut privé pour s’afficher comme un élément calculé de la stratégie publique.