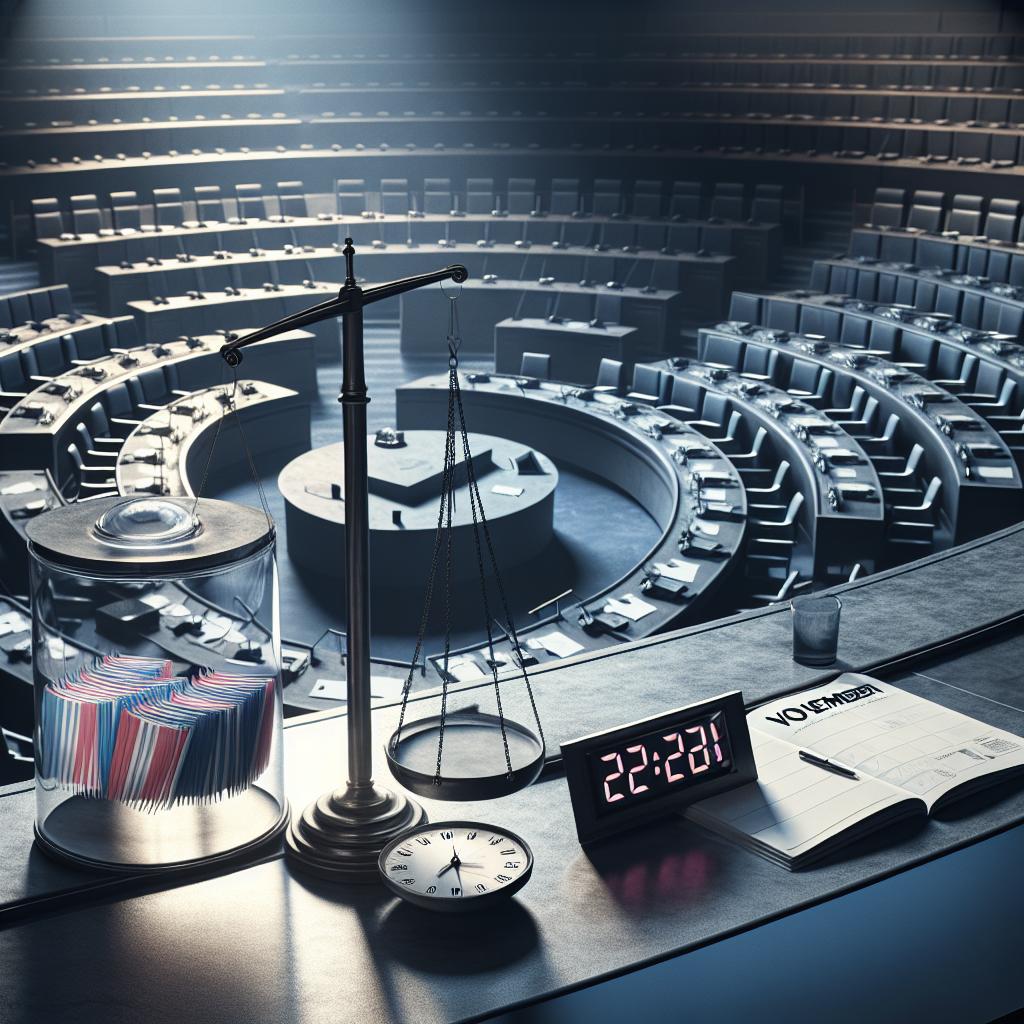Depuis plusieurs années, une partie des experts et des élus préconise de rompre l’impasse politique française par l’adoption de la représentation proportionnelle. Ce mode de scrutin est majoritaire au sein de l’Union européenne, mais la France lui oppose depuis longtemps le scrutin majoritaire instauré avec le suffrage universel masculin en 1848.
Un choix historique et ses rares exceptions
Le scrutin majoritaire a dominé l’attribution des sièges à l’Assemblée nationale pendant plus d’un siècle. À l’exception de quelques parenthèses proportionnelles — 1870-1875, 1885-1889, 1919-1927, 1946-1951 et 1986-1988 — les députés du Palais-Bourbon sont élus selon la règle du candidat arrivé en tête au second tour.
Pour beaucoup d’observateurs, ce système a une vertu connue : il favorise l’émergence de majorités stables. Il confère une « prime » aux vainqueurs et facilite, historiquement, la constitution de majorités absolues à l’Assemblée nationale.
Critiques : une représentation des minorités insuffisante
Mais ce mode de scrutin présente un inconvénient majeur : il sous-représente très largement les minorités. Dès 1894, le journaliste et historien Henri Avenel (1853-1908) a montré, dans un opuscule illustré de graphiques, que près des trois cinquièmes du corps électoral pouvaient se retrouver privés de tout représentant à la Chambre des députés.
Cette critique est reprise par des spécialistes contemporains. Bastien François, professeur de science politique à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, résume ainsi le problème : le scrutin majoritaire est un « instrument de réduction du pluralisme qui condamne la représentation nationale à être sans prise sur la société ».
Autrement dit, le mécanisme favorise la concentration des voix en faveur d’une majorité parlementaire, au prix d’une faible prise en compte des divers courants politiques présents dans l’électorat.
La proportionnelle : principe et promesse
À l’opposé, la représentation proportionnelle vise à faire de l’Assemblée un « miroir » de la nation. Plutôt que d’isoler un seul vainqueur par circonscription, ce système répartit les sièges en fonction du nombre de suffrages obtenus par chacune des listes.
L’objectif affiché est simple : réduire l’écart entre pourcentage de voix et pourcentage de sièges, afin que les différentes sensibilités politiques disposent d’une présence parlementaire proportionnelle à leur audience électorale.
Variantes et modalités de mise en œuvre
Il existe de nombreuses variantes de la proportionnelle. Certaines prévoient une prime majoritaire pour favoriser la gouvernabilité ; d’autres utilisent des méthodes de calcul différentes, comme le « plus fort reste » ou la « plus forte moyenne ». D’autres encore autorisent le panachage, c’est‑à‑dire le choix de candidats issus de listes différentes.
Ces options influent directement sur la composition finale de l’Assemblée : elles peuvent tempérer la fragmentation partisane ou, au contraire, accroître la diversité des groupes parlementaires. Le linguiste Raoul de La Grasserie écrivait en 1896 que la proportionnelle cherchait à faire de l’Assemblée le « calque du pays à une échelle réduite » ; cette formule résume bien l’ambition du système.
Le débat politique français se concentre donc sur un arbitrage classique : assurer une représentation fidèle des suffrages ou préserver les majorités stables que produit le scrutin majoritaire.
Les partisans de la proportionnelle insistent sur la justice représentative et la pluralité des opinions. Les défenseurs du système majoritaire mettent en avant la clarté des responsabilités et la capacité à dégager une majorité gouvernante.
Au‑delà des arguments théoriques, la question renvoie à des choix institutionnels concrets : seuils d’accès, mode de calcul des sièges, découpage territorial et éventuelle prime majoritaire. Chacune de ces options a des effets mesurables sur la distribution des sièges et sur la dynamique des partis.