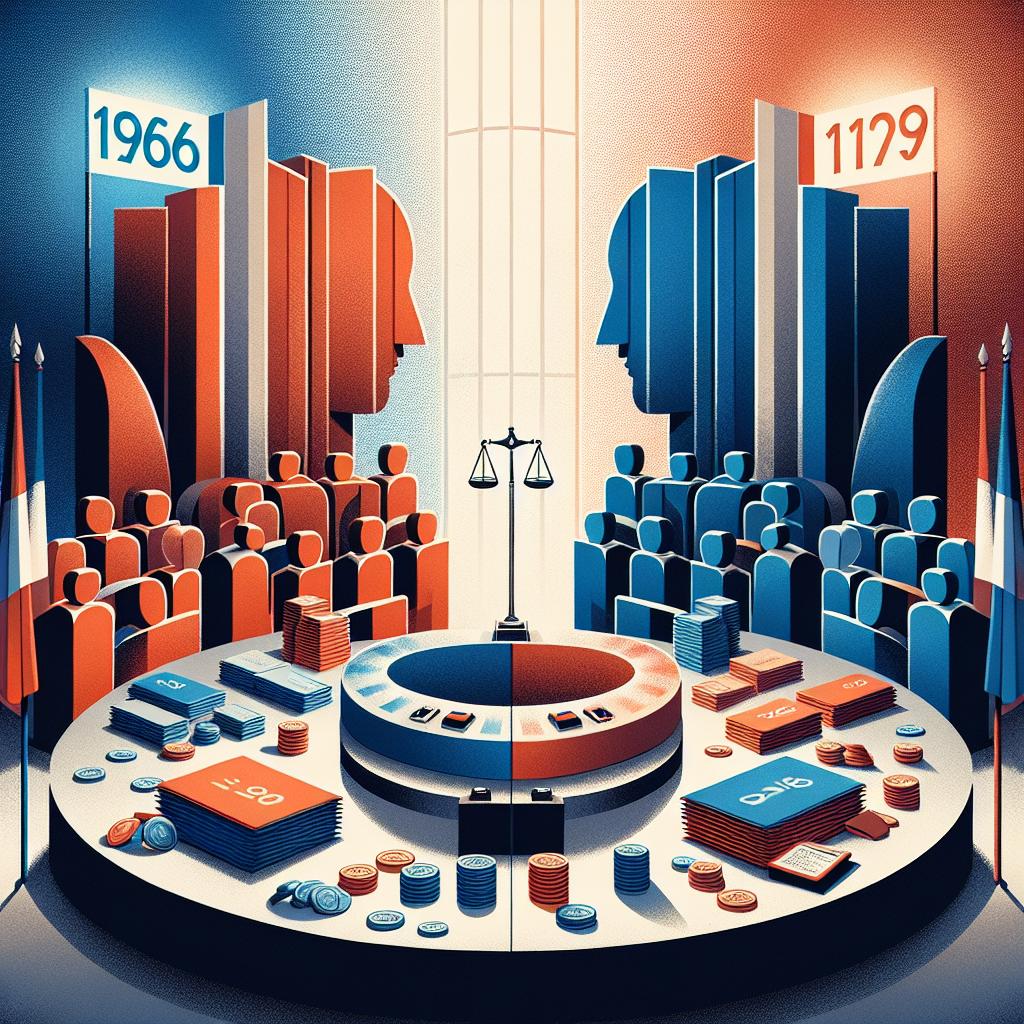« Messieurs, je vous invite à vous taire. Le plan de la bataille a été tracé. Le commandant est désigné. C’est à lui de conduire l’action. » Ces mots, attribués à Louis XV au moment de la bataille de Fontenoy en 1745, servent d’antécédent historique à un débat contemporain sur le rôle et la parole des militaires en France.
Un propos militaire qui relance la controverse
Le contraste entre la France d’autrefois et celle d’aujourd’hui est net : la République n’est pas en guerre, mais ses forces armées se préparent à des scénarios de haute intensité définis par les autorités politiques. C’est dans ce cadre que les propos du chef d’état-major des armées, le général Mandon, prononcés mardi 18 novembre, ont suscité une vive réaction politique.
Le général a évoqué, selon les comptes rendus, un manque de « force d’âme » et le risque que le pays ne soit « pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement ». Ces formulations ont été perçues par plusieurs responsables politiques comme problématiques sur la forme et lourdes de sens sur le fond. Les réactions sont venues de formations aussi diverses que La France insoumise et le Rassemblement national, qui ont critiqué la tonalité et l’opportunité de ces déclarations.
Contexte stratégique et cadre légal
Sur le fond, l’intervention du chef d’état-major s’inscrit dans la continuité de décisions récemment prises par le Parlement et l’exécutif. La loi de programmation militaire votée en 2023 et la nouvelle Revue nationale stratégique, publiée le 14 juillet, ont toutes deux placé au centre de l’effort de défense la possibilité d’un conflit majeur en Europe.
Ces documents prennent acte, écrivent-ils, d’une « dégradation de l’environnement sécuritaire » et retiennent comme hypothèse centrale une « guerre majeure de haute intensité ». La Russie y est explicitement désignée comme une menace majeure pour les intérêts français et pour ceux des alliés de la France. En conséquence, les autorités prévoient non seulement un engagement militaire possible pour défendre le flanc est de l’Union européenne, mais aussi une préparation matérielle et morale de la nation face à ce type de choc.
Le chef d’état-major, en rappelant ces hypothèses, semble avoir voulu insister sur l’ampleur de l’effort requis. Mais ses termes ont fait débat parce qu’ils touchent à la sensibilité nationale et au principe constitutionnel de subordination de l’armée au pouvoir civil. Dans les textes officiels, l’idée n’est pas de revendiquer une autonomie décisionnelle des militaires, mais de rendre lisible l’éventail des besoins — équipement, formation, préparation psychologique — qu’une perspective de haute intensité implique.
Un débat politique aux lignes de fracture identifiables
Depuis 2022, le paysage politique français est marqué par une division claire sur la manière de répondre à la guerre en Ukraine. D’un côté, certains plaident pour une sortie rapide du conflit par la négociation, privilégiant le désarmement et des garanties de sécurité mutuelles. De l’autre, des forces politiques estiment que toute forme d’apaisement serait complaisante envers la Russie et qu’il faut maintenir, voire renforcer, l’aide à l’Ukraine.
Les propos du général Mandon sont lus différemment selon ces lignes de fracture. Pour ses détracteurs, ils sonnent comme un discours inapproprié voire alarmiste. Pour ses partisans, ils constituent un rappel nécessaire des réalités stratégiques énoncées par les lois et revues officielles. Dans les deux cas, la question revient : quelle place pour la parole militaire dans un débat politique sensible ?
Plusieurs élus ont pointé la nécessité de clarifier ce que peuvent dire les chefs militaires sans empiéter sur le domaine régalien du politique. D’autres ont appelé à ne pas dépolitiser un questionnement stratégique légitime, qui implique des arbitrages budgétaires, des choix industriels et des initiatives de préparation collective.
Au-delà des querelles de forme, le cœur du débat renvoie à des enjeux concrets : combien d’hommes et de moyens consacrer à la défense, comment articuler soutien aux alliés et protection du territoire national, et quelle préparation psychologique et sociale demander aux citoyens en cas d’épreuve majeure.
Le rappel historique à la bataille de Fontenoy, cité en ouverture, illustre la tentation de renvoyer aux exemples du passé pour légitimer des prises de parole actuelles. Mais la République reste gouvernée par des institutions contemporaines et des lois votées par des parlementaires. Le débat lancé par les mots du général Mandon montre simplement que, lorsque la logique stratégique entre en résonance avec les sensibilités démocratiques, les contours de la responsabilité publique et de la parole institutionnelle doivent être explorés avec précaution et clarté.