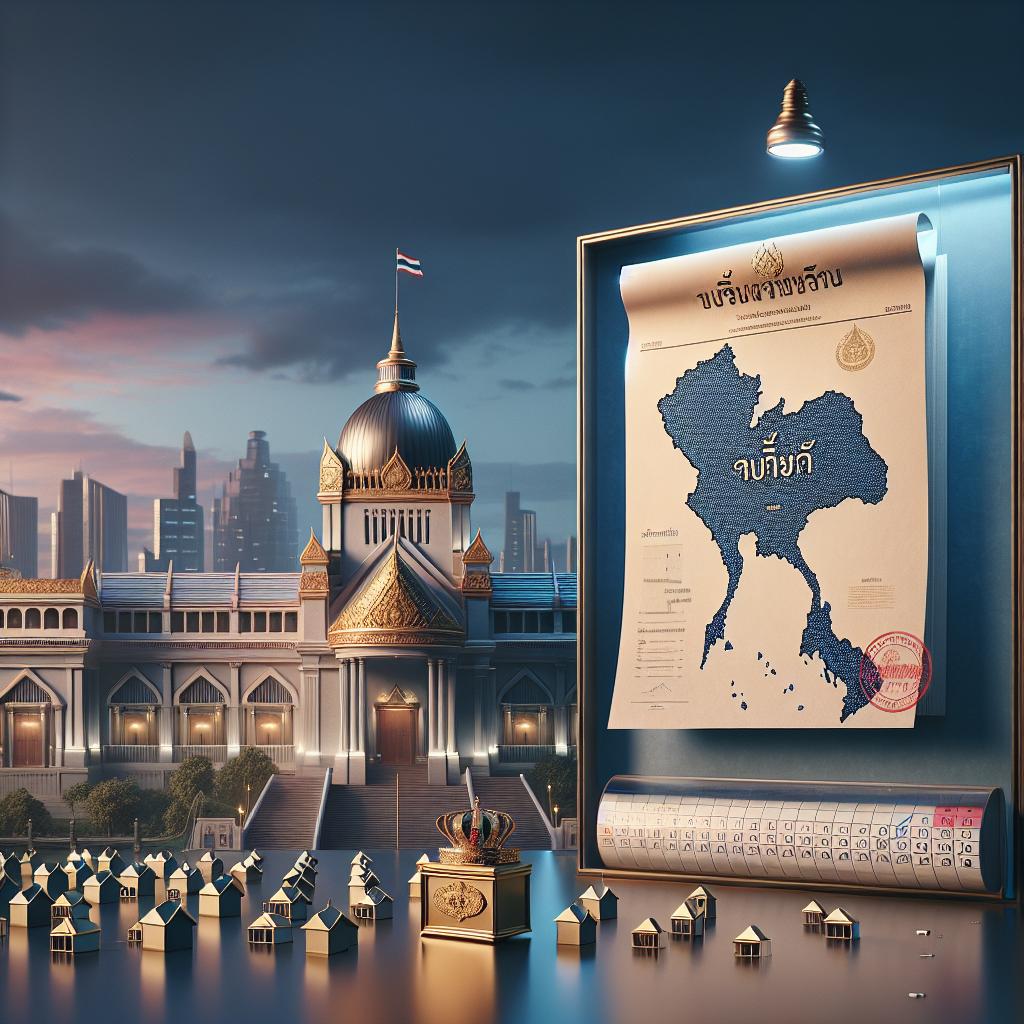Trois collègues et amis d’Alban Bensa (1948-2021) ont tenu la promesse qu’ils lui avaient faite : porter à publication L’Enquêteur enquêté, un recueil qui rassemble 26 textes et prolonge la réflexion du grand anthropologue. Le volume, dense et exigeant, mêle articles choisis par Bensa lui‑même et contributions retenues a posteriori par Thierry Bonnot, Antonella Di Trani et Claude Grin après des discussions qu’ils décrivent comme longues et argumentées.
Genèse et intention intellectuelle
Conçu comme une suite à La Fin de l’exotisme (Anarcharsis, 2006), L’Enquêteur enquêté se présente comme la poursuite d’une ambition claire : « la volonté d’affirmer les fondements d’une façon authentique de faire de l’anthropologie », écrivent en préface ses trois héritiers intellectuels. Le corpus rassemble 26 textes, dont certains avaient déjà été choisis par Bensa ; les autres ont été sélectionnés collectivement après sa disparition.
Le geste éditorial est donc à la fois commémoratif et critique. Il vise à restituer une pensée ancrée dans la pratique du terrain, tout en proposant une lecture organisée et discutée des travaux laissés par l’auteur. Les éditeurs insistent sur le caractère réfléchi du choix des pièces : loin d’une simple compilation, l’ouvrage résulte d’un travail de tri et d’argumentation, que l’on imagine fidèle à l’esprit des débats que Bensa aimait mener.
Une méthode inscrite dans le réel
L’ouvrage est traversé par la méthode qui a fait la réputation d’Alban Bensa. Sa posture tient d’abord à un apprentissage linguistique et culturel approfondi : dès 1973, il apprend le paicî, que l’on qualifie dans le livre de l’une des 28 langues de l’archipel. Cet apprentissage n’est pas présenté comme un simple outil ; il est décrit comme « une épreuve » nécessaire pour pénétrer « l’entre‑soi kanak » et saisir les manières propres de formuler le monde.
Sur le plan méthodologique, Bensa reprend et met en pratique les conseils de son professeur, le linguiste André‑Georges Haudricourt (1911-1996). La maxime rapportée au livre est limpide : « Avant de faire des hypothèses sur la façon dont les gens pensent, encore fallait-il comprendre ce qu’ils disent et ce qu’ils font. » Cette injonction oriente toute l’approche de Bensa : d’abord écouter et observer, puis construire des hypothèses à partir de matériaux concrets.
L’ethnographe met un accent particulier sur ce qu’il appelle « les traces matérielles tangibles de l’activité humaine » — c’est‑à‑dire ce que l’on voit, entend ou touche sur le terrain. L’intérêt se porte ainsi sur les objets, les pratiques visibles, et leur mise en relation avec des cadres historiques et événementiels. Inscrit dans le réel, son travail refuse l’abstraction détachée des faits observés.
Le temps long comme principe d’enquête
Autre dimension majeure de son travail : la durée. Bensa conduit son enquête sur un temps long — très long — puisqu’il suit les mêmes lieux et les mêmes interlocuteurs pendant quarante ans. Cette permanence lui permet de documenter les évolutions, de noter les ruptures et de comprendre les continuités dans la vie sociale.
Il ironise lui‑même sur cette constance en parlant d’« antitourisme » : une manière de souligner que son travail n’a rien à voir avec des visites superficielles et ponctuelles. Au contraire, il s’agit d’un investissement patient qui cherche à rendre compte des transformations locales à travers l’expérience vécue des populations étudiées.
Portée et réception implicite
Le recueil se lit comme l’affirmation continue d’une anthropologie engagée dans ses méthodes et exigeante dans ses analyses. Les contributions réunies rappellent la cohérence d’un parcours intellectuel, fondé sur la langue, le matériau tangible et la durée. Elles manifestent aussi une rigueur critique : l’ouvrage est présenté comme dense, critique et exigeant, sans concession aux facilités analytiques.
Que l’on considère les textes choisis par Bensa ou ceux retenus après sa mort, le volume offre un panorama des manières dont il a compris et pratiqué le terrain. Il invite le lecteur à évaluer, à partir d’exemples concrets, comment se construit une connaissance anthropologique ancrée et vérifiable.
En définitive, L’Enquêteur enquêté apparaît comme un testament intellectuel et une ressource méthodologique. Par le soin apporté à la sélection des textes et par la répétition des thèmes méthodologiques — apprentissage linguistique, matérialité des traces, durée de l’enquête — l’ouvrage restitue la singularité d’une anthropologie attentive au concret et fidèle à une exigence éthique et scientifique.