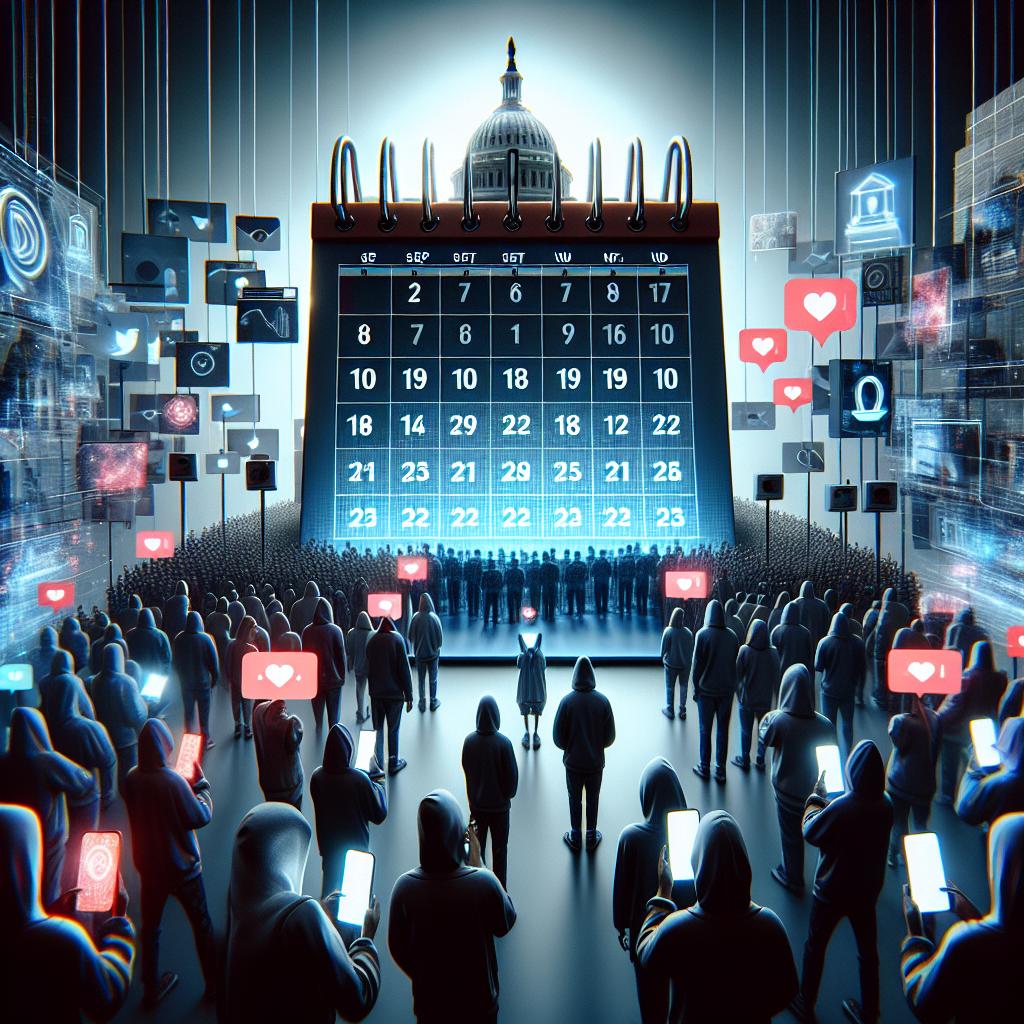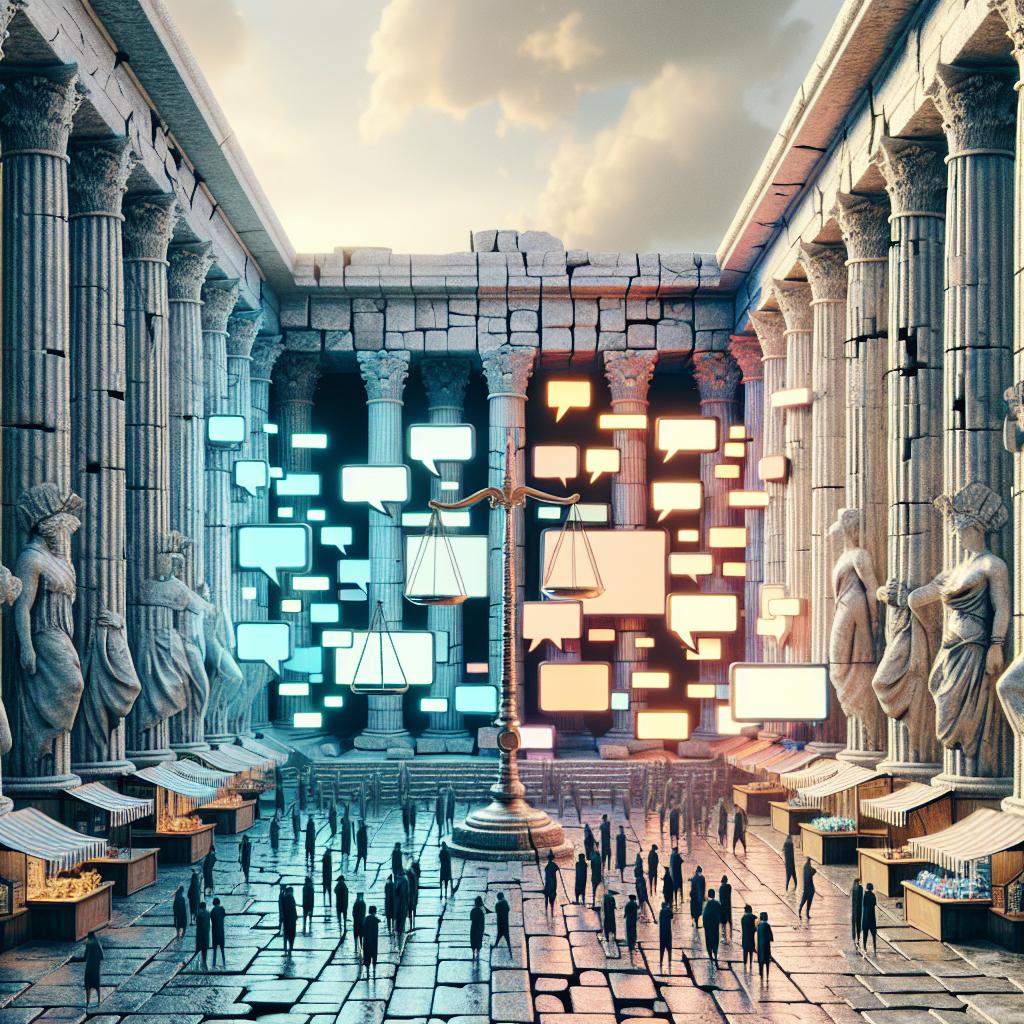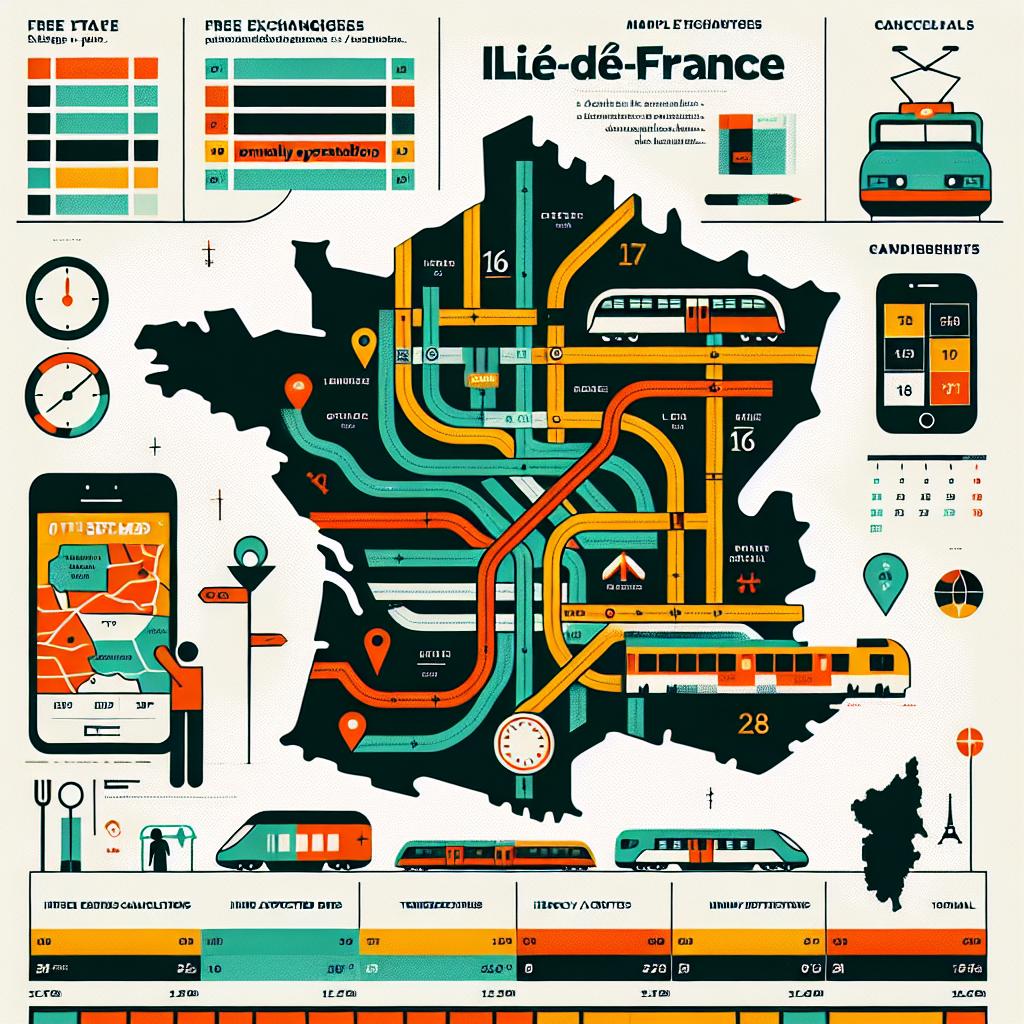Contexte politique et mobilisation annoncée
La probable chute, le 8 septembre, du gouvernement de François Bayrou, qui a décidé de solliciter un vote de confiance au Parlement, n’a pas découragé les organisateurs du mouvement du 10 septembre, qui entendent « tout bloquer » ce jour‑là. La convocation d’un scrutin de confiance n’a pas modifié la détermination affichée par certains responsables politiques et collectifs citoyens, pour qui la date du 10 reste un moment symbolique de pression.
La menace d’une « grève générale » brandie par Jean‑Luc Mélenchon apparaît dans ce contexte comme une tentative de donner un horizon d’action aux forces qui veulent amplifier la contestation. Cette formulation renvoie à des pratiques syndicales et politiques anciennes, mais ici elle se superpose à des modalités d’action citoyennes récentes, marquées par la dimension numérique et la viralité des appels.
Un mouvement atypique dans une chronologie courte
Interrogée sur la nature de cette mobilisation, Marion Fontaine, historienne des socialismes et du mouvement ouvrier et professeure au Centre d’histoire de Sciences Po, invite à la prudence. « Il faut rester prudent, car ce mouvement est encore dans les limbes et ses formes sont confuses. Pour l’instant, il existe surtout dans les anticipations des acteurs politiques ou syndicaux. »
Selon elle, le mouvement s’inscrit plutôt dans une chronologie récente, dont le point de départ se situe dans les années 2000. Il rejoint une série de mobilisations citoyennes émergées au tournant du siècle : les « indignés », Nuit debout, les « gilets jaunes ». Ces expériences ont en commun d’avoir utilisé les réseaux sociaux pour coordonner actions et communications, et d’avoir parfois bousculé les formes traditionnelles de l’action collective.
En arrière‑plan, poursuit Marion Fontaine, la réforme des retraites et l’échec des grandes mobilisations syndicales de 2024 pèsent sur la situation. Ces mobilisations n’ont pas obtenu le retrait de la réforme, ce qui nourrit le sentiment, chez certains groupes, d’une impuissance des formes classiques de la contestation et explique le recours à des appels plus larges et plus diffus.
Formes et limites de l’action
Le caractère « confus » évoqué par l’historienne renvoie à plusieurs réalités : la dispersion des initiateurs, l’absence d’une direction unifiée et la simultanéité de registres d’action — syndicaux, politiques et citoyens. Ce mélange rend difficile l’évaluation de l’ampleur réelle du mouvement avant la date annoncée.
Historiquement, les grèves générales et les grandes journées d’action ont nécessité une forte organisation syndicale et des relais institutionnels. Ici, la coordination s’opère largement en ligne, ce qui peut accélérer la diffusion des appels mais fragilise en retour la structuration et la prise de décision centralisée. Les formes d’auto‑organisation rencontrées depuis les années 2000 montrent que la viralité n’équivaut pas automatiquement à une capacité effective de blocage.
Enjeux et perspectives
Deux enjeux apparaissent au premier plan. Le premier est politique : transformer une mobilisation ponctuelle en pression durable capable d’influer sur une majorité parlementaire demande des relais concrets et une stratégie cohérente. Le second est social : convaincre des acteurs économiques et des salariés de participer à une journée de blocage nécessite des motifs perçus comme légitimes et des modes d’action réalisables.
Marion Fontaine souligne que, pour l’instant, « il existe surtout dans les anticipations des acteurs politiques ou syndicaux ». Cette remarque invite à distinguer l’intensité médiatique — forte dès lors que des personnalités publiques s’emparent du sujet — de l’intensité réelle sur le terrain. La suite dépendra de la capacité des différents acteurs à transformer un appel diffus en actes coordonnés.
À court terme, l’issue dépendra aussi de l’évolution de la situation politique et parlementaire autour du vote de confiance du 8 septembre et de la réaction des organisations syndicales et des collectifs citoyens au lendemain de ce scrutin. Sur le fond, le mouvement du 10 s’inscrit dans une séquence marquée par l’irritation face aux réformes et par la recherche de nouvelles formes d’expression collective dans l’espace public.
Sans préjuger du résultat, l’interrogation reste la même : cette mobilisation permettra‑t‑elle d’appuyer un renversement politique ou restera‑t‑elle une expression ponctuelle d’exaspération ? L’historienne rappelle que les formes et les calendriers de l’action collective ont évolué — mais que la conversion de la visibilité en capacité de transformation demeure un défi ancien.