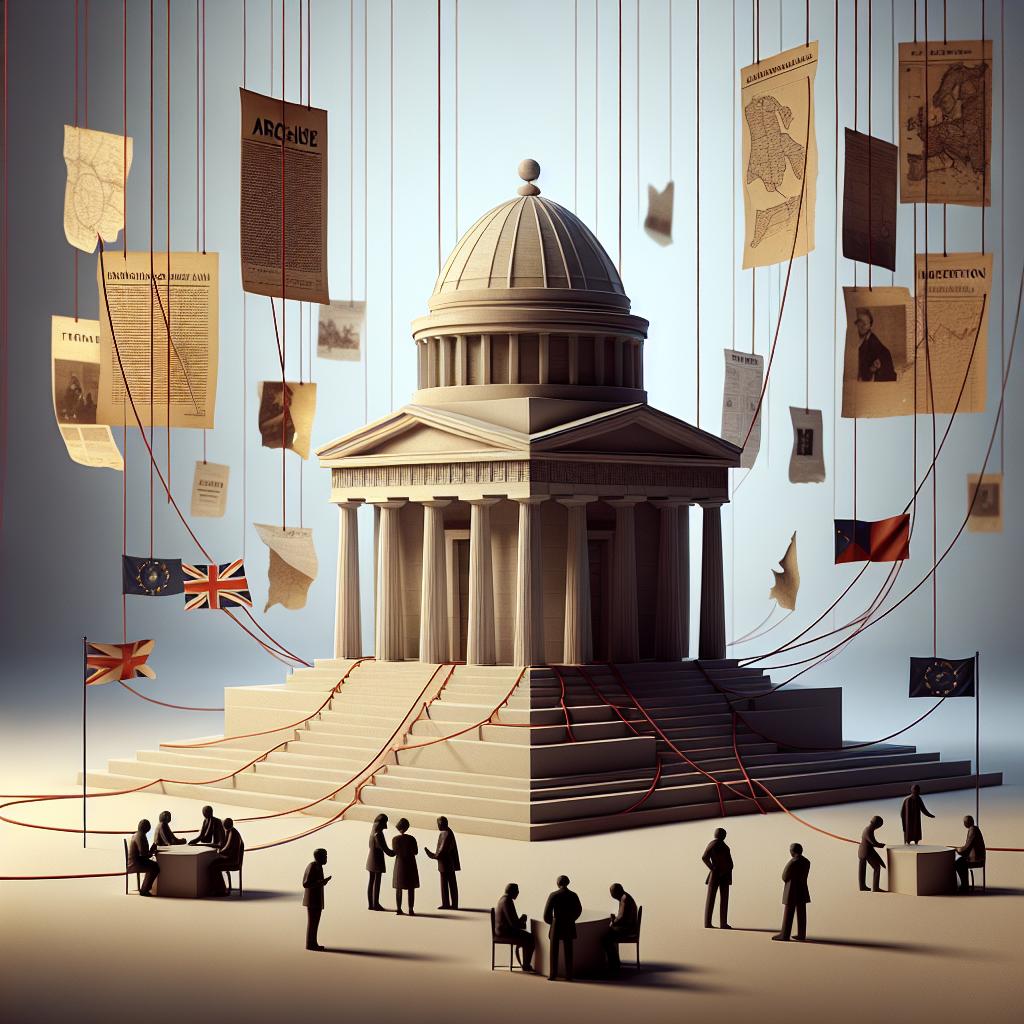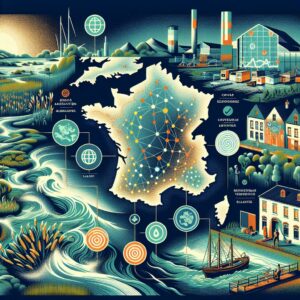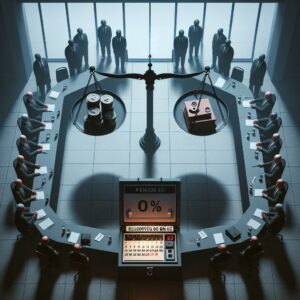La question de la mémoire publique ne relève plus seulement du souvenir : elle s’impose aujourd’hui comme un enjeu politique et social central, tant en France qu’à l’échelle internationale. Les opérations de commémoration se multiplient et se teintent parfois d’instrumentalisation, tandis que les atteintes aux droits et aux valeurs démocratiques s’accumulent ailleurs. Cette simultanéité interroge le sens et l’efficacité du devoir de mémoire, pris entre la tentation de la sacralisation et le risque de sa banalisation.
Panthéonisations et tensions nationales
Les récentes panthéonisations illustrent ce dilemme. Après celle du résistant apatride Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, et avant celle annoncée de l’historien Marc Bloch, le 9 octobre a été consacrée l’entrée au Panthéon de l’avocat Robert Badinter, connu pour avoir convaincu l’opinion publique et les responsables politiques de l’abolition de la peine de mort.
Le numéro 133 de la revue Questions internationales consacre un dossier — « Le passé kidnappé ? Histoire et mémoire(s) dans les relations internationales » — dans lequel l’historien Patrick Garcia rappelle que la commémoration reste d’abord un instrument politique au service d’un récit national. Le dossier souligne, entre autres éléments, que six entrées au Panthéon sont prévues en huit ans, en comptant celle, en juin 2026, de l’auteur de L’Etrange défaite (Franc-Tireur, 1946). Selon cette lecture, la multiplication des hommages officiels n’entraîne pas nécessairement une adhésion populaire plus forte ni un regain de cohésion sociale.
Le paradoxe se manifeste aussi dans des symboles contradictoires : la profanation, quelques heures avant une entrée au Panthéon, de la tombe d’un acteur de la dépénalisation de l’homosexualité en 1982 rappelle que les rancœurs et les divisions internes persistent, malgré les gestes commémoratifs. Ces incidents indiquent que la cérémonie, même largement relayée, ne suffit pas à apaiser des tensions profondes au sein de la société.
Le passé comme arme à l’étranger
La tentative de confisquer l’histoire n’est pas l’apanage des politiques nationales. À l’international, l’historien Alexandre Sumpf analyse les usages stratégiques du passé par Vladimir Poutine. Selon lui, la réécriture et l’exaltation d’un récit historique servent d’outils pour renforcer la cohésion interne de la Russie et légitimer certaines politiques extérieures.
Dans cette perspective, le récit glorifiant le rôle russe pendant la Seconde Guerre mondiale se double d’une stratégie visant à remettre en cause l’autonomie des pays voisins. Sumpf met en avant deux effets complémentaires : d’une part, une consolidation de l’identité nationale russe ; d’autre part, une opération de vassalisation qui provoque, en retour, des vagues de nationalisme antirusse en Ukraine, en Pologne et dans les États baltes.
Ce déplacement du débat historique vers un terrain géopolitique illustre comment le passé peut être instrumentalisé pour servir des objectifs stratégiques contemporains. Dans ce cadre, la mémoire cesse d’être uniquement un mécanisme de réparation ou de transmission ; elle devient un levier de pouvoir et de compétition internationale.
Entre sacralisation et banalisation
La problématique qui émerge des analyses évoquées par Questions internationales tient à cet arbitrage : comment préserver la dignité des commémorations sans les réduire à des rituels creux ou à des outils de légitimation politique ? L’excès de célébrations officielles peut conduire à la sacralisation des figures et des événements, les isolant du débat critique. À l’inverse, leur multiplication sans pédagogie ni lien social risque d’entraîner une banalisation, un effet d’usure qui affaiblit l’impact mémoriel.
Pour les historiens cités, la réponse n’est pas dans la seule répétition des hommages, mais dans la qualité du travail de transmission : contextualisation, pluralité des récits et ouverture au débat public. Sans ces éléments, la commémoration reste vulnérable aux usages partisans et à l’instrumentalisation, tant sur le plan intérieur qu’international.
Au final, la mémoire publique apparaît moins comme un remède que comme un champ de bataille symbolique. Les gestes officiels — panthéonisations ou commémorations — comptent, mais leur portée dépend de la capacité des sociétés à les intégrer dans un effort de compréhension critique, susceptible de rassembler plutôt que de diviser.