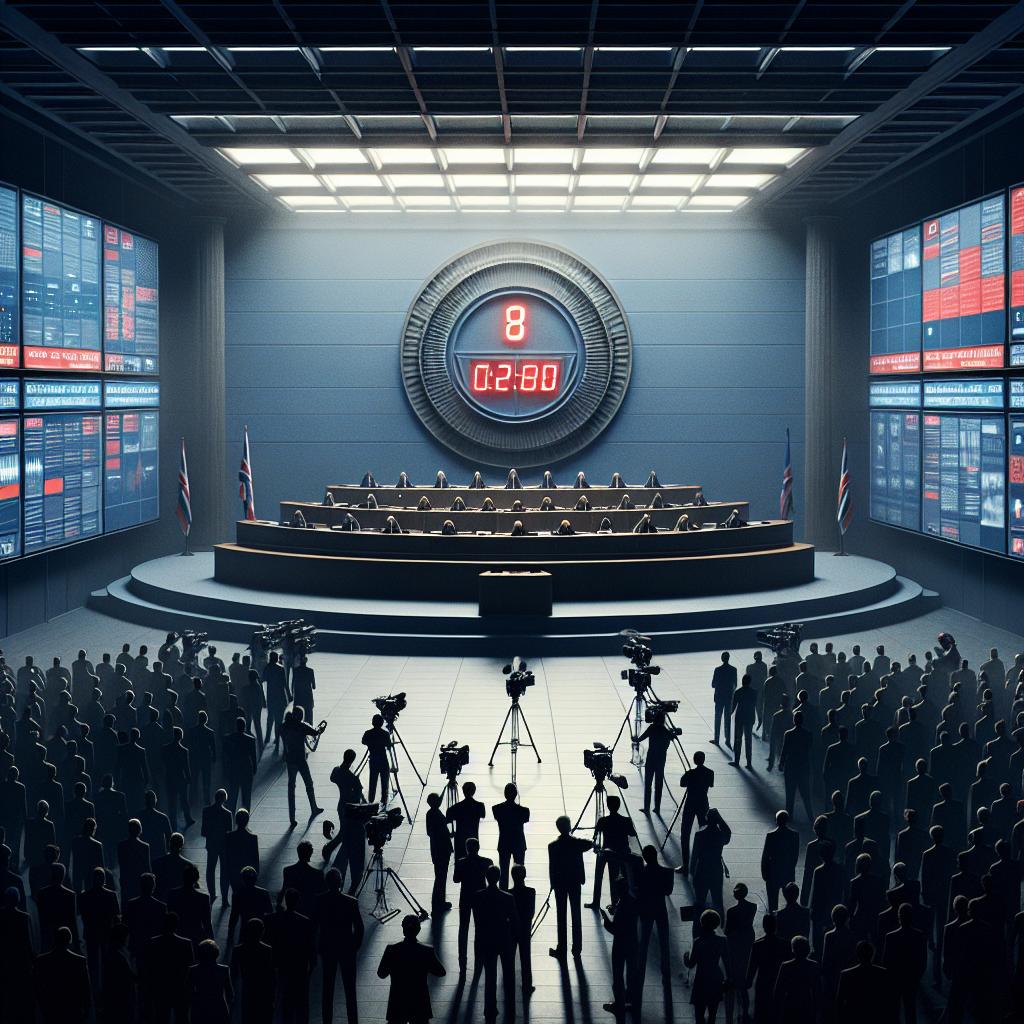Alexandre Douguine est présenté depuis plusieurs années comme la référence intellectuelle la plus radicale de l’extrême droite russe et européenne. Sa pensée, qualifiée d’ultranationaliste et liée à l’« eurasisme », a été, selon divers observateurs, reçue un temps au sein de cercles proches du Kremlin.
Rencontre symbolique à Moscou, le 27 octobre 2014
Ce lundi 27 octobre 2014, à Moscou, Jean‑Marie Le Pen — fondateur du Front national (FN), renommé en 2018 Rassemblement national (RN) — s’est rendu auprès d’Alexandre Douguine. La rencontre a eu lieu au Ritz‑Carlton, où un petit groupe de fidèles s’était réuni pour le recevoir.
La visite de l’ancien dirigeant du FN a été rapportée comme un geste fortement symbolique : elle illustre la porosité, à l’époque, entre certains réseaux nationalistes européens et des intellectuels russes jugés influents au plan idéologique.
Théories et influence : l’« eurasisme » et l’argumentaire géopolitique
Les théories de Douguine s’articulent autour du concept d’« eurasisme », une doctrine qui situe Moscou comme pivot civilisationnel face à l’Occident moderne. Les éléments souvent évoqués par cet idéologue — la notion de « troisième Rome » pour Moscou, la référence au « IIIe Reich » et à la « IIIe Internationale » — visent, selon lui, à fédérer des forces dans ce qu’il appelle une révolte contre le monde moderne. La formule suivante lui est attribuée : « La troisième Rome [Moscou, selon l’idéologue] , le IIIe Reich et la IIIe Internationale sont des éléments qu’il faut connecter dans la révolte contre le monde moderne. »
Plusieurs analystes ont estimé que ces éléments doctrinaux ont alimenté une rhétorique et des orientations politiques au sein de cercles de pouvoir russes, fournissant ainsi un vernis « intellectualiste » à certaines stratégies extérieures, notamment en Ukraine. Le degré exact et la nature précise de l’influence restent sujets à interprétation selon les sources et les périodes.
Présences inattendues et réseaux transnationaux
Au sein du groupe qui a accueilli Jean‑Marie Le Pen s’est glissé un homme présenté comme Patrice Hubert. Agé d’environ quarante ans et portant une coiffure décrite comme blonde crantée en arrière, il est identifié comme « directeur de la stratégie commerciale de Kellogg’s en Russie ». Le texte d’origine indique qu’il agit « en sous‑marin pour le FN dans la capitale russe », parfois sous le pseudonyme de « Patrice Michel », et qu’il serait actif dans ce rôle depuis 2011.
La présence de figures issues du monde économique ou d’acteurs moins visibles à côté de personnalités politiques souligne la manière dont réseaux, entreprises et militants peuvent se retrouver mêlés à des dispositifs de relations internationales informelles. Là encore, l’exacte nature des actions et l’ampleur de ces connexions relèvent d’enquêtes et de recoupements.
La réunion de 2014 montre aussi que les échanges entre responsables nationalistes européens et intellectuels russes n’étaient pas seulement discursifs : ils se traduisent parfois par des rencontres publiques ou semi‑privées, susceptibles d’alimenter des relais politiques et médiatiques.
Ce que dit le récit et ce qu’il faut conserver
Le récit rapporté conserve des éléments factuels précis : la date (27 octobre 2014), le lieu (Moscou, Ritz‑Carlton), les protagonistes nommés (Alexandre Douguine, Jean‑Marie Le Pen) et des descriptions personnelles (présence de Patrice Hubert, son rôle annoncé chez Kellogg’s en Russie et l’usage d’un pseudonyme). Ces éléments permettent de reconstituer un épisode concret, sans toutefois, à partir de ces seuls éléments, établir l’ensemble des implications politiques ou juridiques.
Il importe, dans l’analyse de telles rencontres, de distinguer le constat des hypothèses d’interprétation. Le texte d’origine évoque une influence intellectuelle de Douguine sur certaines orientations russes et signale la proximité de personnalités françaises avec cet univers. Ces constats rendent compte d’un phénomène documenté, tout en laissant ouvertes les questions sur l’intensité et la nature exacte des liens entre idées, acteurs et politiques étatiques.
Enfin, conservant la neutralité, on note que le Front national est mentionné avec sa date de renommée : en 2018, le FN a pris le nom de Rassemblement national (RN). Cette précision chronologique permet de situer les faits rapportés par rapport à l’évolution des structures partisanes en France.