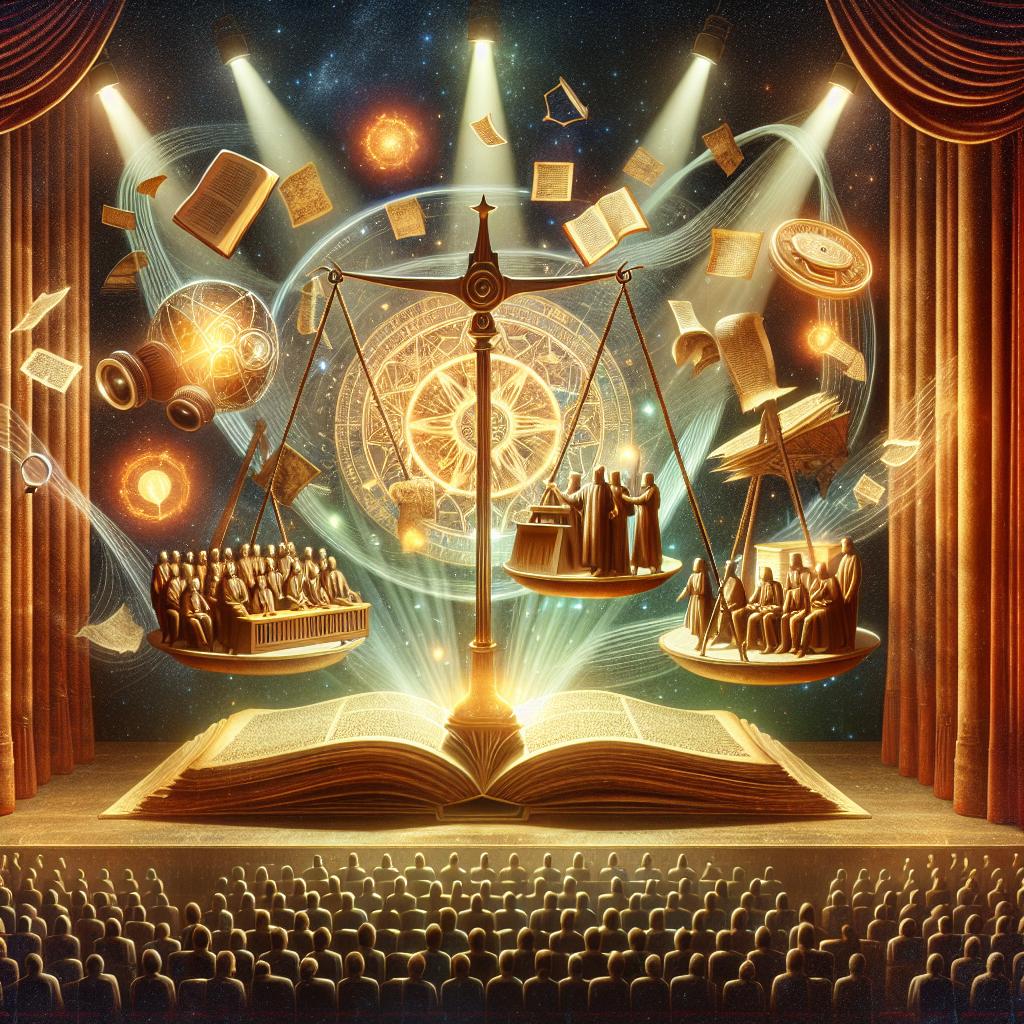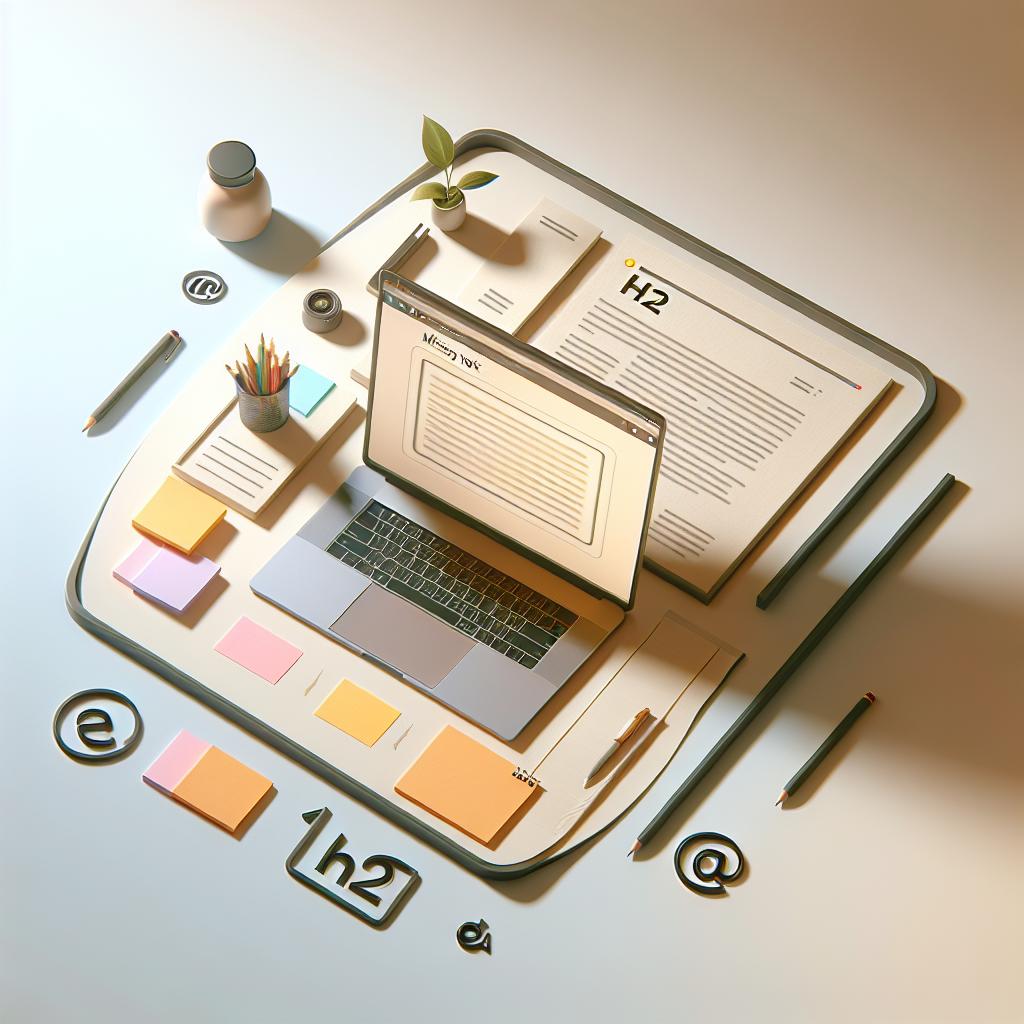Patrick Boucheron est historien et médiéviste, spécialiste notamment de l’Italie. Professeur au Collège de France, il figure parmi les coscénaristes de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris, où le récit historique de la France irrigue le parcours et la mise en scène. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017).
Histoire publique et mise en scène
La participation de Boucheron à la scénographie d’une cérémonie majeure place l’histoire au cœur d’un événement populaire et international. Selon le texte original, l’histoire nationale sert ici de matériau dramatique et esthétique pour construire une narration collective. Ce choix interroge la manière dont les savoirs académiques peuvent circuler hors des cercles universitaires, et comment ils sont adaptés à des formes spectaculaires qui visent un large public.
Dans ce contexte, la mise en scène ne se contente pas de restituer des faits : elle propose un récit, opère des choix de sélection et de mise en valeur, et institue des filiations symboliques entre passé et présent. Le rôle d’un historien comme coscénariste soulève ainsi des questions sur la responsabilité intellectuelle et sur les modalités de transmission du savoir historique au grand public.
Faire l’inventaire des différences historiques
Boucheron affirme qu’il est utile « de mettre les pieds dans le plat et de faire l’inventaire de nos différences vis‑à‑vis de l’histoire nationale », en privilégiant une démarche apaisée, scientifique et méthodologique. Cette posture insiste sur la nécessité d’un travail critique et rigoureux pour comprendre les diverses manières dont la France s’est construite et s’interprète.
La démarche proposée est double : d’une part, reconnaître la pluralité des expériences et des récits qui composent l’histoire nationale ; d’autre part, adopter des outils méthodologiques pour éviter la réduction des débats à des polémiques identitaires. L’objectif tient à la fois à la clarification intellectuelle et à la preservation d’un espace public où la controverse reste raisonnée.
Histoire, sciences sociales et guerre culturelle
Pour l’auteur, l’histoire est devenue un objet de discorde dans ce qu’il nomme la « guerre culturelle ». En France, une grande part des affrontements politiques s’appuie sur des imaginaires historiques : les disputes portent moins sur des données factuelles que sur des lectures symboliques du passé. Cette tendance complexifie le dialogue entre spécialistes et citoyens.
Le texte évoque également une offensive plus large contre la science, attribuée à « Donald Trump », et précise que ces attaques surviennent « depuis janvier » (date non précisée dans le texte original). Cette critique vise, selon l’argument rapporté, la culture scientifique dans son ensemble et cherche à discréditer la scientificité des discours issus notamment des sciences sociales.
Les formes de dénigrement décrites prennent parfois l’apparence d’accusations générales : « ce n’est que de l’opinion, de l’idéologie, en réalité l’université est gangrenée par… » Cette formule illustre le mécanisme rhétorique qui réduit les travaux académiques à des positions partisanes, et qui, d’après le propos cité, affaiblit l’espace de discussion publique.
Selon la lecture proposée, ce recul de la confiance en la recherche constitue un enjeu pour la démocratie. L’auteur rappelle que la démocratie n’est pas seulement un régime politique, mais « une tâche à accomplir » ; elle requiert un débat public de qualité pour fonctionner correctement. Lorsque la scientificité des savoirs est systématiquement remise en cause, le débat se polarise et se dégrade.
En filigrane, l’argument insiste sur la nécessité de préserver des normes de rigueur et de méthode dans l’enseignement et la diffusion de l’histoire. Il appelle à concilier exigence scientifique et capacité à dialoguer avec des publics variés, sans céder à la réduction des savoirs au rôle d’instruments rhétoriques.
En résumé, le propos prêté à Patrick Boucheron souligne trois points : l’importance de penser l’histoire hors des clivages, le rôle des historiens dans les espaces publics de grande audience, et la fragilité du débat démocratique face aux campagnes de dénigrement de la culture scientifique. Ces constats invitent à repenser les formes de transmission du savoir pour préserver un débat public éclairé.